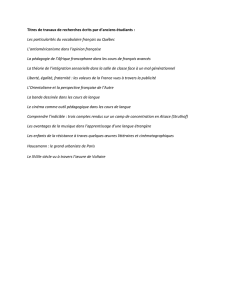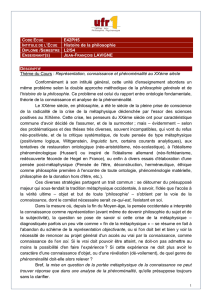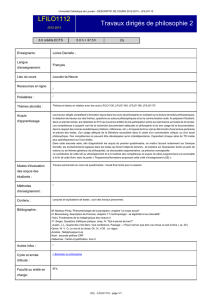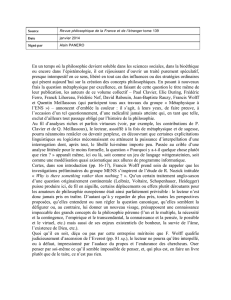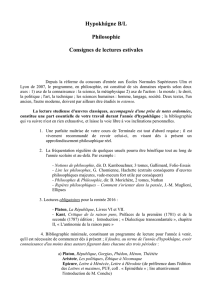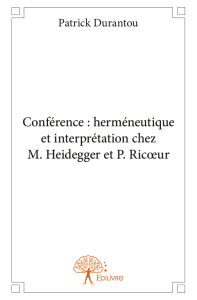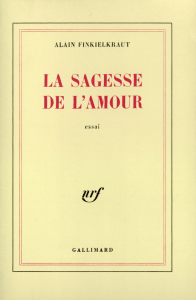Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE Nº V « Concepts et langages »
Laboratoire de recherche « Métaphysique »
T H È S E
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
Discipline/ Spécialité : Histoire de la Philosophie
Présentée et soutenue par :
M. Guillermo TIRELLI-SORIENTE
le : 8 octobre 2011
L’indicible.
Heidegger, Lévinas, Wittgenstein
Sous la direction de :
M. Jean-Luc MARION Professeur, Université Paris IV, Sorbonne
JURY:
Mme. Éliane Escoubas Professeur, Université Paris XII, Creteil-Val de
Marne
Mme. Christiane Chauviré Professeur, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne
M. Jérôme de Gramont Professeur, Institut Catholique de Paris

2
L’indicible. Heidegger, Lévinas, Wittgenstein
Guillermo Tirelli
Position de thèse
Ce travail comporte sur la place de l’indicible dans la pensée de Heidegger, Lévinas et Wittgenstein. La
question ramène à la problematique de la langue chez chaque philosophe : Qu’elle est la place pour la langue
dans le monde illuminé, ouvert, par chaque philosophe — à l’intérieur de la cohérence de ce se-tenir-
ensemble de la question ?
Les analyses cherchent aussi à metre en lumière les similitudes et dissimilitudes des trois auteurs à
l’égard du sujet et la possibilité de tirer une conclusion valide pour la direction ou la tendance de la
philosophie contemporaine.
Les courants contemporains
La situation telle qu’elle était courant XVIIIème siècle est à signaler : Hamann, Herder et Humboldt
travaillent sur une théorie du langage comme moyen pour faire la philosophie. L’accent est mis sur le
langage comme méthode de compréhension et véhicule de connaissance. C’est le temps de la naissance
de la philologie comparée et d’une littérature propre à la langue allemande en rapport étroit avec la
philosophie moderne.
En faisant cela, un manque de transparence est aperçu : le langage détermine la pensée et la culture ; il
n’est plus possible de faire confiance à l’idée d’une pensée pure, diaphane, qui peut se transmettre et
reproduire sans considération de la langue dans laquelle elle est dite.
La recherche d’une langue sans influences et d’une langue qui n’influence pas est entamée. Mais cette
neutralisation de la langue ne peut pas se faire sans tenir compte de ses effets les plus vastes, ainsi
l’ouverture du monde est reconnue comme la fonction première et la plus propre de la langue.
Humboldt est reconnu comme le fondateur de la lecture contemporaine selon laquelle le caractère et la
structure d’une langue sont l’expression de ceux qui parlent cette langue, les langues doivent
nécessairement différer entre elles de la même manière que le font ceux qui les parlent.
Qu’est-ce que l’homme ? Fondamentalement un être qui parle, une créature langagière. Qu’est-ce que le
langage ? À la fois, la réalité humaine elle-même, ce qui renvoie au foyer unifiant qu’est la faculté de
parler, et un nom générique, donc une abstraction, dont les manifestations particulières sont les langues,
toujours langues d’une communauté, produit et production d’une culture et d’une histoire ; mais la
langue elle-même, réalité concrète de la communauté qui parle est, coupée de celle-ci, une abstraction,
qui, à son tour, renvoie au concret qu’est la communauté et enfin à l’ultime concret, le singulier, le
locuteur.
Dans son dernier traité, introduisant l’étude sur la langue kavi, Humboldt a su résumer ou même
déterminer les bases de la linguistique et de la philosophie du langage jusqu’à l’actualité.
Le chemin méthodologique de Humboldt, orienté par la langue, finit par donner le fondement du
développement spirituel et expose ce développement. Il aurait ainsi introduit un tournant vers le
linguistique dans l’anthropologie humaine.
Plus tard, le tournant linguistique, s’opère dès lors que la devise disant « les problèmes philosophiques
sont des problèmes de langage ou des problèmes en rapport avec le langage » s’applique, ce qui touche
ainsi le rapport fondamental entre philosophie et langage, le faisant tourner. En suivant Wittgenstein, la
philosophie est comprise comme une activité, elle-même est cette formulation de problèmes et le
discours menant à la résolution. Il signifie l’abandon de l’esprit dans la compréhension de la langue.
La définition relie chaque problème philosophique à un problème sur le langage ou, au moins, à un
problème dépendant de problèmes sur le langage. La position est issue de la tradition analytique
exprimée dans le Cercle de Vienne et développée notamment à l’intérieur du courant analytique
contemporain.
Selon cette lecture du Tractatus…, Wittgenstein suppose que les problèmes de la philosophie sont résolus
ou dissous par sa méthode, cela du fait que la formalisation logique du langage détermine les phrases qui
ont un sens de celles qui n’en ont pas. La création d’un langage idéal ou la reformulation de la langue
selon un idéal se montre ainsi comme la méthode définitive.

3
Postérieurement, Wittgenstein aurait abandonné cette thèse en choisissant la langue quotidienne comme
modèle de normalité et de normativité, il se trouve ainsi que dans les écrits d’un seul philosophe les deux
positions principales au cœur du courant du tournant linguistique ont été suivies ou fondées.
Le dialogue entre ces des positions définit une tension entre comprendre la philosophie entière de
manière linguistique et faire de la philosophie du langage. Les partisans du maintien du langage actuel
cherchent la compréhension et les suiveurs d’une langue idéale postulent une reforme active du langage.
Le grand consensus ne se ferait que sur le fait que le tournant linguistique doit être soit accepté soit
rejeté, mais toujours considéré.
La réalisation du projet montrerait des difficultés qui finiraient pour constituer des problèmes
philosophiques, il faut ainsi faire de la philosophie, la même philosophie que les suiveurs étaient sensés
dissoudre.
Si le tournant linguistique s’est imposé comme courant philosophique c’est parce qu’il a trouvé sa
justification dans l’habilitation donnée à la philosophie à continuer à développer son activité, par le biais
du langage, tout en se libérant des problèmes sur les preuves d’une réalité. Plus tard, au cours de cet
écrit, cela constituera même l’une des caractéristiques principales de ce que la langue est : une résistance
à la réification.
En outre, Habermas affirme que la tradition herméneutique peut être considérée comme une autre
version du tournant linguistique, la pratique analytique et celle de la langue quotidienne ont toujours
mis l’accent dans la relation proposition-fait, cette pratique considère toujours des phrases simples dont
la tâche consiste à prouver, une par une, la validité. En revanche, la tradition herméneutique continentale
s’occupe du langage entier et le but de la recherche consiste à demander au langage les traits
caractéristiques du monde.
Pour les herméneutes, la compréhension est la conséquence d’un rapport entre la totalité et ses parties.
Les textes, en vue de leur interprétation, ne peuvent pas se passer de la considération de leur monde
propre. Il s’agit de chercher la propriété de l’interprétation, c’est-à-dire, la possibilité de lire les mêmes
mots en assurant un rapport qui considère toutes les dimensions des vocables.
Chaque texte est immergé dans son monde culturel, historique, littéraire. L’interprète — l’exégète — l’est
aussi. Il modifie, il rajoute sa propre interprétation à la totalité des faits.
La solution proposée au cercle herméneutique est la résolution de faire une interprétation continuelle,
toujours au présent, toujours renouvelée. Il s’agit plus d’une accentuation extrême de la thèse, un a
fortiori plutôt que d’un nec plus ultra.
D’après Heidegger, l’herméneutique reçoit quelques acceptions différentes entre elles, selon que
l’approche se fait vers son essence ou vers l’usage le plus commun du vocable. Le sens le plus propre de
l’herméneutique est l’explicitation, le fait de dire, de décrire. Selon lui, herméneutique et
phénoménologie du Dasein coïncident en principe. L’herméneutique ne serait que l’art de l’interprétation
parce que toute interprétation est aussi compréhension.
Dastur signale l’importance que prend ce tournant en comparaison avec la tradition philosophique, ce
qui inaugure la défaite d’une ontologie de la présence.
En outre, selon Lévinas, l’herméneutique en tant que méthode ne saurait être capable de convenir à sa
pensée. D’après l’intentionnalité, telle qu’elle est définie par la philosophie actuelle, toute expérience
devient interne. Il n’y aurait pas la possibilité de faire intervenir des notions telles que l’au-delà ou le
plus-profond-que-soi, centrales dans la pensée lévinassienne.Néanmoins, une herméneutique religieuse
est encore possible.
Quant à Wittgenstein — selon la lecture de Bouveresse — l’herméneutique réaliserait le mouvement
contraire à sa pensée, les concepts de compréhension et d’interprétation seraient hypostasiés par elle,
mis hors de ses jeux de langage, dans un mouvement typiquement philosophique.
Le critère de la bonne interprétation est essentiellement qu’elle nous satisfait, c’est-à-dire nous dissuade
d’interpréter davantage, et la certitude d’avoir compris devient, du même coup, celle de la « légitimité »
des préconceptions diverses qui ont rendu la compréhension possible.
L’universalisation de la situation proprement herméneutique (celle dans laquelle la compréhension n’est
pas immédiatement donnée et ne peut être obtenue que par un processus d’interprétation ou de
traduction plus ou moins complexe) aboutirait, en fait, tout simplement à la conséquence qu’il n’existe
rien de tel que ce que la linguistique s’efforce de décrire sous le nom de possession ou de maîtrise d’une
langue.
Dans la considération des courants contemporaines il existe bien la possibilité de apprécier la
philosophie avec le même statut que la littérature, c’est-à-dire, comme faisant partie du même réseau
textuel que toutes les autres formes de discours, chaque texte ne pouvant pas trouver son sens en tant
qu’œuvre en lui-même sinon comme partie d’un tout signifiant.

4
Chez Derrida il y a l’affirmation d’une base indécidable de tout sens et de toute signification, un vice et
une vertu dans le fondement, une différence-même — « différance » selon le vocable proposé par lui.
Le langage a envahi l’horizon de toute recherche contemporaine, le tournant linguistique aurait été
confirmé de plusieurs manières à la fois dans le siècle dernier. Cela ne serait que le signe de la fin d’une
époque historico-métaphysique à laquelle tous les phénoménologues font encore partie.
La différance empêche ainsi la plénitude du signe, l’unité d’un signifiant et d’un signifié ne pourra jamais
se produire dans la présence absolue, dans la plénitude d’un présent. La parole ne peut jamais être
pleine, d’une vérité pleine venue à la parole. La présence pleine de la signification se trouve différée,
remise à plus tard et ce infiniment, et ne se faisant représenter que par des équivoques, des truchements
dans la langue, des substituts.
Jean-Luc Marion, contestant cette position, trouve son point de départ dans la critique d’une modernité
résumée dans la position privilégiée accordée au sujet qui a su finir dans la phénoménologie, mais dans
cette objection il lit Husserl à la lettre. Il affirme que le premier principe n’est autre que la thèse disant
que tous les phénomènes sont donnés. Il n’existe pas de signifiants sans donné mais il y a de la donation
sans intuition, ou dépassant l’intuition. Les phénomènes se trouvent libérés des catégories avec lesquelles
la modernité les abordait.
La place de la langue
En montrant comment la langue est aperçue en rapport avec les autres éléments dans la pensée de
chaque philosophe, le problème de l’indicible se fait plus clair.
Chez Heidegger, le recueil Unterwegs zur Sprache ne s’érige pas seulement comme un livre capital pour
connaître sa position sur la langue mais aussi comme possibilité de caractériser sa pensée en entier.
De la question du sens de l’être, propre à ses premiers écrits et culminant dans Sein und Zeit, Heidegger
parviendra à l’analyse du sens de logos chez les présocratiques, par exemple dans les textes héraclitiens,
pour arriver jusqu’à son tournant (Kehre) où sa pensée et la langue sont rapprochées au dire poétique
sans nier une certaine pertinance au discours philosophique.
Pour le dire autrement, les prises de position de Heidegger partent d’un rapport entre langue et
phénoménologie, passent par l’affirmation de la langue comme maison de l’être et arrivent à une
affirmation ultime : « la langue parle ».
Ce même chemin montre, en parallèle, l’abandon de tout primat de la logique, la possibilité d’approcher
l’être selon la métaphysique de la présence trouve ainsi ses limitations.
L’homme se comprendra dorénavant à l’intérieur de cette nouvelle approche. Un chemin de retour est
ainsi nécessaire, seulement dans la mesure où l’homme reste à l’écoute de la langue il est capable de
parler. Les hommes sont capables à leur manière de parler en faisant sonner la langue, se trouvant eux-
mêmes dans la langue ; dans le site de son être.
Le tracé-ouvrant de la Dite, ce qu’il y a à dire sur elle, est tout ce que dit la langue, cela fait que la langue
soit, en définitive, monologique.
La topologie (die Erörterung) — plutôt que la topographie qui appartient à la métaphysique —donnera
une finition à la pensée heideggerienne : de la question sur le sens de l’être — dans Sein und Zeit — le
penseur est passé à se demander la question de la vérité de l’être — dans la Kehre — pour finalement se
poser la question du lieu, de la situation ou la localité de l’être — dans Unterwegs zur Sprache.
Une pensée qui renonce à l’exigence de la Begründung qui caractérise le projet métaphysique plus
particulièrement dans sa forme moderne, ne peut s’effectuer que comme topologie, autrement dit comme
exploration d’un espace dimensionnel dont il faut au préalable établir le site. C’est le but véritable de
l’Erörterung.
Le résultat ne sera ni la démolition de la métaphysique ni sa restauration : le dépassement
(Überwindung) de la métaphysique ainsi que son assomption (Verwindung) vont être réalisés selon le
parcours d’une question portant sur la langue et sur son site. La métaphysique reste secondaire mais elle
n’est pas niée dans sa totalité, ce qui n’empêche pas que la langue et sa topologie vont échapper à sa
logique.
Quant à Lévinas, c’est surtout au sein de ses premiers écrits qu’il fait une caractérisation très nette de la
notion d’être, lui permettant d’établir une distance entre langage et être ainsi que de proposer une vision
contraire, menant à affirmer une prépondérance de l’étant. De cette manière, une place est délimitée
pour parler de ce qui est possible ou impossible d’être dit.
Pour accomplir le mouvement philosophique critiqué par Lévinas, l’homme a joué à la fois comme objet
et comme sujet. La subjectivité ainsi comprise n’était qu’une médiation, le sujet devait être épuré de toute
particularité, de toute singularité, voire de toute possibilité de s’excepter au système. La raison et la
connaissance mènent à la dévalorisation du moi.

5
Lévinas manifeste son refus en promouvant la subjectivité à la qualité d’exception à l’être, une inversion
entre l’être et la subjectivité. Il s’agit maintenant d’un être fondé par une subjectivité fondatrice. La
quiddité est enlevée de son jeu pour prendre un sens qui n’est pas réductible à la rationalité ; le sens est
ainsi donné à l’être immanent depuis la transcendance éthique qui est l’Autrui dans le moi ; la
subjectivité est la substitution de l’autre, la responsabilité pour autrui.
Si Lévinas n’a pas d’autre notion de langage que celui de l’âge classique, s’il ne fait pas de distinction
entre le langage de l’être et du non-être — ou au-delà de l’être —, ce n’est même pas possible de concéder
à sa position une cohérence.
Il doit trouver une solution qui lui permette de faire de la philosophie tout en ayant une notion
fondamentale qui devrait être — sur certains aspects remarquables — caractérisée comme irrationnelle,
indicible ou inexprimable. Néanmoins, cette indicibilité devrait être niée par les motifs qui l’engendrent,
par ce qui soutient la cohérence de la langue. Il devra ainsi trouver une manière d’exprimer cela dans un
langage cohérent et significatif, il doit faire philosophie.
En même temps, pour proposer une taxonomie plus historique, il faut faire la distinction de deux
moments et ainsi de deux conceptions du langage chez Lévinas : un premier moment quand le langage et
la transcendance sont encore considérés à l’intérieur de l’être — Totalité et Infini —, et un deuxième
moment quand le langage constitue une relation autre, plus proche de l’étant que de l’être — Autrement
qu’être ou au delà de l’essence.
Ce n’est que quand Lévinas construit sa pensée que des notions ou des mots qualifiés comme indicibles
ou signalant l’ineffable peuvent être postulés, cette attitude est erronée, car elle se soutient, en définitive,
dans un langage voué à l’être et à la connaissance.
Le nouveau rôle de la philosophie emmène à la postulation d’une rationalité différente, l’origine de la
signification dans le langage ne doit pas être cherchée ni dans son rapport avec les choses ni avec les
phénomènes, même pas dans son rapport avec un horizon ou un monde, au contraire, le point de départ
de la philosophie — qui n’est que philosophie du langage—, le non-savoir philosophique, ne coïncide pas
avec le néant tout court mais avec le néant d’objets. La pronation d’un sens derrière le sens intersubjectif
requiert un changement dans la notion de rationalité.
En outre, même si généralement Wittgenstein est perçu comme étant un philosophe analytique, une
première approche de son œuvre montre déjà que sa portée est beaucoup plus ample. Il faut signaler,
d’un côté, que ce sont plutôt ses conclusions qui ont été prises comme fondement dans les formulations
de l’école analytique et, de l’autre côté, que ses considérations ne constituent pas une théorie du langage ;
il s’agit plutôt d’un questionnement sur ou vers le langage.
Le sujet de l’indicible mérite une considération spéciale : dans ses textes le sujet s’avère central. Cela fait
que la recherche ici entamée consacre moins de pages à la situation du langage et qu’à sa place le débat
actuel sur l’enjeu de l’indicible dans la pensée wittgensteinienne s’étale plus largement.
Cela n’empêche qu’un parcours passant par les deux moments capitaux de la pensée de Wittgenstein sur
le langage — caractérisés par le Tractatus… et les Philosophische Untersuchungen — s’avère encore
nécessaire.
La place qui était occupée à partir de Descartes par la philosophie de la connaissance l’est maintenant par
celle du langage. La signification occupe une position centrale, elle agit comme un anhypothétique. Il n’y
a plus d’activité fondatrice de théories de la signification à l’intérieur d’un système philosophique. Un
renversement s’est ainsi produit à la lumière de cette signification sans fondation.
La préoccupation de Wittgenstein ne serait pas seulement détruire ou défaire la philosophie mais
reconduire la langue à son usage correct, échappant tant aux déraillements de la langue qu’à la
postulation de principes externes qui en mettant des limites font penser à l’existence de quelque chose
d’indicible. Ces deux dernières positions ne seraient que des subterfuges en vue de la continuation de la
métaphysique ou de la philosophie traditionnelle.
La mention de l’indicible
L’indicible est mentionné par les trois philosophes, néanmoins, son irruption ne peut pas impliquer la
démolition de la théorie sur le rapport entre la langue et l’être voire faire inconsistante la taxonomie de la
langue.
L’indicible doit se montrer et se dissoudre lui-même dans l’explication, sans prôner une brisure qui
pourrait ramener à nouveau à une métaphysique dualiste ou qui requerrait un métalangage où tout
tourne autour de la présence. La prise de quelques cas exemplaires — ou de quelques thématiques —
confrontés aux considérations théoriques le démontre.
Dans le cas de Heidegger, la poésie constitue une première thématique. C’est à partir des années trente
que la poésie joue un rôle dans sa pensée. Le dire poétique n’est pas rapporté au domaine de
l’imagination, au contraire, il pro-duit et fait apparaître ce qui se déploie dans l’être. Il se fait ainsi plus
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%