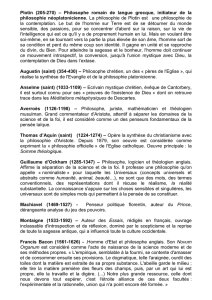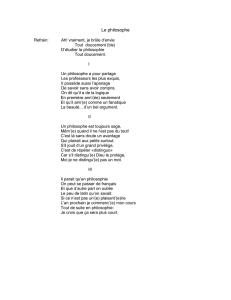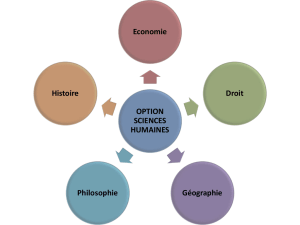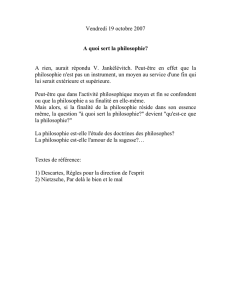Jamais ce monde ne me sera limpide

92
Le magazine des écrivains
|
Grand entretien
Le Magazine Littéraire
|
514
|
Décembre 2011
92
Le magazine des écrivains
|
Grand entretien
Le Magazine Littéraire
|
514
|
Décembre 2011
93
Février 2011
|
505
|
Le Magazine Littéraire
À lire
De l’amour, de la
mort, de Dieu et
autres bagatelles,
Lucien Jerphagnon,
entretiens avec Christiane
Rancé, éd. Albin Michel,
éditeur, 264 p., 18 €.
À écouter
Paul Veyne sur
l’Antiquité,
Lucien Jerphagnon,
éd. Ina/Textuel, « La voix
au chapitre », CD + livre
60 p., 24,90 €. Jerphagnon
commente par écrit des
enregistrements
radiophoniques de Veyne.
Professeur émérite des universités, membre de l’Acadé-
mie d’Athènes, Lucien Jerphagnon était un éminent spé-
cialiste de l’Antiquité. Mais de ceux, trop rares, qui met-
tent leur savoir au service, ou mieux, « au bonheur du
lecteur » – pour paraphraser le titre de l’un de ses ouvra-
ges – et vous rappellent que l’érudition se doit d’être joyeuse. Une
véritable incarnation du « gai savoir » sous le masque d’une plume à
l’élégance classique. « Jerphiste » pourrait devenir un jour l’épithète
désignant le culte rendu à une intelligence décomplexée et jubilatoire
et à la mémoire de cet historien de la pensée ne voulant surtout pas
ennuyer un lecteur « qui ne [lui] avait rien fait ». Par l’intermédiaire
de notre éditeur commun, nous déjeunons ensemble. Je découvre
l’homme, mince, à la moustache fine et à l’œil malicieux. Lucien Jer-
phagnon avait un faux air du facteur Cheval, le goût assuré du bon
mot et, parfois, de la vacherie rigolarde. Alors que je l’interrogeai sur
son prochain ouvrage, il évoqua la fa tigue de son « grand
âge » de cette formule : « Vous comprenez, mon jeune
ami, je ne voudrais pas écrire sous moi. » Et de s’esclaffer
devant ma consternation. Comme Socrate, il aimait dérou-
ter. Au début de juillet 2010, nous nous revoyons une der-
nière fois, chez lui, à Rueil-Malmaison, pour un long entre-
tien, resté inédit. Sa femme, Thérèse, est auprès de lui, et
la chaleur de leur accueil le dispute à celle de l’été. À la
veille de ses 89 ans, le philosophe me met en garde : pas
d’entretien testamentaire ! Malgré la fatigue déjà sensible,
il se montre vif, acéré, léger et profond. Drôle également.
Cette fois encore, les dieux, comme Mordicus d’Athènes,
n’ont pas été loin.
Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore,
êtes-vous philosophe, ou historien de la philosophie ?
Lucien Jerphagnon. De formation, je suis à la fois phi-
losophe et historien. J’ai un doctorat ès lettres de philo-
sophie et un diplôme de l’École pratique des hautes études d’his-
toire. J’ai toujours considéré qu’un historien qui ne se consacre qu’à
l’histoire est un archiviste qui se contente d’énumérer les traités et
les batailles… et qu’un philosophe qui ne fait que de la philosophie
se balade dans des concepts sans que personne n’y entende plus
rien, sauf peut-être lui-même. Je suis donc un être hybride, mais
avant tout un historien de la philosophie. À ceux qui me disent :
« Vous êtes philosophe », je réponds aussitôt : « Non, je n’ai pas mis
au point le jerphagnonisme. » Autrement dit, comme les philosophes
ne se comprennent pas entre eux, je n’ai pas ajouté un étage à leur
tour de Babel.
En quelque sorte, il n’y a pas d’histoire sans idées
ni d’idées sans histoire.
Toute philosophie est nécessairement historique. Une philosophie
dépend toujours de l’air de son temps. L’idéal pour l’historien de la
philosophie est d’essayer de respirer l’air du temps de
la philosophie qui l’intéresse. Il faut savoir non seulement
ce que l’on pensait, mais aussi ce que l’on faisait, disait,
je dirais même ce que l’on mangeait et buvait, quelle
conception on avait alors de l’amour, de la haine, de la
religion, de la politique, du bonheur…
Vous vous êtes ainsi tout particulièrement intéressé
à l’Antiquité et au Moyen Âge.
Oui, et notamment au x i v e siècle, période qui prouve tout
le contraire de ce qu’on a pu dire sur le Moyen Âge. Indé-
pendamment du tra gique de l’époque, c’était un moment
de renouvellement, de trouvailles, d’idées. Et cela en
protestation contre le Moyen Âge de Thomas d’Aquin,
où, au fond, on recrachait de l’Aristote que l’on plaquait
sur les mystères chrétiens. Si bien que la sainte cène,
l’eucharistie et la communion sont devenues des cas par-
ticuliers des rapports de la substance et de l’accident.
Jésus aurait été furieux !
Lucien Jerphagnon
‘‘ Jamais ce monde
ne me sera limpide ’’
Récemment disparu, cet historien de la philosophie antique
et médiévale, « agnostique mystique » prônant
un gai savoir, a marqué des générations d’étudiants.
Nous publions un entretien avec lui réalisé en 2010, et resté inédit.
Propos recueillis par Mathias Lebœuf
WITTI DE TERA/OPALE
Lucien
Jerphagnon
en 2010.

94
Le Magazine Littéraire
|
514
|
Décembre 2011
Le magazine des écrivains
|
Grand entretien 95
Décembre 2011
|
514
|
Le Magazine Littéraire
Le x i v e siècle n’est donc pas le Moyen Âge obscurantiste
qu’on imagine souvent…
Non, comme l’a montré Jacques Le Goff, le Moyen Âge n’est pas une
période obscurantiste. Le moment terrible est le pré-Moyen Âge,
cette période qui commence avec la chute de l’empire d’Occident
en 476 pour aller jusqu’à Charlemagne. Il y a alors comme un coma
intellectuel. Le peu qui s’est transmis de l’immense monde de l’An-
tiquité n’a pu être sauvé que grâce au travail obstiné des moines dans
les monastères.
Vous êtes un admirateur du Nom de la rose. Le Moyen Âge
a aussi vu se dérouler la querelle des universaux…
Le Moyen Âge pose la question du rapport entre la philosophie des
livres et la philosophia, telle que nous la portons en nous comme
amour de la sagesse. L’époque antérieure envisageait le concept
comme une réalité. Vinrent des gens comme Guillaume d’Ockham,
qui considérèrent qu’il ne s’agissait pas d’une essence mais d’un
signe. Un mot est signe d’un concept, qui lui-même est signe d’une
chose concrète. Tant et si bien qu’on se meut au milieu de signes de
signes. Si on me disait un jour que je ressemble à Guillaume de Bas-
kerville [le héros du Nom de la rose], j’en serais ravi, car ce person-
nage est le type même des philosophes de cette époque-là.
Le travail de l’historien de la pensée est-il aussi de réhabiliter
un certain nombre de figures comme Julien l’Apostat
ou d’autres empereurs comme Néron et Caligula ?
Néron était certainement bien moins mauvais que ce qu’on a
raconté, et sa funeste légende doit beaucoup aux sénateurs. Il n’a
jamais mis le feu à Rome, une ville où l’on se baladait la nuit une
chandelle à la main pour y voir quelque chose ! Rome était ainsi
perpétuellement en train de brûler. Pour Caligula, c’était plus justi-
fié. Mais c’était une figure imposée de dénigrer les Césars. Quant à
Julien, lorsqu’il a vu ce que donnait le christianisme, il a voulu res-
taurer la religion païenne. Ce qu’il fit d’ailleurs. Mais il n’y a jamais
cru ! C’est pourquoi j’ai titré la biographie que j’ai écrite Julien dit
l’Apostat. Des tas de sottises ont aussi été dites au sujet d’Augustin.
On a raconté par exemple qu’il s’était converti d’un seul coup, alors
que cela lui a pris neuf ans !
J’ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus romain
que grec dans votre approche de l’Antiquité ?
Je vous répondrais tout simplement que, si nous avons une philo-
sophie, c’est aux Grecs que nous la devons, mais que, si nous
connaissons la philosophie des Grecs, c’est grâce aux Romains.
Rome s’est emparée de la Grèce et a ainsi sauvé la culture grecque
de tous les dangers que les Grecs étaient pour eux-mêmes. Leur
civilisation était une civilisation de cité-État, formant un monde clos.
Or toutes ces cités se foutaient sur la figure ! D’ailleurs, en Occident,
on parlait très peu le grec, alors que le latin était employé un peu
partout dans cet immense empire de plus trois millions de kilo-
mètres carrés, aux peuplades extrêmement différentes, aux ethnies
totalement diverses, avec chacune leur langue, leurs habitudes et
leurs dieux. Rome a été assez intelligente, en s’agrandissant, pour
laisser une certaine autonomie à l’esprit des uns et des autres. Ce
qui lui importait c’était que ça lui rapporte ! Rome eut l’élégance,
la simplicité et l’intelligence, elle qui les avait conquis, de se laisser
« prendre » par les Grecs. « La Grèce subjuguée à son tour subjugua
son farouche vainqueur », écrit fort justement Horace dans une
épître. Rome a découvert très tôt que s’helléniser n’était pas perdre
son identité, mais au contraire l’améliorer, l’approfondir. Politique-
ment, les Grecs ont donné à Rome le goût d’une certaine démo-
cratie, même sous l’empire, qui sera, de fait, infiniment plus « démo-
cratique » que la République romaine.
Dans Les Divins Césars, vous montrez comment le stoïcisme
est devenu la philosophie impériale.
J’ai surtout voulu montrer que la philosophia n’était pas, comme
aujourd’hui, une simple affaire d’intellectuels, mais qu’elle donnait
des recettes pratiques pour vivre, pour gouverner, etc. Dans le même
temps, elle légitimait le mythe du pouvoir venant des dieux. Le prince
était alors sacré, et comme, d’autre part, il était élu, les gens étaient
mieux disposés à lui obéir.
Au cours de l’histoire, les philosophes ont souvent eu un rapport
étroit avec le politique, l’organisation de la cité et le pouvoir.
Oui. Par exemple Aristote a été le précepteur d’Alexandre, Sénèque
celui de Néron. Cela assurait et rassurait l’empereur ou le César en
le confirmant dans son rôle de représentant des dieux. Marc Aurèle
est même l’incarnation de l’empereur-philosophe. Ses pensées
n’étaient destinées qu’« à lui-même » et n’étaient pas conçues pour
être publiées. Il s’agissait d’exercices spirituels et de notes prises sur
le vif. C’est très émouvant de penser que cet homme, dirigeant un
monde aussi immense, a puisé sa philosophie dans la pensée d’Épic-
tète, un ancien esclave.
Les pensées de Marc Aurèle commencent d’ailleurs
par une « reconnaissance de dette »…
Très exactement oui ! C’est une très bonne expression. D’ailleurs on
remarquera qu’il ne consacre à son père biologique que quelques
lignes, trois fois rien, tandis qu’il dédie des pages et des pages à son
père adoptif, l’empereur Antonin. Marc Aurèle était un véritable stoï-
cien, vivant le stoïcisme d’une façon naturelle, sans crispation. Exac-
tement comme l’épicurisme doit être vécu sans chercher perpétuel-
lement le maximum de plaisir à tout instant. L’épicurien recherche
en fait le minimum vital du plaisir : boire quand il a soif, manger un
bout de pain quand il a faim. Le Petrus et le foie gras, c’est très bien,
mais ça fait partie des choses naturelles et non nécessaires.
Stoïcisme, épicurisme, mais aussi scepticisme, ou cynisme…
Vous n’êtes inféodé à aucun « -isme ». Néanmoins, de toutes ces
philosophies antiques, de laquelle seriez-vous le plus proche ?
Du platonisme, notamment tel qu’il a survécu chez Plotin, qui est
« mon » philosophe, si je devais n’en retenir qu’un. En rentrant de
la guerre, ne comprenant plus rien au monde, je me suis plongé dans
les Ennéades de Plotin, et plus jamais je ne les ai quittées ! Cet auteur
m’a même empêché, à certains moments de ma vie, de finir athée.
J’ai toujours été un homme de foi, parce qu’en Plotin j’ai découvert
le principe d’un monde qui m’a toujours étonné. La présence du
monde ne m’est pas naturelle.
Est-ce pour vous le début de toute philosophie ?
Absolument. Tout est étrange pour moi. Ça m’a pris tout gamin : à
l’âge de 4 ans, je me suis aperçu que j’existais et que le monde exis-
tait autour de moi. Je pourrais traduire cette expérience avec ce
questionnement : « Qu’est-ce que ça fout là ? Ça part d’où ? Ça va où ?
Et qu’est-ce que je fous là-dedans, moi qui suis en train de me deman-
Philosopher, c’est aussi rassurer ceux qui voient
d’un œil désespéré ce monde tragique,
où la vie travaille pour un cimetière déjà surpeuplé. ’’
‘‘ der ce que ça fout là ? » J’ai focalisé ma pensée sur ces points-là toute
ma vie. Rien n’est naturel pour moi. Voilà pourquoi je me suis tourné
vers la philosophie et la recherche du « principe ». Même si je sais
que, de ce principe, sur lequel on met trop souvent le mot de Dieu,
on a trop dit. Pour Plotin, il est au-delà de l’être. En parler en termes
d’être, c’est déjà le rabaisser.
Comment devient-on philosophe ? Cela commence-t-il
réellement par l’étonnement, ou est-ce un « catéchisme » ?
Platon puis Aristote ont eu raison de dire que la philosophie com-
mence par l’étonnement. Devant un tableau, des fleurs… devant tout
ce qui peut exister en ce monde. Je n’ai jamais compris pourquoi il y
avait quelque chose plutôt que rien. Mais lorsque je dis ce rien, je suis
déjà en train d’en faire un « quelque chose », ce qui complique encore
l’affaire. Jamais, absolument jamais, ce monde ne me sera limpide. Je
sais qu’on peut dire des tas de choses sur le monde, comme le font
par exemple les physiciens, mais, de ce monde impénétrable et incom-
préhensible, j’ai toujours envie ne serait-ce que d’entrevoir ne serait-ce
que le principe, d’avoir le sentiment qu’il y a quelque chose.
Cette étrangeté du monde est-elle inquiétante ou réjouissante ?
Les deux. Inquiétante, comme tout ce que vous ne comprenez pas,
et en même temps réjouissante, car elle donne plus de charme aux
choses et aux êtres.
En quoi consiste alors le travail du philosophe ?
Inciter à l’étonnement, parce qu’on ne s’étonne pas une fois pour
toutes. Partager cet étonnement et faire partager l’admiration devant
l’existence du monde. Philosopher, c’est aussi rassurer ceux qui
voient d’un œil désespéré ce monde tragique, où la vie travaille pour
un cimetière déjà surpeuplé. La philosophia essaie de trouver le
moyen de faire avec, sans trop souffrir, parce qu’on aurait découvert
une espérance. La philosophie ne peut pas faire naître de certitudes
absolues, ou alors négatives. Mais elle peut assurément faire naître
une espérance.
Vous vous définissez comme un « agnostique mystique ».
Pascal, dans son pari, éradique la position de l’agnostique.
« Le juste est de ne point parier », écrit-il avant d’ajouter :
« Oui, mais il faut parier »…
Il faut bien avoir conscience que l’athée est un croyant. Il croit que
Dieu n’existe pas, alors que nous n’avons aucune preuve de la
non-existence de Dieu. L’agnostique, lui, n’a pas de gnose, parce qu’il
reconnaît que l’objet visé transcende par nature toute connaissance
possible. Il est « au-delà de l’essence », comme dit Plotin, au-delà de
l’esprit ou des idées, au-delà de tout.
La position de l’agnostique est-elle tenable durablement ?
Je me définis comme agnostique mystique. Mon agnosticisme est
chronique, comme on le dit d’une maladie. Et mystique, je ne le suis
que dans l’instant où je prie et où j’aimerais avoir la certitude que
cette prière atteindra son destinataire. Là est l’espérance : le désir
un jour de connaître cet instant, de savoir qu’on a « entrevu ».
Est-ce ce désir d’« entrevoir » qui maintient
la pensée en mouvement ? Vous êtes un philosophe
qui a horreur du figé, du permanent…
Oui, parce que c’est croire que l’on est arrivé à la vérité, qu’on a dit
le dernier mot sur le fond des choses. Or je suis bien incapable de
vous dire si les choses ont un fond. Simplement, j’ai toujours essayé
auprès de mes étudiants de faire naître en eux cette vie qui leur per-
mettrait d’être eux-mêmes. Que Tartemol [Tartempion dans l’esprit
de Jerphagnon] prenne conscience qu’il est Tartemol et qu’il faut
qu’il se « tartemolise » encore davantage pour devenir lui-même. « Ce
que tu es, travaille à le devenir. »
Voilà une démarche très socratique, non ?
C’est la maïeutique oui, l’accouchement des esprits. Alors, quelque-
fois, je les accouchais avec les fers. D’autres fois, cela se passait mieux.
Je disais à mes étudiants : « Surtout ne me ressortez pas mon cours !
Je le sais mieux que vous, alors trouvez le moyen de dégotter quelque
chose qui vienne de vous à partir du sujet. Inventez ! »
Vous avez personnellement été marqué par l’enseignement
de Vladimir Jankélévitch ?
J’ai découvert chez Jankélévitch ce que me disait un disciple de Berg-
son. Et, dans la philosophie de Bergson, j’ai reconnu, de temps en
temps mais explicitement, la pensée de Plotin. Voilà les filiations. J’ai
eu deux maîtres, auxquels je pense tous les jours : Jean Orcibal, à
l’École pratique des hautes études – c’était « l’érudit » qui savait vous
apprendre à étudier, quand on sortait de ses mains, on était armé,
car on ne croyait plus en soi – et Vladimir Jankélévitch, en qui je
retrouvais très exactement ce qui était arrivé à Plotin lui-même quand,
ayant fait le tour de toutes les philosophies, il tomba sur Ammonios
Saccas et le reconnut comme son maître, celui qui avait su lui faire
découvrir qu’il ne cherchait pas dans le bon sens.
Est-ce à dire que la philosophie s’incarne dans la rencontre ?
Vous avez marqué des générations d’étudiants.
Michel Onfray, par exemple, en a témoigné.
Onfray était un excellent étudiant. Il est « tombé » dans mon cours
alors que j’expliquais le De rerum natura de Lucrèce. Je m’étais
aperçu qu’un jeune étudiant me regardait fixement ; il est revenu
par-delà les examens, puis est resté auditeur libre de mes cours pen-
dant un bon bout de temps. Il avait une grande capacité d’assimila-
tion. Je vous répète que je n’ai jamais voulu fourguer à mes étu-
diants ma propre façon de penser. Ce qui m’intéressait, c’était de
faire sortir d’eux-mêmes une pensée propre, encore à l’état nais-
sant, de les aider à se fabriquer une intelligence et une vie inté-
rieure. On ne s’étonnera donc pas que Michel Onfray soit mainte-
nant, du point de vue philosophique, aux antipodes de son « vieux
maître ». Et j’en suis bien content, car il a prouvé ainsi que je n’en-
gendrais pas des clones.
7 septembre
1921. Naissance
à Nancy.
1943. Refuse
de partir au STO.
Captivité
en Allemagne.
1965. Soutient sa
thèse de doctorat
sous la direction
de Vladimir
Jankélévitch,
De la banalité.
Essai sur l’ipséité
et sa durée vécue.
Chargé de cours
à la Sorbonne puis
maître-assistant
à l’université de
Franche-Comté.
À partir de 1970,
professeur
à l’université
de Caen-Basse-
Normandie.
1986. Julien dit
l’Apostat,
une biographie
de l’empereur qui
faillit faire revenir
Rome à la religion
païenne.
1987. Histoire de
la Rome antique.
1989. Histoire de
la pensée, tome
premier, Antiquité
et Moyen Âge.
1998-2002.
Assure
la publication et
les commentaires
des Œuvres
de saint Augustin
dans La Pléiade.
Publie aussi
Saint Augustin, le
pédagogue de Dieu
(Découvertes
Gallimard, 2002)
puis Augustin et
la sagesse, (2006).
2002. Les dieux
ne sont jamais loin.
2004. Les Divins
Césars. Idéologie
et pouvoir dans
la Rome impériale.
2007. Au bonheur
des sages.
2007. La Louve et
l’Agneau, le seul
roman historique
du philosophe.
2011. De l’amour,
de la mort,
de Dieu et autres
bagatelles,
entretiens avec
Christiane Rancé,
un portrait
du philosophe
à la première
personne.
16 septembre
2011. Décès
de Lucien
Jerphagnon.
Repères

96
Le Magazine Littéraire
|
514
|
Décembre 2011
Le magazine des écrivains
|
Grand entretien
Vous êtes également docteur en psychologie : avez-vous
suivi la polémique autour de Freud lancée par Michel Onfray ?
Pas vraiment. Je n’ai pas eu le temps de lire son livre. Mais ce n’est
pas une mauvaise chose d’avoir descendu Freud de son piédestal. Un
psychologue ou un psychiatre n’a pas à devenir une divinité, pas plus
qu’un philosophe d’ailleurs. En ce sens, il a pu faire œuvre utile en
rappelant que Freud était aussi un être humain. Sur le fond, je ne sau-
rais dire s’il a raison ou tort sur la psychanalyse. Personnellement je
n’y ai jamais beaucoup cru. J’ai toujours été plus partisan de la phar-
macopée que du divan où l’on se couche pour raconter des choses
qui vous viennent… je n’ose même pas dire à l’esprit (rires).
Ne pensez-vous pas que Michel Onfray a un peu tendance à
s’ériger en procureur et à se définir systématiquement contre ?
Oui, il est de ceux qui mangent du curé en salade, et à tous les repas.
Et il en voit partout ! Il me sait platonicien et doit me croire très
cul-bénit. Alors que je vais au temple le dimanche, et encore pas tou-
jours, sans grand enthousiasme, car, comme disait Plotin, « ce n’est
pas à moi d’aller vers les dieux, c’est aux dieux de venir à moi ».
Plus généralement, quels rapports avez-vous avec les
philosophes qui vous sont contemporains ? Vous les fréquentez ?
Je ne les approche guère, et c’est réciproque. Je travaille beaucoup
avec des archéologues ou des philologues, très peu avec les philoso-
phes. Non pas que je m’estime au-dessus, mais je suis un peu
« ailleurs ». Je suis devenu un rat de bibliothèque, un érudit perché
sur une échelle pour chercher une référence et la contrôler. Je suis
surtout un historien de la philosophie, je m’attache à respirer l’air de
ces temps-là. Quant à l’air de mon temps, j’en dirai ce que disait Tal-
leyrand en parlant du sien : « Homme d’un autre temps, je me sens
devenir de plus en plus étranger à celui-ci. » Ce qui est assez normal
pour quelqu’un qui bientôt deviendra nonagénaire. Je me tiens quand
même au courant de ce qui se fait ou de ce qui se dit…
Êtes-vous sensible à l’engouement du grand public pour
la philosophie, à travers les universités populaires notamment ?
Je m’en réjouis, bien que je ne les fréquente pas, car le sentiment que
j’ai de ma liberté et de mon indépendance est quelque chose de sacré.
Je suis dans ma tour d’ivoire, et l’ivoire est un excellent isolant.
Ne pensez-vous pas que certains thèmes de la philosophie
antique sont tombés en désuétude, celui du bonheur par
exemple, récupéré aujourd’hui par les psychologues ?
C’est un thème pourtant rémanent qui pourrait aussi, un jour, être
l’apanage des médecins, qui nous diront : « Prenez du tartempionade
de calcium intégré. Si vous avalez ça, vous serez tout heureux ! »
La question du bonheur reste-t-elle un horizon philosophique ?
Bien sûr ! Et comme nous bavardons souvent de cela avec ma chère
épouse, nous savons trop que le bonheur tient, lui aussi, dans l’ins-
tant. On s’en souvient d’ailleurs généralement au passé. Être heureux
consiste au moins à profiter intelligemment de l’instant. Carpe diem.
Et puis à ne pas trop se mêler de l’extérieur : garde-toi un peu pour
toi et ceux que tu aimes ! Au fond, l’idéal du bonheur est un amour
partagé. Et, s’il dure dans le temps, c’est encore mieux. Mais rien qu’un
instant, voilà déjà quelque chose de magnifique.
Le Carpe diem fait-il écho pour vous à la formule des vanités,
Memento mori ?
Oui, parce que notre vie humaine n’est qu’un instant dans l’éternité.
Mais cet instant est immortel. N’importe quoi peut se passer, il y a
une chose de nous qui ne s’effacera jamais : celle d’avoir été. Notre
ipséité, le fait que nous soyons nous-mêmes, est unique. Tout être
est unique. Un génie comme le dernier des… est un être unique qui
doit être considéré comme tel, respecté et aimé comme unicité. On
retrouve là Vladimir Jankélévitch qui disait : « Ne manquez pas votre
unique matinée de printemps. » Notre vie n’est qu’un instant, et il
faut coïncider avec cet instant, s’émerveiller de vivre, d’aimer, d’être
aimé. Il faut s’attacher à ce que ça dure toute une vie et en gager les
autres à découvrir cet instant, les porter à ne pas manquer cette
« unique matinée de printemps ». Voilà le bonheur !
Pour reprendre un titre de Jankélévitch, avec le bonheur
on est toujours « quelque part dans l’inachevé » ?
Exactement ! Jankélévitch était un plotinien fervent à une époque
où cela n’était pas très fréquent. Nous étions alors encore dans ce
que Merleau-Ponty a appelé le « petit rationalisme », où on était sûr
de tout. Comme le disait Georges Gusdorf, le rêve de tout philo-
sophe est de mettre fin à la philosophie en ayant le dernier mot. Moi
je n’ai jamais rêvé de mettre fin à la philosophie, je suis historien de
la philosophie. Je regarde penser les autres et j’essaie de faire re vivre
des modernités révolues.
Vous le faites de surcroît avec beaucoup d’humour !
En vous lisant, on éclate souvent de rire. Le savoir est toujours
gai sous votre plume…
Je l’espère en tout cas. C’est en effet ce que j’ai essayé de faire, pour
une raison bien simple : on n’a jamais le droit d’emmerder un lec-
teur qui ne vous a rien fait ! J’ai moi-même horreur de m’ennuyer en
lisant des textes. Je décroche très vite alors. Je sais que, si j’ennuie
les autres, ils décrocheront. Et même si ce que je dis à mes étudiants
ou à mes lecteurs peut être appuyé par des textes que personne ne
connaît, ça n’ira pas plus loin que l’arrêt de bus en bas de la fac. En
revanche, si je présente la chose de manière à leur secouer un peu
la cervelle dans la tête, on s’en souviendra, cela restera.
Il est quand même rare de voir un penseur dédier l’un de
ses ouvrages, Le Petit Livre des citations latines, à Pierre Dac !
Je lui dois de ne m’être jamais pris au sérieux.
L’esprit de sérieux tue le mouvement de la pensée ?
Oui. Cela le freine d’abord, et l’envoie dans le fossé ensuite. L’humour
vous aide à aller plus loin. Grâce à lui, comme dit Augustin, vous cher-
chez pour trouver et vous trouvez pour chercher. La vraie fausse pro-
fondeur guette la philosophie. Les idées générales ne sont souvent
ni vraies ni fausses, elles sont creuses. Ce qui est intéressant, c’est
l’expérience des gens ; savoir pourquoi, un beau jour, Descartes a dit
« Je pense donc je suis ». Ce n’est pas en mettant ses chaussettes qu’il
a trouvé ça ! Les Confessions de saint Augustin sont une lettre ouverte
à Dieu pour le remercier de l’avoir trouvé. Ce qui m’a intéressé, c’est
de montrer ce qu’avait été sa vie, comment il en était arrivé là.
Une formule vous est attachée : « Va et mets le bordel
dans les têtes. »
François Busnel a écrit que j’avais entendu une voix me dire cela. Et
il a ajouté : « C’est ce qu’il fit. » J’ai effectivement toujours cherché
traîtreusement à foutre le bordel dans la tête des autres, parce que ça
leur rendait service. Surtout dans celle de ceux qui sont si sûrs d’eux !
Mais toujours avec humour. L’humour révèle la profondeur que
n’aurait pas révélée le sérieux. Il fout le bordel dans les têtes. Et de ça
on ne se remet pas, et on est content de ne pas s’en remettre.
Si le lecteur de ces lignes veut devenir jerphagnoniste,
ou jerphiste, que doit-il lire en premier ?
Gardez-vous en bien ! (Rires.) Peut-être La Louve et l’Agneau ou Les
dieux ne sont jamais loin, mon livre sur les mythes. Deux livres où
je ne m’exprime pas seulement en tant qu’historien. Sans oublier
Julien dit l’Apostat.
Grâce à l’humour,
comme dit Augustin, vous
cherchez pour trouver et vous
trouvez pour chercher.
‘‘
’’
1
/
3
100%