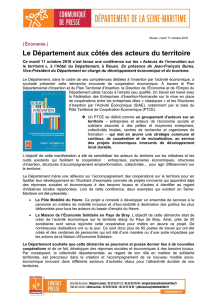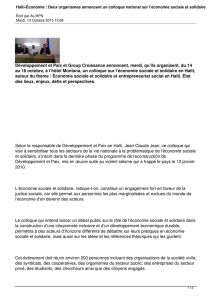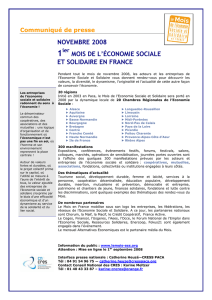Rouen et sa région : un berceau de l`économie sociale et solidaire

Rouen et sa région : un berceau de l’économie sociale et solidaire ?
Une approche territoriale comparée de la mutualité et de la coopération
du 19e au 21e siècle
Colloque international d’histoire, Rouen,
2 et 3 octobre 2014
Appel à communications
L’économie sociale et solidaire rassemble différents groupements fonctionnant sur
des principes d’égalité de personnes (1 personne, 1 voix), de solidarité entre ses
membres et d’indépendance économique. Leur finalité n’est pas la rémunération du
capital mais la satisfaction de besoins sociaux.
Il s’agit en fait d’un secteur (qualifié parfois de « tiers secteur »), très diversifié qui
peut comprendre aussi bien des sociétés mutuelles (santé ou assurance), des
entreprises coopératives de consommation ou de production, des banques coopératives
ou encore des associations d’insertion. Globalement on estime que l’économie sociale et
solidaire représente aujourd’hui en France 220 000 employeurs et plus de 2,5 millions
de salariés. Par leurs activités, les entreprises et associations du secteur peuvent
concerner encore davantage de personnes. Ainsi la Fédération nationale de la Mutualité
française revendique 38 millions de sociétaires et les banques coopératives ou
mutualistes, comme les caisses d’épargne ou le Crédit agricole, détiennent des millions
de comptes de clients ou d’usagers. Il ne fait pas doute que la mutualité et la coopération
sont à l’origine d’un profond mouvement social dont la portée historique demande
encore à être précisée. .
Cette diversité même peut faire débat dans la mesure où elle n’est pas exempte de
dérives du fait du rôle grandissant de la finance et de la « marchandisation » de la
société. En réaction à cette évolution, à plusieurs reprises, l’économie sociale et solidaire
est apparue comme une perspective de renouveau d’une vision autre de la société. En
période de crise particulièrement, les valeurs humanistes de l’économie sociale et
solidaire peuvent porter d’autres choix que ceux induits par l’économie de marché et la
financiarisation de la société.
À l’heure où l’économie sociale et solidaire paraît trouver une nouvelle légitimité,
consacrée notamment par la création en France en 2012 d’un ministère délégué ou
encore par la décision de l’assemblée générale de l’ONU de faire de 2012 l’année
internationale des coopératives, il a paru opportun de porter des regards historiens sur
les diverses composantes de cette économie sociale et solidaire en plein renouvellement.
Dans cette perspective, une rencontre nationale et internationale sera organisée les 2
et 3 octobre 2014 à Rouen par le Groupe de Recherche d’Histoire de l’université de
Rouen (GrHis, EA 38 31) et le Comité d’Histoire économique et sociale de Rouen et sa
région, en liaison avec différentes instances régionales ou nationales. Ce colloque
recevra aussi l’appui de différentes associations et entreprises appartenant au secteur
de l’économie sociale et solidaire.
Ainsi conçu ce colloque se propose d’explorer l’histoire des formes d’économie
sociale et solidaire à Rouen et dans sa région du XIXe siècle à nos jours. On s’interrogera

notamment sur le rôle pionnier joué, à l’échelle régionale, par certaines entreprises et
institutions de l’économie sociale. On tentera de mesurer et d’analyser le
développement particulièrement marqué des formes d’économie sociale et solidaire à
l’échelle de Rouen et de sa région, tout en s’efforçant de comparer cette histoire avec
celle d’autres régions en France et à l’étranger. L’hypothèse principale du colloque
consiste à vérifier ou non la réalité historique de véritables « districts de l’économies
sociale et solidaire », au sens où l’on parle de « districts industriels » (Alfred Marshall,
1890).
Dans cette optique, trois axes de recherche, non exclusifs, semblent pouvoir
structurer l’organisation du colloque :
- Dans quelle mesure l’échelle locale et régionale est-elle pertinente pour l’histoire de
l’économie sociale ? On s’interrogera en particulier sur l’existence d’autres régions, en
France et à l’étranger, historiquement marquées par le phénomène coopératif et
mutualiste, comme le Nord, le Jura, l’Alsace, la Champagne ou encore les Charentes mais
aussi, par exemple, le Limbourg belge, les cantons alémaniques suisses, la vallée de
Mondragón au pays basque ou le pays de Bade en Allemagne. À cette échelle locale et
régionale, quels sont les secteurs d’activité qui ont historiquement concentré à Rouen et
dans sa région, mais aussi dans d’autres régions françaises ou étrangères, le
développement des expériences d’économie sociale et solidaires ? Quelles sont les
formes d’économie sociale dominante (coopération ou mutualisme) ?
- quels sont les facteurs culturels, politiques, économiques et sociaux de
l’implantation et de l’essor des entreprises de l’économie sociale à Rouen et dans sa
région ? En comparaison, quels sont les facteurs à l’origine du développement du secteur
mutualiste dans d’autres régions de France et à l’étranger ? Un modèle historique et
territorial de développement commun aux différentes formes d’économie sociale peut-il
est dégagé ? Ce modèle est-il historiquement rattaché à des modalités de gouvernance
spécifiques ?
- quel bilan peut-on dresser de la croissance du secteur de l’économie sociale à Rouen
et à l’échelle des autres régions de l’économie sociale et solidaire, sur plus de deux
siècles ? Que nous enseigne l’histoire de ce secteur sur sa capacité réelle à amortir la
conjoncture et à préserver la cohésion sociale, notamment en temps de crise ?
Modalités pratiques de l’appel à contributions :
Langues de travail : Français et Anglais
Les projets de communications (titre de la contribution, présentation d’une page,
comportant la mention des sources envisagées, court CV) doivent être envoyés avant le
16 décembre 2013 à Audrey Delauney : [email protected]
Le résultat de l’évaluation scientifique des propositions de contribution par le comité
d’organisation scientifique sera connu le 15 janvier 2014.

Le comité d’organisation prendra en charge le financement des déplacements à Rouen
pour le colloque et l’hébergement des contributeurs pendant la durée du colloque.
Comité d’organisation scientifique
Olivier Feiertag, Yannick Marec et Nicolas Plantrou
Secrétariat scientifique
Audrey Delauney : [email protected]
Comité scientifique
Carole Christen-Lécuyer, Michel Dreyfus, Olivier Feiertag, André Gueslin, Yannick
Marec, Martin Petitclerc (Université du Québec à Montréal), Nicolas Plantrou, Daniel
Reger (université du Havre), Patricia Toucas-Truyen, Nadine Vivier
1
/
3
100%