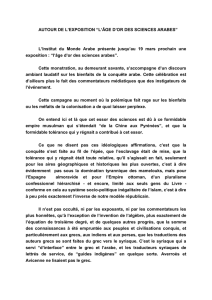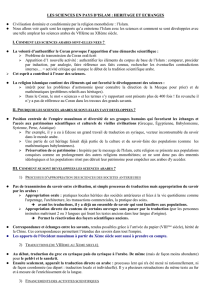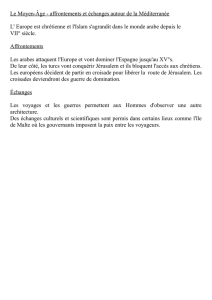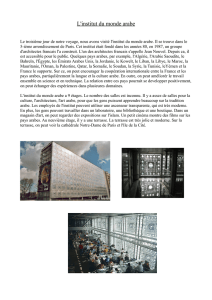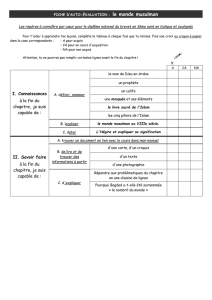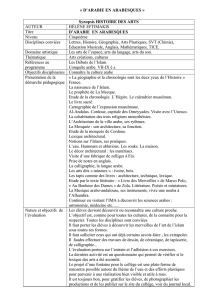Universalité et localité dans les pratiques

http://revel.unice.fr
AVERTISSEMENT
Les publications du site REVEL sont protégées par les dispositions générales du Code de la propriété intellectuelle.
Conditions d'utilisation - respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle
L'accès aux références bibliographiques et au texte intégral, aux outils de recherche ou au feuilletage de l'ensemble des revues est libre,
cependant article, recension et autre contribution sont couvertes par le droit d'auteur et sont la propriété de leurs auteurs.
Les utilisateurs doivent toujours associer à toute unité documentaire les éléments bibliographiques permettant de l'identifier correctement
et notamment toujours faire mention du nom de l'auteur, du titre de l'article, de la revue et du site Revel. Ces mentions apparaissent sur la
page de garde des documents sauvegardés sur les postes des utilisateurs ou imprimés par leur soin.
L'université de Nice-Sophia Antipolis est l'éditeur du portail REVEL@Nice et à ce titre détient la propriété intellectuelle et les droits
d'exploitation du site.
L'exploitation du site à des fins commerciales ou publicitaires est interdite ainsi que toute diffusion massive du contenu ou modification
des données sans l'accord des auteurs et de l'équipe Revel.
Pour citer cet article :
Ahmed Djebbar,
" Universalité et localité dans les pratiques scientifiques des pays d’Islam ",
Alliage, n°55-56 - Mars 2004, , ,
mis en ligne le 06 août 2012.
URL : http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3590
Voir l'article en ligne

Universalité et localité dans les pratiques
scientifiques des pays d’Islam
Ahmed Djebbar
Historien des sciences, professeur à l’université des sciences et
techniques de Lille
fr
35-42
Je souhaite aborder, à travers un certain nombre de points, la question des sciences en pays
d’Islam et ce qu’elles ont impliqué comme types d’attitudes, de relations et de discours. Mais
auparavant, il me paraît utile de rappeler quelques éléments pouvant éclairer le contexte
historique de ces activités.
Il faut d’abord préciser que les historiens arabes ne commencent à parler de science dans la
cité islamique qu’à partir du dernier tiers du VIIIe siècle, c’est-à-dire plus d’un siècle et demi
après la constitution, à Médine, du premier embryon d’État musulman. Nous ne sommes donc
pas informés sur cette longue période de maturation et sur les multiples influences qui ont pu
créer les conditions psychologiques en faveur d’une activité scientifique profane à côté des
activités religieuses, littéraires et poétiques. Comme on va le voir, le contenu et les premières
orientations de la tradition scientifique arabe permettent d’avancer des hypothèses
raisonnables sur cette question.
Le modèle de la science arabe
Le premier point que je voudrais aborder concerne le modèle de la science arabe à travers
l’ensemble des pratiques scientifiques connues, appliquées entre le VIIIe et le XVe siècle. Grâce
aux recherches menées dans ce domaine, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, nous avons
suffisamment d’informations pour comprendre les mécanismes de cette pratique scientifique,
ses spécificités et ses effets sur les pratiques ultérieures. Cette longue tradition, ayant
concerné de nombreux pôles dispersés dans l’immense empire musulman, possédait quelques
particularités que je voudrais souligner ici.
En premier lieu, il s’agit d’une tradition scientifique bâtie à partir de différentes sources,
essentiellement indienne et grecque, pour celles qui ont circulé à travers des traductions
d’ouvrage, mais également babylonienne, égyptienne et locales, pour celles parvenues aux
Arabes par des canaux autres que les supports écrits.
En deuxième lieu, les acteurs de ces pratiques scientifiques ont appartenu à une cité
caractérisée par la diversité et la richesse confessionnelle, ethnique, culturelle et linguistique.
Mais les producteurs et les diffuseurs de la science, dans leur très grande majorité, ont
exprimé leur savoir dans une seule langue, l’arabe, qui aura, du IXe au XIe siècle, le quasi
monopole de la production scientifique. À partir du XIIe siècle, trois autres langues
commencent, au contact de l’arabe, à se manifester dans le domaine des sciences, après avoir
été très actives dans d’autres domaines, comme la théologie, la littérature ou la poésie. Il
s’agit d’abord du persan et de l’hébreu, à l’intérieur même de la cité islamique, puis du latin,
en Italie et en Espagne.
En troisième lieu, les conditions de création et de développement des sciences, au cours
des siècles de créativité, ne sont pas différentes de ce qui a été observé pour des traditions
scientifiques antérieures : une partie des activités a été stimulée par des demandes formulées
dans le cadre de la vie quotidienne à travers ses deux dimensions, religieuse (répartition des
héritages, calcul du temps, calendrier lunaire) et profane (comptabilité, architecture). Mais la

plus grande partie est le fruit de préoccupations exclusivement scientifiques, nourries par le
contenu du patrimoine scientifique antérieur et motivées par le désir de résoudre des
problèmes, ceux laissés en suspens et d’autres complètement nouveaux.
La science arabe entre localité et universalité
Le deuxième point concerne les notions de localité et d’universalité telles qu’elles ont pu
se manifester, avant et pendant le développement de la science arabe, à travers les
phénomènes de rejet de l’autre et de sa culture, volonté de domination, résistance au
changement, mais également à travers les phénomènes d’écoute, symbiose culturelle,
recherche du savoir de l’autre. Je vais en donner quelques exemples reflétant la dualité que je
viens d’évoquer. Peu importe que les évènements ou les paroles rapportés soient tous
authentiques. Ce qui nous intéresse ici, c’est que, éléments d’une mémoire collective, ils
permettent de mieux appréhender l’importance et le poids des symbioses culturelles qui ont
pu exister à des moments donnés et dans des espaces particuliers de cet immense empire.
Le premier exemple est le suivant : on lit dans la chronique de la vie du Prophète que,
quelques années avant 632, il a dicté à son secrétaire une lettre pour l’empereur de Byzance.
Dans cette lettre, il le menaçait de lui déclarer la guerre s’il ne se convertissait pas à l’Islam.
La lettre, si elle a réellement existé, a dû faire sourire le puissant empereur de Byzance, qui
d’ailleurs ne daigne pas répondre. Mais au-delà de la menace, il faut voir dans cette initiative
du Prophète à la fois une volonté de soumettre les autres à la nouvelle religion et à sa vision
du monde, et l’expression d’une confiance inébranlable dans les capacités de ses partisans de
réussir dans la réalisation de ce projet.
Deux siècles plus tard, c’est-à-dire entre 813 et 833, le calife al-Ma’mûn aurait fait un rêve.
Mais bizarrement, lui, chef de la nouvelle religion, représentant du Prophète sur la Terre, il
n’aurait pas vu dans son rêve le visage de Mahomet. Il aurait vu un personnage à la barbe
blanche, aux yeux bleus, au visage empreint d’une grande sérénité, et aurait reconnu en lui le
philosophe Aristote. Le bibliographe Ibn an-Nadîm qui rapporte cette anecdote ajoute même
que c’est à partir de ce rêve qu’al-M’amûn aurait ordonné l’ordre d’envoyer une mission à
Byzance pour emprunter des manuscrits scientifiques et philosophiques grecs dans le but de
les faire traduire en arabe et d’en faire ainsi profiter certains de ses sujets.1
Ces témoignages peuvent être complétés par d’autres éléments, basés sur des faits vrais ou
sur des reconstructions ultérieures scrupuleusement rapportés par les historiens, qui reflètent
cette dualité dans les attitudes et les décisions.
On sait, par exemple, que parmi les milliers de paroles importantes attribuées au Prophète,
certaines concernent la science et méritent donc d’être évoquées ici, même si leur authenticité
n’est pas toujours admise par les spécialistes. L’une de ces paroles encourage la quête du
savoir en ces termes : « Recherchez la science, même en Chine. » Comme, aux yeux des
croyants, la Chine est un pays d’infidèles, cette phrase signifie, dans une exégèses positive,
qu’il faut aller vers l’autre, même s’il ne partage pas les mêmes valeurs, et profiter de ses
connaissances, de son expérience et de son savoir. Mais à l’opposé de cette phrase, une autre,
également attribuée au Prophète, affirme ceci : « Allah, protège-moi d’une science inutile. »
C’est dans ce contexte de témoignages divergents et parfois contradictoires que va se créer
une dynamique scientifique et se développer, dans le même temps, deux attitudes plus ou
moins antagoniques : la première, que je qualifierai d’offensive, était en faveur de l’écoute de
l’autre, de la recherche du savoir de l’autre. La seconde, plutôt défensive, allait dans le sens
du rejet de l’autre, de sa culture et de son savoir. Ce double comportement n’a jamais cessé
d’exister, mais selon un rapport de force très fluctuant. En fonction des moments, des conflits,
des intérêts, l’une ou l’autre de ces deux tendances l’a emporté.
1. Voir, dans ce numéro, l’article de Michel Kaplan « La connaissance réciproque au temps du calife al-
Mamoun », pp. ?

Ainsi, de la fin du VIIIe siècle à la fin du XIe, a prévalu la tendance à l’ouverture qui. Elle
nous a donné les sciences arabes, c’est-à-dire philosophie, mathématiques, physique,
astronomie, etc. Pourtant, au même moment, une opinion plus ou moins vigoureuse affirmait
que la vraie science est uniquement ce qui doit valoriser ou aider à appliquer la parole de
Dieu, à savoir l’exégèse du Coran, l’authentification et les commentaires des paroles du
Prophète, l’élaboration du Droit musulman et l’étude de la langue arabe. Pour cette opinion, le
reste des activités intellectuelles était superflu, inutile ou, dans le meilleur des cas, non urgent.
Toutefois ce reste, les sciences des Anciens comme on disait alors, a fini par s’imposer car la
société nourrissait une dynamique en sa faveur.
À partir du XIIIe siècle, la position que j’ai qualifiée de défensive, va réellement
commencer à se renforcer avant de s’imposer définitivement à la fin du XVe avec, en
conséquence, un ralentissement de la recherche et un appauvrissement du contenu des
enseignements de certaines disciplines, philosophie, mathématiques et astronomie.
La dynamique de la science
Le troisième point que je souhaitais brièvement aborder concerne les faits illustrant le
premier phénomène, celui qui a consisté à écouter les autres, profiter de leurs savoirs,
l’assimiler puis l’enrichir. Il en est résulté le processus d’appropriation de la science et du
savoir-faire des civilisations antérieures, à travers deux canaux, celui des traductions et celui
de l’acquisition directe à l’aide de l’enseignement et de quelques pratiques spécialisées
(répartition des héritages, arpentage, comptabilité, architecture, etc.). Ainsi a-t-on commencé
à traduire, étudier, commenter et enseigner, sans le moindre tri.
Puis, à mesure que les se développaient activités intellectuelles, un sentiment de
particularisme a commencé à s’exprimer à propos de l’art et de la culture des autres. En
particulier, on ne s’est pas intéressé à la littérature grecque et moins encore au drame et à la
comédie. On sait, par exemple, que les Arabes ont connu l’Iliade et l’Odyssée. On dit même
que ces œuvres majeures ont été traduites, mais ces traductions n’ont eu aucune postérité dans
l’histoire de la littérature arabe. Il y a bien sûr des exceptions, comme les fables indiennes de
Kalila wa Dimna, car les Perses les avaient traduites avant l’avènement de l’Islam et qu’elles
avaient à leurs yeux un caractère universel puisque c’étaient des fables. Mais d’une manière
générale, tout ce qui était spécifique et, surtout, lié à la culture et à l’idéologie des autres
peuples, n’a pas été retenu par les Arabes.
Dans le même temps, on sait qu’ils ont cherché le moindre petit texte de mathématique,
d’astronomie ou d’astrologie grecques, indiennes et babyloniennes. Ils ont cherché la moindre
petite phrase d’Archimède, Aristote et Euclide. Ils ont même attribué certains textes
anonymes à Pythagore, Euclide, Archimède et Aristote. On les soupçonne également d’avoir
fabriqué des textes et de les avoir prêtés à certains de ces auteurs. Ainsi, grâce à leur statut de
meilleurs et même parfois d’uniques connaisseurs des textes grecs, ont-ils élevé des écrits
anonymes au rang d’écrits d’Aristote, Euclide ou Archimède. Plus tard seulement, et grâce à
l’histoire des textes et à l’étude comparative de leurs contenus, on a pu distinguer
l’authentique de ce qui ne l’était pas. Tous les écrits qui se sont avérés avoir bénéficié d’une
fausse attribution ont dès lors été qualifiés de pseudo. Il y a donc aujourd’hui des pseudo
Euclide, des pseudo Aristote, etc. Ces textes ont d’ailleurs circulé jusqu’au début du XIIe
siècle, date à laquelle les premiers traducteurs de latin ont commencé à les traduire en les
imputant, eux aussi, aux auteurs déjà évoqués.
On a donc beaucoup traduit. Mais on a fait autre chose : on a cherché ce qui n’existait pas
dans les textes mais dans la pratique des individus et des groupes, devenus sujets de l’Islam.
Or, cela aurait été impossible si les musulmans avaient conquis des populations totalement
marginalisées et sans grande tradition scientifique. Mais on le sait, les premier musulmans ont
eu la chance de d’abord conquérir les zones les plus civilisées, ou parmi les plus civilisées,

c’est-à-dire le Croissant fertile, la Perse et l’Égypte. Ces trois régions furent des
conservatoires pour la science parce que, du IIIe au VIIe siècle, elles ont été un réceptacle et un
carrefour des savoirs grecs, indiens, babyloniens, et peut-être chinois (indirectement, à travers
le relais indien).
Ce n’est donc pas par hasard que les traductions ont été effectuées là. Ce n’est pas par
hasard, non plus, que la science arabe a commencé avant même les traductions, parce que l’on
avait pu récupérer des savoir-faire et commencé par utiliser des textes déjà traduits du IIIe au
VIIe siècle, du grec au syriaque. Cette dernière langue a même été une langue scientifique dans
l’Empire musulman parallèlement à la langue arabe un siècle durant. Pour prendre l’exemple
de la médecine, on sait qu’une partie du corpus galénique et hippocratique était déjà en
syriaque et utilisé dans cette langue par les médecins les plus importants du VIIIe et du début
du IXe siècle. La traduction du syriaque à l’arabe, ou directement à partir du grec, n’a eu lieu
que plus tard.
Il y a donc eu une appropriation d’un savoir enseigné et non écrit. En particulier, on ne
peut comprendre l’avènement de deux nouvelles sciences, algèbre et trigonométrie, sans tenir
compte du fait que certaines connaissances des peuples anciens, en particulier indien, chinois
et babylonien, étaient connues grâce à des pratiques déjà en honneur dans les villes du
Croissant fertile avant l’avènement de l’Islam.
Voici d’ailleurs ce que disait, à propos de ce savoir non grec, l’intellectuel syriaque du VIIe
siècle Sévère Sébokht, astronome et théologien :
« Je ne parle pas de la science des Indiens qui ne sont pas syriaques ni de leurs
inventions subtiles dans leur science de l’astronomie, plus ingénieuse que celle des
Grecs et des Babyloniens, ni de leur méthode de calcul et de comptage qui utilise
neuf signes. S’ils avaient connu cela, ceux qui croient être parvenus seuls à la limite
de la science, parce qu’ils parlent grec, seraient peut-être convaincus, bien qu’un peu
tard, qu’il y en eut aussi d’autres qui savent quelque chose, non seulement des Grecs
mais aussi des hommes de langues différentes. Je ne dis pas cela pour mépriser la
langue grecque, mais pour montrer que la science est commune. »
En conclusion, je dirai quelques mots sur deux conséquences de l’attitude défensive qui a
commencé à se développer à partir du XIIIe siècle, quand va prévaloir l’idée de refuser l’autre,
de ne pas échanger, de s’enfermer, de limiter le champ des connaissances et de la pratique
scientifique. La première fut celle de ne pas prendre conscience des phénomènes nouveaux
qui apparaissaient en Europe, et plus particulièrement celui d’un intérêt croissant pour les
activités scientifiques. L’incapacité à juger objectivement les autres n’a pas permis aux
observateurs de l’Empire musulman de voir qu’en Europe s’établissaient les conditions
favorables à un développement de la science. Enfermés dans leur mentalité de sujets d’une
grande puissance et leur vision de l’Europe héritée du IXe siècle, ces observateurs ne
pouvaient donc imaginer qu’il serait utile de transmettre le flambeau. Ils ne l’ont d’ailleurs
pas fait. Néanmoins, on persiste à dire que les Arabes ont transmis la science à l’Europe alors
qu’il faudrait plutôt parler d’appropriation de cette science par les Européens. Cela
commença, on le sait, à Salerne d’abord, avec la traduction d’ouvrages médicaux arabes
d’Orient et du Maghreb, puis s’est poursuivi à Tolède, avec les traductions de l’arabe à
l’hébreu et au latin. Les acteurs du moment purent ainsi vivre une véritable symbiose
culturelle, la pratique de la traduction amenant des hommes de langues et de confessions
différentes à se regrouper autour d’un même projet, en apportant chacun la maîtrise de sa
langue et la connaissance de la langue de l’autre. Ainsi est-il arrivé de voir un Juif et un Arabe
d’Espagne unir leurs efforts à ceux d’un Européen du Nord pour effectuer la traduction d’un
ouvrage de l’arabe au latin, en passant par la langue vernaculaire.
1
/
5
100%