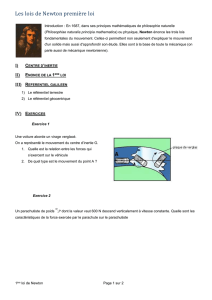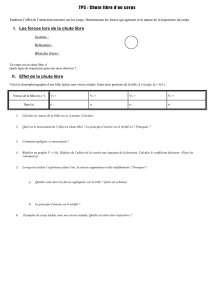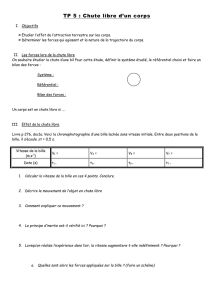Correction de l`interro 1 de seconde

2nde CORRECTION
Physique – Interrogation 1
EXERCICE I
1. L'état de mouvement ou de repos d'un corps dépend du référentiel choisi.
2. La trajectoire d'un corps est la ligne que décrit un point de ce corps au cours de son mouvement. Elle dépend du référentiel
choisi.
3. Si le mouvement d'un corps est modifié, c'est qu'il est soumis à une (ou plusieurs) forces (ou interactions mécaniques).
La valeur d'une force s'exprime en newton. L'appareil de mesure est un dynamomètre.
EXERCICE II
1. Le pilote de l’hélicoptère est en mouvement par rapport au conducteur du TGV OUI NON
2. Benjamin est en mouvement par rapport au conducteur du TGV. OUI NON
3. Aurélie est en mouvement par rapport au sol . OUI NON
4. Le pilote de l’hélicoptère est en mouvement par rapport à Benjamin. OUI NON
5. Aurélie est en mouvement par rapport au pilote de l’hélicoptère. OUI NON
Exercice III
1. Lors d'un trajet, la vitesse moyenne se calcule en divisant la distance parcourue d par la durée du parcours Δt:
vmoyenne = d
t
.
Dans le cas de notre automobiliste, la distance parcourue est de 100 km soit 100 000 m = 105 m et la durée du parcours en soustrayant
l'heure de départ à l'heure d'arrivée :
t = tArrivée−tDépart = 14H50−14H02 = 48 mn = 48 × 60 s = 2880 s.
Exprimée en mètre
par seconde (m.s-1), la vitesse moyenne de l'automobiliste est donc de
vmoyenne = d
t = 105
2880 = 34,7 m.s−1.
Pour l'exprimer en kilomètre par heure (km.h-1), le plus simple est de se souvenir qu'un mètre par seconde correspond à 3,6 kilomètre par
heure. Ainsi on obtient
vmoyenne = 34,7 × 1 m.s−1 = 34,7 × 3,6 km.h−1 = 125 km.h−1.
Une autre solution consiste à repartir de la définition, d'exprimer d en km (c'est déjà fait en plus ;o)) et d'exprimer Δt en heure. Mais
attention car les horaires ne sont pas basés sur un système décimal mais sur un système hexagésimal, une base 60 et non une base 10. Il
est donc incorrect d'écrire 48 mn = 0,48 h comme vu dans de trop nombreuses copies. Il faut juste se souvenir que dans une heure il y a
60 minutes et calculer le rapport 48/60 = 4/5 h. La vitesse moyenne exprimée en heure vaut donc
vmoyenne = d
t = 100
4
5
= 100×5
4 = 125 km /h−1.
2. Non, ce résultat n'est pas contradictoire avec un un excès de vitesse à un moment du trajet car ce que nous avons calculé est une vitesse
moyenne (en moyenne, sur l'ensemble du trajet, il a roulé à 125 km.h-1). Sauf s'il dispose d'un régulateur de vitesse, il n'a pas pu être en
permanence à exactement 125 km.h-1. Parfois il a pu rouler à moins de 100 km.h-1, et au moins une fois il a roulé à 158 km.h-1. En effet,
un radar ne mesure pas la vitesse moyenne mais la vitesse instantanée (la vitesse à un instant donné).
EXERCICE IV
1. Une chronophographie est réalisée en capturant sur un même support plusieurs images d'un même mouvement effectuées à intervalle de
temps régulier.
2. Dans la première phase (du premier au 9ème point), les points sont de plus en plus espacés. Puisque entre deux points successifs, le même
temps s'écoule, on visualise aisément sur cette chronophotographie, l'évolution de la vitesse. Pour la première phase, c'est donc un
mouvement rectiligne (car en ligne droite) et accéléré (car les points sont de plus en plus espacés).
Dans la seconde phase (du 9ème point au 18ème point ), les points sont régulièrement espacés. C'est donc un mouvement rectiligne (car en
ligne droite) et uniforme (car les points sont espacés de manière régulière).
Dans la dernière phase (du 18ème au dernier point), les points sont de moins en moins espacés. Pour cette phase, c'est donc un mouvement
rectiligne (car en ligne droite) et décéléré (car les points sont de moins en moins espacés).
Exercice V
1. Diagramme objets-interactions : Voir ci-contre.
2. Pour déterminer les trois forces qui agissent sur la bille, il faut se placer dans « la peau » de la
bille et ressentir ce qu'elle perçoit. On détermine alors aisément la force magnétique due à
l'aimant , la force gravitationnelle (le poids) due à la terre et la force due au fil qu'on appelle
généralement la tension du fil (attention à ne pas confondre,avec la tension électrique ;o))
3. Voir ci-contre.
Téléchargé sur http://gwenaelm.free.fr/gest2classe
Terre
Aimant
Fil
Bille
T
P
F
A. : Fil
P.A. : point de contact fil-bille
D. : celle du fil
S. : vers le fil
A. : Aimant
P.A. : centre d'inertie de la bille
D. : horizontale
S. : vers l'aimant
Auteur : Terre
Point d'Application : centre d'inertie de la bille
Direction : horizontale
Sens : vers l'aimant
1
/
1
100%