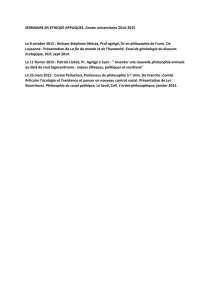La philosophie et la littérature

1
Philosophie et littérature
Texte de la conférence de Carole Talon-Hugon, le 1er Juin à la Baume les Aix
Il est courant d’opposer l’art - la littérature par exemple - et la philosophie, comme nous opposons, tout
aussi spontanément, le mythe et la philosophie, le mutos et le logos. Et à bien des égards, c’est avec raison qu’il
faut les opposer, puisque la philosophie est du côté du conceptuel, de l’argumentatif, du démonstratif, alors que
l’art n’est pas de ce côté-là. Il y a bien un écart entre les deux, un écart net. Et cet écart, il faut le maintenir. Il
faut le maintenir contre un certain nombre de tentatives - peut-être de tentations - qui existent depuis le
Romantisme, en particulier depuis ce qu’on appelle le premier romantisme, le romantisme allemand de Iéna, qui
est sans doute le moment le plus net au cours duquel des penseurs ont voulu faire de l’art une philosophie.
Vouloir faire de l’art une philosophie, cela signifie qu’ils ils croyaient en une philosophie de l’Art, non pas au
sens d’une philosophie qui parlerait de l’Art, qui réfléchirait sur l’Art, mais une philosophie qui sourdrait de
l’Art, qui procèderait de l’Art. Et cette philosophie de l’art, soutient même Le Romantisme, est supérieure à la
philosophie classiquement conçue.
Affirmer cela, c’est s’opposer à toute une série de conceptions de l’art. Par exemple à celle qui avait
cours dans l’Antiquité, à une époque où l’art et l’artisanat étaient encore extrêmement liés, voire confondus, et
selon laquelle l’art est une activité productrice et non une entreprise métaphysique. Ou bien encore à la
conception de l’art comme divertissement agréable. Les romantiques soutiennent que l’Art n’est pas affaire de
jeu, de plaisir sensible, d’ornement, mais qu’il est une activité beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde
puisque, comme le dit, entre autres auteurs Novalis, la poésie a pour tâche d’accomplir la philosophie. Et quand
Novalis dit « la poésie », il faut entendre ce mot dans un sens élargi ; non pas seulement la poésie dans un sens
étroit, mais, plus largement, la littérature. Friedrich Schlegel, de la même façon, appelle de ses vœux ce qu’il
appelle l’union totale de la philosophie et de la poésie et parle de « la nécessité de la connaissance qui amène la
philosophie a la poésie ». Tout ceci se concrétise en 1802, dans sa Philosophie de l’art qui précisément entend
être une compréhension de tout l’univers par l’Art.
Je pense que cette position qui affirme que l’Art est la philosophie, et même, comme on vient de le voir
dans ses versions les plus radicales, qu’il est la philosophie la plus aboutie, a un de coût théorique tout à fait
exorbitant. En effet, accepter cette idée, c’est affirmer que la philosophie n’est pas une méthode d’investigation
rationnelle, qu’elle n’est pas affaire de pensée discursive, qu’elle ne travaille pas les concepts, mais qu’elle est
quelque chose comme un savoir intuitif, absolu. Autrement dit, c’est refuser la philosophie telle qu’elle est
traditionnellement définie depuis Socrate et Platon. Prétendre ainsi à l’assimilation de l’art et de la philosophie -
et notamment de la poésie et de la philosophie - aboutit donc à une dissolution de la philosophie.
Mais dire que l’Art n’est pas la philosophie, ne signifie par pour autant en faire l’Autre de la
philosophie, son opposé ou son contraire. C’est ce qui se passe lorsqu’on considère que l’art est avant tout une
affaire d’émotion esthétique, de plaisir de la sensibilité, de divertissement agréable. Théophile Gautier, dans la
préface de son roman Mademoiselle de Maupin, devenu le manifeste du mouvement de « l’Art pour l’Art »,
soutient que l’écrivain peut et doit, même en présence des intérêts humains les plus élevés, ne s’occuper que de
forme, de rythme, de style ; il ne doit, lorsqu’il fait de l’art, ne viser que l’art. Autrement dit, il ne faut pas que

2
l’artiste s’occupe de morale, de politique, ou de religion ; qu’il serve le prince, l’état, l’église, ou quelque cause
révolutionnaire que ce soit. Baudelaire exprime autrement la même idée lorsqu’il déclare : « La poésie n’a
d’autre but qu’elle-même. Aucun poème ne sera grand, ni si noble, si digne du nom de poème, que celui aura été
écrit pour le seul plaisir d’écrire un poème ».
A un moment de l’histoire dont nous sommes toujours les héritiers et qui correspond en gros au 19ème
siècle, s’est ainsi développée l’idée d’autonomie de l’art, mais aussi celle d’autotelie de l’Art (du mot grec telos,
qui signifie le but) : le but de l’art, c’est l’art. La revendication d’autonomie et d’autotélie de l’art, a généré un
intérêt pour la forme, au détriment des contenus. En effet, si on prend en compte ce qui est représenté, par
exemple dans une œuvre plastique, c’est-à-dire son sujet, ou bien le contenu d’un roman ou d’un poème, on
court toujours le risque d’être dans l’hétéronomie, c’est-à-dire de sortir de ce qui est proprement artistique dans
l’art ; en revanche, si on s’en tient à la forme, on est au cœur de ce qui est proprement artistique.
Parmi beaucoup d’autres, le théoricien de l’art Konrad Fiedler affirme que c’est la forme qui doit
constituer ce en quoi l’œuvre d’art existe. C’est ce que soutient Flaubert lorsqu’il écrit qu’« Yvetot vaut
Constantinople » ; il veut signifier que le sujet de l’œuvre est inessentiel, qu’il n’est finalement qu’un prétexte
pour réaliser une œuvre formellement parfaite, si bien qu’une description d’ Yvetot, petite ville banale de
Normandie, n’est pas moins remarquable que la description de l’extraordinaire Constantinople. Les mouvements
formalistes qui s’ensuivent, par exemple le formalisme russe du 19ème et du début du 20ème, insistent sur l’idée de
« littérarité ». Le mot désigne le proprement littéraire de la littérature, à savoir l’usage très particulier qui y est
fait de la langue. Contrairement à l’usage ordinaire dans lequel la langue est un moyen de communication, un
médium transparent, elle est considérée en tant que matière sensible que le poète ou le romancier travaille
comme le peintre travaille ses pigments. Le titre d’un poème de Mallarmé exprime ça de façon extraordinaire ; je
veux parler du « Sonnet allégorique de lui-même ». L’allégorie est une figure stylistique qui lie une chose
sensible et une idée abstraite ; l’allégorie de la charité par exemple, représente ainsi une vertu sous les traits
d’une femme. C’est dire que la chose renvoie à un sens hors de la chose. Or, parler d’un sonnet « allégorique de
lui-même », c’est précisément soutenir que son sens ne doit pas être cherché hors de lui. C’est affirmer
l’autotélie de l’Art. On retrouve la même idée lorsque Sartre, dans Qu’est-ce que la littérature ? parle de l’intérêt
du poète pour les mots « dans leur visage de chair » ; il signifie que ce qui est important pour lui dans le mot
n’est pas son sens, mais ses sonorités, sa graphie, son rythme propre, etc.
La même chose vaut pour la peinture. Manet, par exemple, en peignant L’asperge rompt radicalement
avec la peinture académique qui mettait les sujets de l’histoire tout en haut de la hiérarchie de la peinture ;
peindre une asperge, c’est peindre l’ordinaire et l’insignifiant. Mais cela n’est plus un défaut quand on soutient
que le sujet, précisément, est sans importance intrinsèque et qu’il n’est que prétexte à la peinture.
Telle est la conception esthétique de l’art qui tend à réduire l’art à l’esthétique, à limiter l’expérience de
l’art à une expérience esthétique et qui considère que la finalité de l’œuvre est de produire un certain type,
particulier, de satisfaction.
Cette deuxième perspective, radicalement opposée à la première puisqu’elle maintient une distance radicale
entre l’art et la philosophie - et notamment entre la littérature et la philosophie-, n’est pas plus satisfaisante que
la première. Elle n’est pas tenable au moins pour trois raisons, que je vais considérer tour à tour.

3
La première est qu’elle prétend dire une essence de l’art que dément l’intention qui a présidé à l’écriture
de l’écrasante majorité des œuvres littéraires (pensons seulement à L’Epitaphe Villon, à Médée, ou à
toutes les pièces de Racine). Elle contredit tout autant à l’intention qui a présidé à toute la peinture
médiévale et renaissante qui était, très majoritairement une peinture religieuse. Il est bien évident que
lorsqu’on peint une Descente de croix ou une Déposition, on ne peint pas un sujet prétexte. Cette vision
esthétique de l’Art contrevient à ces intentions et s’il est souhaitable de lire « Azur », de Mallarmé,
comme la thèse de l’expérience esthétique le demande, il n’est pas pertinent de considérer une Nativité
comme un tapis persan, c’est-à-dire comme un ensemble de couleurs et de formes, assemblées d’une
manière particulière.
Le second défaut de cette position est qu’elle conduit à dissoudre des genres littéraires entiers. Par
exemple, la notion de tragédie, perd toute espèce d’application possible si on perd de vue le rapport au
contenu. Benedetto Croce, philosophe et théoricien de l’Art italien, défendait une position formaliste
extrême lorsqu’il déclarait : « Il y a autant de sens à juger immorale la Francesca de Dante ou morale la
Candela de Shakespeare qu’à juger moral le carré ou immoral le rectangle ». Le problème est que si on
ne fait pas intervenir de telles considérations extra esthétiques (en l’occurrence des considérations
éthiques), on est face à un objet littéraire non identifié ; à un poème si on veut, mais certainement pas à
une tragédie.
Enfin et peut être surtout, l’expérience esthétique préconisée n’est pas réalisable ou très difficilement
réalisable lorsqu’on a à faire à de la littérature, et ce pour cette raison très simple : parce que, avant
d’être des choses, les mots désignent des choses. Autrement dit, ils sont, par nature, signifiants.
L’opacification du langage montre rapidement ses limites.
Donc, si on exclut ces deux conceptions antithétiques de l’art, à la fois celle qui prône l’assimilation totale
de la philosophie et de la littérature, et celle qui défend leur exclusion réciproque, quelle position adopter ?
Je soutiens que l’art n’est pas plus la philosophie, qu’il est l’Autre de la philosophie : que certaines œuvres,
celles qui, selon l’expression de Kant dans la Critique de la façon de juger, « ont une âme », ont une dimension
spirituelle, et que certaines œuvres - littéraires en particulier - produisent des effets cognitifs, des effets
intellectuels, des effets spirituels, et sont un véritable principe vivifiant pour l’esprit. Comment être tout cela à la
fois, sans être de la philosophie, ni l’Autre de la philosophie ?
Dans sa Poétique Aristote affirme de façon à priori un peu étrange, que la poésie est plus philosophique que
l’histoire. Le mot « poésie » est à prendre ici au sens à large du mot, et désigne la choses littéraire en général, le
théâtre autant que les chants homériques. Que veut signifier Aristote ?
La discipline qu’on nomme histoire traite toujours d’événements particuliers ; elle parle du conflit qui a
opposé à tel moment tel et tel pays, alors que tel et tel souverains étaient au pouvoir. La poésie, elle, a au
contraire quelque chose d’universel. Pourquoi ? Parce que la poésie, la littérature en général a à faire à des
fictions, à des êtres et des événements fictionnels. Ulysse, Calypso, l’antre du cyclope, la guerre de Troie, sont
des fictions. Or, ces êtres de fiction, si on y réfléchit, ont un statut étonnant ; non seulement ils sont irréels, mais
encore ils sont incomplets. Je veux dire par là qu’un certain nombre de traits les décrivent, permettent de les
reconnaître, de se repérer dans l’histoire et de la suivre avec intérêt, mais, en même temps, il est très facile de

4
montrer que ce sont des entités incomplètes. Par exemple, on ne connaît pas la date de naissance d’Ulysse ; on ne
sait pas la taille de Pénélope ; l’un et l’autre personnages sont ce que les théoriciens de la littérature appellent des
réalités à peine esquissées. Ce qui conduit le lecteur à les compléter par l’imagination, au cours de cet acte qui
nous est très familier mais qui, quand on y réfléchit, est très extraordinaire, et qui s’appelle l’acte de lecture. Etre
lecteur, c’est prêter en quelque sorte son imagination à des signes figés sur le papier pour faire advenir des
personnages, et des événements et pour faire qu’une histoire ait lieu. Et dans cette incomplétude constitutive se
loge la possibilité de l’universel et de l’universalisable. Par exemple, la fidélité de Pénélope n’est pas tout à fait
la fidélité de notre voisin ou de notre cousine ; c’est, un peu, la Fidélité avec un « F » majuscule ; tout
simplement parce qu’elle n’est pas encombrée de traits, d’éléments, de micro événements, plus ou moins
contradictoires, qui, dans la vie réelle, viennent nécessairement parasiter la saisie de ces indices à partir desquels
nous parlons de fidélité. On pourrait prendre le même exemple avec Madame Bovary et l’adultère, évidemment.
En ce sens, la littérature donne à voir quelque chose dont Schopenhauer disait, mais dans un sens très
particulier, que c’était des essences. Par exemple, dans Un amour se Swann, Proust nous communique l’essence
de la jalousie, alors que, dans la réalité, les choses sont trop confuses et trop complexes pour qu’on en saisisse la
nature spécifique. La fiction procure donc à la littérature une dimension de l’universalisation tout à fait
extraordinaire qui permet, à juste titre, à Aristote, de dire que la poésie est plus philosophique que l’histoire. Cela
ne veut pas dire qu’elle est de la philosophie, mais qu’il y a quelque chose en elle qui intéresse la philosophie.
Deuxième chose à noter : en même temps qu’elle touche à l’universel, la littérature incarne ces universaux.
Elle donne corps aux propositions abstraites. Ainsi, La Case de l’oncle Tom n’est pas une réflexion
sur l’esclavage ; elle donne un visage particulier à cette notion. La littérature fait intervenir d’une manière très
particulière des concepts, des notions, ou des idées, comme l’idée d’enfer, de liberté, de justice, ou de fidélité ;
en leur donnant corps. C’est ce que Kant a en vu lorsqu’il écrit que « Le poète ose donner une forme sensible aux
Idées de la raison ». Par « Idées de la raison », Kant désigne les idées qui ne dérivent pas des sens et dont aucune
expérience ne peut nous donner une connaissance parfaite ; c’est par exemple l’idée d’âme ou l’idée de Dieu.
Voici à présent la citation entière : « Le poète ose donner une forme sensible aux idées de la raison que sont les
êtres invisibles, le royaume des saints, l’enfer, l’éternité, la création, ou bien encore des choses dont on trouve,
au vrai, des exemples dans l’expérience, comme la mort, l’envie et tous les vices, ainsi que l’amour, la gloire,
mais en les élevant, alors, au-delà des bornes de l’expérience grâce à une imagination qui s’efforce de rivaliser
avec la raison, dans la réalisation d’un maximum, en leur donnant une force sensible dans une perfection dont il
ne se rencontre point d’exemple dans la nature ».
La littérature donne ainsi corps à des propositions abstraites. Pensons à la description de l’enfer telle qu’on
la trouve dans le chant 11 de l’Odyssée. Voilà une représentation concrète d’une idée de la raison qui, n’est
possible que par le biais de l’imagination. Si on considère la question de l’esclavage, on peut lire l’Esprit des
Lois, de Montesquieu qui comporte un réquisitoire contre les pratiques esclavagistes ; Montesquieu y dit
pourquoi l’esclavage est un mal. Mais, si on lit Tamango, de Mérimée, on voit comment l‘esclavage un mal ;
Mérimée y décrit la réalité concrète de cette exploitation de l’homme par l’homme, à travers des actes, des
comportements, des souffrances, qui sont ceux de personnages individualisés par des traits physiques, moraux,
par des histoires singulières.

5
Donc la littérature montre des hommes, pas des notions ; non pas l’Homme, avec une majuscule, mais des
individus ; des individus incomplets, mais tout de même individualisés. Si bien que les idées, ou les propositions,
s’y trouvent incarnés ; et, ce faisant, la littérature fait tomber sous l’intuition ce que les principes expriment de
manière seulement générale, et abstraite.
Il faut ajouter que la littérature fournit non seulement des exemplifications, mais aussi de l’exemplarité, ce
qui est tout à fait important. L’exemplarité, c’est le fait pour un personnage d’incarner de manière remarquable
quelque chose : une qualité, une vertu, une valeur, etc. On retrouve là, dans la littérature et dans notre rapport à
la littérature, une tradition qui dépasse beaucoup celle de l’art : celle de l’exemplum ; dans les recueils
d’exempla, ceux des éducateurs ou des hommes d’Eglise, l’exemple est alors un modèle, un principe d’imitation.
Les personnages exemplaires en ce sens sont ainsi, en eux-mêmes, des normes.
C’est donc à juste titre que Ricœur distingue, dans l’acte de lecture, deux seuils de compréhension. La
lecture consiste d’abord à comprendre ce qui est raconté ; ce premier seuil concerne la compréhension de
l’histoire, y compris dans les méandres de sa complexité. Mais il y a un deuxième seuil de compréhension, que
Ricoeur nomme signification et qui concerne l’absorption par le lecteur du sens du texte dans sa propre
existence. Le roman, l’histoire a son sens, mais aussi, elle fait sens pour nous. Et elle fait sens d’une manière tout
à fait particulière du fait des spécificités de la littérature par rapport au discours philosophique et par rapport au
discours théorique en général. La littérature est cognitivement consistante, et une grande partie de ses oeuvres
traite de sujets qui intéressent l’humain. Considérons l’Odyssée ; il y est question de la vie bonne ; et toute la
philosophie de l’Antiquité a aussi pour préoccupation la question de la vie bonne. Il y a incontestablement une
grande proximité de préoccupation entre la philosophie et la production « littéraire »
1
de ce même espace
culturel. Donc la littérature intéresse la philosophie parce qu’elle partage des questionnements avec cette
dernière, et qu’elle donne à penser autrement que la philosophie.
Mais si on en restait là on n’aurait fait qu’une partie du chemin : on ne tiendrait pas compte de ce qui est
proprement littéraire dans la littérature, de ce qui fait sa spécificité, à savoir du travail sur la langue. Ce n’est pas
parce que la littérarité ne constitue pas le tout de la littérature que nous considérons ici, que la littérature est un
texte comme un autre, ou un texte ordinaire. Une part de sa force, de sa force réflexive, tient à son usage très
particulier de la langue.
Expliquons-nous. Un texte littéraire se distingue du langage courant par des figures de style ; Roland
Barthes reconnaît le premier au le degré de concentration des figures qui s’y trouvent. Figures de rythme, figures
de son (allitérations, paronomases, antanaclases, par exemple), figures de sens, y ont une présence beaucoup plus
dense que dans l’usage ordinaire de la langue qui, lui, constitue donc, comme le dit un titre de Barthes, Le degré
zéro de l’écriture. Or ces figures ont, en elles-mêmes, en tant que figures, des effets remarquables. Elles peuvent
produire une sorte d’ébranlement de l’âme qui l’émeut, l’élève ou la trouble. Prenons par exemple le cas de cet
oxymore utilisé par Sophocle pour parler d’Antigone dans la pièce éponyme ; elle est, dit-il « saintement
criminelle ». Cet oxymore allie l’incompatible : le crime et la sainteté et ce faisant dit en un raccourci fulgurant
qu’Antigone est criminelle au regard de la loi, mais qu’elle est sainte au regard de la morale. Quand on
1
Les guillemets qui entourent l’adjectif « littéraire » indiquent que le mot est partiellement inadéquat puisqu’il a
pour nous une signification et des connotations qui conviennent mal à la production écrite de ce temps. Il est
employé faute de mieux, mais il ne faut pas commettre d’anachronisme.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%