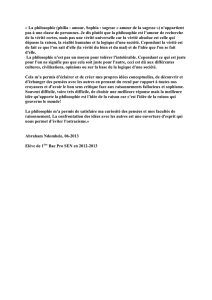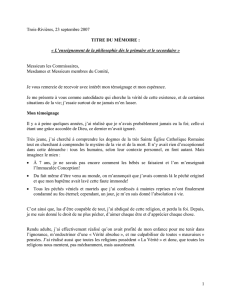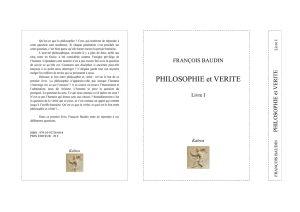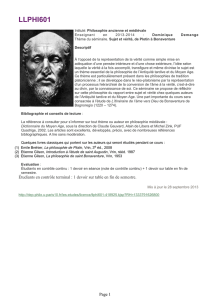Langage de la Philosophie

LANGAGE DE LA PHILOSOPHIE
DE LA POSSIBILITÉ ET/OU RÉALITÉ DU LOGOS PHILOSOPHIQUE
(ART, RELIGION ET PHILOSOPHIE)
Sommaire
Présentation : Philosophie et Langage
Introduction : Qu'est-ce que la Philosophie ?
I. ART
Introduction
1. Les catégories esthétiques
A. Forme
B. Fond
C. Forme et Fond
2. La classification des arts
A. Peinture
B. Musique
C. Littérature
II. RELIGION
Introduction
1. Les dogmes religieux
A. Preuves de l'existence de Dieu
B. Création du monde
C. Immortalité de l'âme
2. L'évolution des religions
A. Paganisme
B. Judaïsme et Islam
C. Christianisme
III. PHILOSOPHIE
Introduction
1. Idée de la Philosophie
A. Concept
B. Méthode
C. Système
2. " Système de la Science "
Conclusion : Pourquoi la Philosophie ?

1
PRÉSENTATION : PHILOSOPHIE ET LANGAGE
De sa lointaine naissance en Grèce antique à sa dernière formulation systématique, pour l'instant,
de l'Idéalisme allemand, la Philosophie n'a poursuivi qu'un but, énoncer le sens universel-ultime de l'Être.
Quelle que soit l'appellation dont elle ait usé, au cours de sa longue histoire, pour qualifier ce dernier
ŔIdée (Platon), Acte (Aristote), Principe (Descartes), Substance (Spinoza), Monade (Leibniz),
Sujet (Kant) ou Absolu (Hegel)Ŕ, toute philosophie véritable a toujours visé à l'expression
d'une relation totale et progressive des étants, soit d'une Signification intégrale et graduelle.
En cela elle répond à la vocation même du Langage dont le propre consiste à instituer des sens liés
entre eux et subordonnés les uns aux autres. Chaque parole renvoie à une autre parole qui l'explicite
et l'approfondit, jusqu'à l'épuisement du dicible, le Verbe se réfléchissant ainsi pleinement lui-même.
Au-delà d'un énoncé de ou sur quelque chose, l'essence de la Langue réside dans son auto-expression,
c'est-à-dire aussi bien dans l'acte de dire un fait que dans celui de dire qu'elle le dit, ce qui revient à
« se » dire et à attester du coup de son absoluité, auto-nomie ou circularité (réflexivité).
Seulement tandis que le parler ordinaire arrête ce procès signifiant, substituant à la pure signification
une simple information figée, comme c'est le cas dans les conversations banales quotidiennes usuelles,
le Logos philosophique entend le mener à son terme. Aussi il porte à la conscience claire et manifeste
ce que le premier n'assume que de manière implicite, inconsciente et incomplète. Prenant au sérieux
l'expressivité des mots, le Philosophe tente d'en établir un compte-rendu exhaustif, soit de récapituler
l'ensemble des significations fondamentales, en vue d'une Sémantique générale et auto-référentielle.
Il fut accompagné voire précédé dans cette voie par les discours scientifique, politique, artistique
et religieux qui cherchent également à articuler une Idée compréhensive et globale, dénommée
respectivement le Vrai, le Bien, le Beau ou Dieu (l'Absolu). En quête d'une Raison dernière du Monde,
de l'Homme ou de l'Esprit, ces disciplines balisent déjà le cheminement - trajet philosophique.
Elles en formulent même quelque contenu, sous la forme de lois, de valeurs, d'idéaux et de dogmes qui
font partie intégrante des sens que celui-ci devra recenser, sous peine de ne tracer qu'une route vide.
Bien que ces matières participent de la Philosophie, y trouvant une place légitime, assignée du reste
par celle-ci, elles ne sauraient néanmoins tenir lieu d'un langage exhaustif de l'Être, ne proférant que
des sens particuliers pour les deux premières et non complètement réfléchies pour les deux secondes.
Et de fait la science proprement dite ne s'intéresse qu'à la nature et la politique qu'à l'homme (société),
être soumis, pour partie du moins, aux lois naturelles dont les lois sociales portent encore la marque ;
en conséquence de quoi elle ne peut produire que des vérités « mondaines » ou particulières,
relatives à la constitution du monde ou du milieu (univers) dans lequel nous vivons et agissons.
Quant à l'art et à la religion, tout en esquissant des figures de l'Absolu, ils en restent à son pressentiment
(image/intuition) forcément subjectif, plutôt qu'à sa présentation (concept/pensée), elle nécessairement
communicable ou partageable. Nul Chef-d'œuvre ni Dieu ne s'imposent d'eux-mêmes à tous, ne contenant
pas en eux le tout des significations, ce qui les autoriserait alors à se dire les seuls envisageables.
Force est donc de dépasser, sans pour autant les annuler, ces différentes formes discursives vers une
Expression universelle, conformément à l'ambition linguistique et/ou philosophique.
Mais l'échec de celles-là rend celle-ci fort problématique. Comment espérer réussir là où les autres
ont échoué : qui réalisera le dessein d'un langage englobant la totalité du dicible, soi-même inclus ?
Pas davantage qu'une œuvre artistique ou une religion, nul Système philosophique n'a apparemment
prévalu définitivement sur d'autres possibles, ce qui eût formé le signe de sa réflexivité intégrale,
en lieu et place d'une simple opinion ou point de vue. Les critiques sceptiques récurrentes dont
la philosophie n'a cessé de faire l'objet, les « querelles » persistantes entre les philosophes eux-mêmes
et le sempiternel « re-commencement » radical animant leurs discours en témoigneraient à l'envi.
Toute parole ne buterait-elle pas eu demeurant sur la limite d'un sens toujours à compléter, marque,
semble-t-il, de son foncier inachèvement ? Aussi le projet philosophique, en dépit ou à cause de
sa beauté et de son insistance millénaire, relèverait plus du rêve et même du fantasme, que de la réalité.
La prétention qui le meut outrepasserait les capacités de notre l'esprit ; ce qui obligerait à l'abandonner,
pour nous rabattre sur des discours moins chimériques ou plus positifs, laissant à chacun le soin de se
débrouiller à sa guise avec le(s) problème(s) de la Philosophie.

2
Et cependant, en-deçà de cette dernière, c'est le discours humain ordinaire qui est habité, nous
l'avons dit, par la même volonté d'exhaustion ou de recueillement de l'ensemble du dicible, preuve que
la tentative philosophique ne se réduit pas à une illusion, sauf à parler d'une illusion universelle
-mais qui la diagnostiquerait dès lors ? Partant on reviendra sur l'insuccès des essais antécédemment
évoqués, pour en découvrir la cause et y repérer la place d'une autre option, plus adéquate à la finalité
du Logos humain, et du même coup du Fatum (fatalité, du lat. fari : parler) de l'Humanité, celle-ci se
nouant principiellement au Langage -l'Homme se reconnaissant d'emblée comme un être de Parole.
L'on se focalisera ici sur les expressions esthétique et religieuse, dans la mesure où elles partagent
l'obje(c)t(if) de la philosophie qu'elles dénomment respectivement le Beau voire le Sublime et Dieu,
censés manifester et/ou révéler, à l'instar de l'Absolu, du Sens ou de la Vérité philosophique, l'énigme
de l'existence en général, tant naturelle, humaine que divine. La parenté de ces trois disciplines a
d'ailleurs été d'emblée soulignée par les philosophes : Platon assimilait dans le Phédon la philosophie à
"la plus haute musique", Aristote qualifiait en la Métaphysique la Philosophie première de "Théologie"
et Hegel identifiera pareillement dans la Science de la Logique, l'Absolu à " Dieu ".
Après un bref rappel préalable de la définition de la Philosophie (Introduction), on analysera de plus
près l'Art et la Religion (Chapitres I et II), afin d'en scruter le bien fondé et d'en souligner le manque.
L'examen de celui-ci nous conduira à la position d'un Discours vrai (total), soit à la Philosophie (Chapitre III),
la conscience d'une insuffisance manifestant justement déjà l'exigence de son comblement.
Telle est l'unique méthode permettant de saisir la possibilité du Discours philosophique, au-delà de
toutes ses dénégations sceptiques voire triviales (Conclusion), et dont l'articulation, le développement
ou l'explicitation plénière et structurée sera réservé à un autre ouvrage intitulé Philosophie en Cours.
Car l'assurance subjective d'une faculté n'équivaut point à la certitude objective d'un savoir exécuté.
Un prolongement ou une transformation est encore requis.
Une chose est d'affirmer la nécessité logique (possibilité) d'une discipline, une autre de la réaliser,
sans quoi la première s'avèrerait lettre formelle ou morte. Pour lui donner consistance ou vie, il importe
de la transformer en réalité, en rédigeant le Système philosophique effectif qui se démontre soi-même,
et non en postulant un système possible à partir des défauts d'autres discours, si proches fussent-ils de lui.
Et si en « critiquant » ceux-ci, nous passons sûrement par eux, les inscrivant dans un ensemble,
il s'en faut que ce dernier corresponde pleinement au vouloir-dire de la Philosophie en tant que telle.
En se cantonnant à l'exposé de deux matières, on faillit en effet à sa vocation universaliste qui doit
prendre en compte toutes les significations exprimées par l'Homo loquens-sapiens, y compris celles
des sciences naturelles et humaines. Nonobstant la caractérisation banale dont on affuble souvent
les énoncés humains Ŕ«vulgaires», «prosaïques», «nobles», «transcendants»-, tous figureront dans une
En-cyclo-pédie philosophique, en leur sens fondamental du moins, d'autant que celle-ci intègre Tout.
D'où le caractère incomplet des pages qui suivent. Elles accomplissent certes quelque peu l'intention
philosophique, voire la pourvoient de deux ou trois chapitres réels, mais ne tiennent aucunement lieu
d'un Traité achevé de cette Science. Tout au plus y fournissent-elles une voie d'accès et en récapitulent
certaines divisions qui, pour privilégiées qu'elles soient, ne trouveront leur démonstration véritable que
dans la présentation d'ensemble de la Théorie, seule habilitée à dire le « Véri-dique », et à se réfléchir
ainsi soi-même, dans la stricte continuité de sa nature circulaire ou langagière. Et cette introduction ne
se confondra pas avec ce que d'habitude l'on nomme telle, puisque, malgré sa justification a posteriori,
elle anticipe a priori le contenu qui s'en suit, méritant déjà le nom de Philosophie, même s'il n'y est
question que d'une philosophie en devenir.
Aussi on voudra bien lire cet écrit simultanément comme une préfiguration et/ou un résumé partiel
du Philosopher, que et surtout comme une de ses portes d'entrée éventuelles, étant entendu que
dans un Cercle ou Système authentique, il n'y a pas de point de départ exclusif (simple / unique),
tout début y rejoignant obligatoirement la fin, en transitant par toutes les stations intermédiaires.
Celui que nous avons choisi nous a paru clairement et pédagogiquement le plus aisé à faire comprendre
ce dont il s'agit en Philosophie même et que l'on n'a que trop souvent tendance à ignorer ou oublier.
Cette seule raison suffit à légitimer un texte par ailleurs, répétons le, imparfait, et qui sera parachevé ...

3
INTRODUCTION
Qu'est-ce que la Philosophie ?

4
Dès son interrogation liminaire portant sur son essence ŔQu'est-ce que la Philosophie ?-,
celle-ci se retrouve dans le cercle de la réflexivité, car il lui faut alors se définir elle-même,
soit philosopher sur la philosophie. Loin de constituer cependant un cercle vicieux blâmable,
le retour originaire de la philosophie sur elle-même témoigne de son statut autonome
1
,
à l'image de celui du Discours dont le propre réside dans sa capacité de se signifier soi-même.
Ne forme-t-elle pas d'ailleurs une modalité privilégiée, nous le montrerons, du Langage et,
au point de départ, cette discipline ne se résumeŔt-elle pas à un nom Ŕ"ce mot de philosophie"
(Descartes
2
)-, auquel se réfèrent tous les philosophes, nonobstant leurs différends ultérieurs ?
Plutôt que de condamner d'emblée, et de manière injustifiée, la situation circulaire dans
laquelle elle est plongée, on lui accordera au contraire la plus extrême vigilance.
Penchons-nous donc tout d'abord sur l'unité de l'appellation dont se réclament les systèmes
philosophiques, en suspendant, provisoirement du moins, les différences qui les séparent, et
esquissons-en l'étymologie et la sémantique. Ce terme, d'origine grecque Philo-Sophia
(Amour de la Sagesse), fut forgé par un mathématicien hellène du VIè siècle, Pythagore.
" Ce sont donc bien les Grecs qui créèrent la philosophie, dont le nom, au surplus, ne sonne pas étranger. (...)
Le terme de « philosophie » est une création de Pythagore." (Diogène Laërce
3
)
Or les Hellènes apparaissent comme les fondateurs de la science mathématique Ŕle premier
théorème mathématique date de Thalès, un penseur du VIIè siècle originaire de la Grèce
d'Asie mineure, et le manuel instaurateur de la discipline remonte aux Éléments d'Euclide, un
mathématicien de la Grèce hellénistique du IIIè siècle- et du régime démocratique, fût-il
partiel, qui date de l'Athènes des VIè et Vè siècles. Et leurs deux découvertes présentent un
lien irrécusable, à l'argumentation ou à la démonstration de l'une répond le débat ou le
raisonnement de l'autre : un même principe les ordonne, l'obligation de justification ou de la
preuve rationnelle et partant de la mise en commun, et donc égale, du savoir ou du pouvoir.
Issue du même « esprit », la philosophie ne saurait échapper à cette règle, ce que confirme sa
mise en forme paradigmatique, celle de Platon, auquel on doit sa véritable naissance,
Pythagore lui-même et Socrate n'ayant jamais rien écrit, quant aux présocratiques en général,
leur oeuvre demeurant trop proche de la littérature. Et l'auteur de la République et du Timée a
affiché clairement sa volonté scientifique et/ou pédagogique, ne serait-ce que dans le mode
«dialectique» ou dialogique de son œuvre.
" La philosophie proprement dite commence pour nous en Grèce (...). Avec Platon commence la science
philosophique en tant que science." (Hegel
4
)
Aussi ce n'est qu'improprement que l'on parle aujourd'hui de la philosophie orientale.
Son nom confirme pleinement ce point. Ainsi aimer (philein) veut dire demander ou désirer
une chose, une personne ou une idée, ce qui présuppose que l'on manque de ces objets.
En tant qu'être aimant, le philo-sophe débute par l'épreuve du manque. A l'encontre de
l'affirmation de la certitude immédiate (opinion), de la pseudo-science (technique) ou de
l'habilité politique, la conscience philosophique démarre par l'aveu de son ignorance/inscience
et conséquemment par le doute, l'examen ou l'interrogation. Seul un sujet sceptique peut au
demeurant s'adonner à une authentique recherche, libre qu'il se trouve de tout préjugé.
A l’instar de la science, la philosophie prend sa source dans l’étonnement/ l’émerveillement.
" Car cet état qui consiste à s’émerveiller est tout à fait d’un philosophe ; la philosophie ne débute en effet pas autrement,
et il semble bien ne pas s’être trompé sur la généalogie, celui qui dit que Iris [déesse messagère des dieux,
symbole de la Sagesse] est la fille de Thaumas [même racine en grec qu’émerveillement]." (Platon)
1
vide I. Thomas-Fogiel, Référence et Autoréférence (Vrin 2006)
2
Principes de la philosophie, Lettre-Préface p. 557
3
Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, Introd. pp. 40-42 ; cf. égal. Cicéron, Tusc. V. III. 7-9
4
H.Ph. Introd. IV. App. 2. p. 331 et Platon p. 389
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
1
/
102
100%