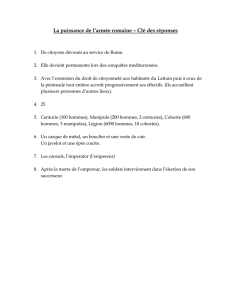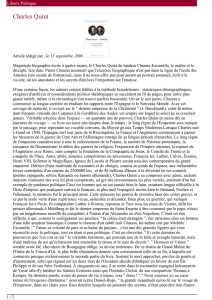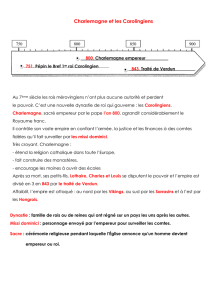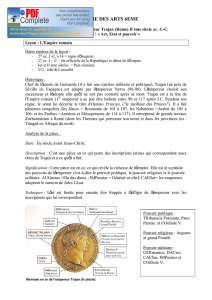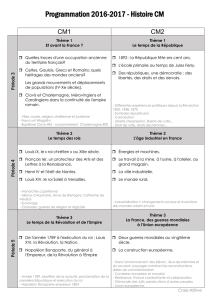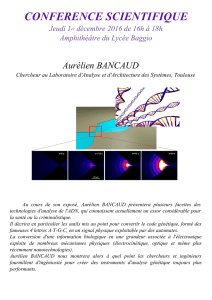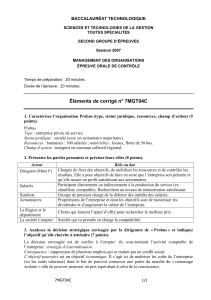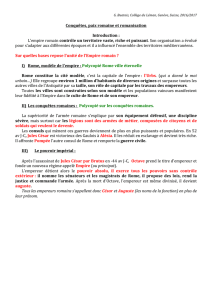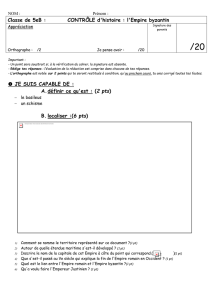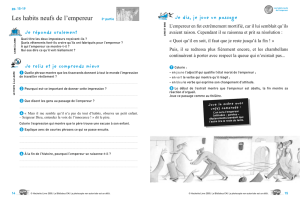T8 - L`Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée

HISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS
DEPUIS AUGUSTE JUSQU'À CONSTANTIN
TOME HUITIÈME
PAR JEAN-BAPTISTE CREVIER
Professeur émérite de rhétorique au collège de Beauvais.
PARIS - FIRMIN DIDOT - 1824

QUATRE RÈGNES, SIX EMPEREURS (suite).
LIVRE UNIQUE.
§ III. Maxime et Balbin. — § IV. Gordien III.
DE PHILIPPE À ALLIEN.
LIVRE UNIQUE.
§ I. Philippe. — § II. Dèce. — § III. Gallus. — § IV. — Émilien. — § V.
Valérien. — § VI. Gallien.
DE CLAUDE À CARIN.
LIVRE UNIQUE.
§ I. Claude II. — § II. Aurélien. — § III. Interrègne. — § IV. Tacite. — § V.
Probus. — § VI. § VI. Carus et ses fils Carin et Numérien.
DIOCLÉTIEN.
LIVRE UNIQUE.
§ I. Idée générale du caractère de Dioclétien. — § II. Persécution de Dioclétien.

QUATRE RÈGNES, SIX EMPEREURS (suite)
LIVRE UNIQUE.
§ III. Maxime et Balbin.
Le trône, qui ne fut jamais un objet d'envie pour les était bien capable d'inspirer
de la terreur Maxime et à Balbin lorsqu'ils y montèrent. Aux portes de l'Italie ils
voyaient un ennemi redoutable par ses forces et par sa cruauté, contre lequel il
fallait pousser la guerre à toute outrance sans aucune espérance de paix, sans
autre alternative que celle de tuer ou de périr. Dans Rome une milice
indisciplinée, un peuple turbulent et toujours prêt à se soulever. Ajoutez la
jalousie inévitable entre deux collègues, et la contrariété des humeurs fortifiant
celle des intérêts. Le concours de tant de fâcheuses circonstances leur annonçait
les malheurs qu'ils éprouvèrent effectivement.
Après qu'ils se furent acquittés du premier devoir que leur imposaient les
bienséances, et qu'ils eurent fait rendre par le sénat un décret pour mettre les
deux Gordiens au rang des dieux ; après qu'ils eurent pourvu aux deux grandes
charges de préfet de la ville et de préfet du prétoire, dont l'une fut donnée à
Sabinus, apparemment celui qui avait ouvert l'avis de les nommer empereurs, et
l'autre à Pindarius Valens, oncle de Maxime, ils partagèrent entre eux le soin des
affaires. Maxime, comme le plus guerrier, se chargea de marcher contre l'ennemi
; Balbin resta dans la ville pour y maintenir la tranquillisé.
Quelque pressant que fût le danger de la part de Maximin, les Romains étaient si
fidèlement amateurs des spectacles, qu'il fallut, que Maxime leur ne donnât
avant de partir, pièces de théâtre, courses ; dans le cirque, combats de
gladiateurs. Sur ce dernier article Capitolin nous fournit fine anecdote qui ne doit'
mie âtre omise. Il assure que c'était une loi que les empereurs donnassent des
combats de gladiateurs avant que de se mettre en marche pour la guerre. Il
allègue deux raisons de cet usage. La première était la superstition les Romains
s'imaginaient par l'effusion du sang dans la ville contenter les divinités
malfaisantes, et leur procurer d'avance une compensation pour le sang des
soldats qu'elles épargneraient. L'autre motif se rapportait à une fin moins
absurde : on voulait, dit l'écrivain cité, encourager ceux qui allaient à la guerre
par l'exemple du courage des gladiateurs, et familiariser leurs yeux avec le sang.
Quoi qu'il en soit et des raisons sur lesquelles on le dit fondé, à peine Maxime
était-il parti qu'un trouble affreux qui s'excita dans Rome
1
, et qui mit la ville en
danger de périr, manifesta et la mauvaise disposition des esprits, et l'incapacité
de Balbin.
Maxime avait laissé dans Rome une grande partie des prétoriens, principalement
les plus vieux soldats. Plusieurs d'entre eux vinrent avec une grande foule de
citoyens du peuple s'attrouper autour de la porte du sénat, qui délibérait
actuellement sur les affaires de la république : et même deux ou trois, poussés
par la curiosité, firent si bien qu'ils entrèrent dans le lieu de l'assemblée, et se
1
Capitolin se contredit, et est plein de brouilleries dans les différents récits qu'il donne
de cette sédition. Je suivrai principalement Hérodien.

placèrent, pour mieux entendre, près de l'autel de la Victoire. Ils étaient en habit
de paix et sans armes : et au contraire tous les sénateurs étaient armés, parce
que dans la situation des choses, dans le mouvement général qui agitait la ville
et tout l'état, ils craignaient à chaque instant quelque danger subit et imprévu,
contre lequel il leur paraissait sage de se précautionner. Gallicanus personnage
consulaire, et Mécénas ancien préteur, caractères vifs et impétueux, ayant
aperçu les soldats dont je parle, en prirent ombrage : et par une violence aussi
téméraire qu'injuste, il les attaquent avec leurs poignards qu'ils tirent de dessous
leurs robes, et les renversent morts au pied de l'autel de la Victoire. Les autres
prétoriens, effrayés de la mort de leurs camarades, et n'ayant point leurs armes
pour se défendre, prennent le parti de fuir vers leur camp. Gallicanus sort du
palais, son poignard ensanglanté à la main : il crie qu'il vient de tuer deux
espions de Maxime ; il accuse tous les prétoriens d'être dans les mêmes
sentiments, et il exhorte le peuple à les poursuivre. Ses exhortations ne furent
que trop écoutées ; et les prétoriens poursuivis par une multitude immense, ne
trouvèrent de sûreté que dans leur camp. Ils s'y enfermèrent et se mirent en
défense.
La témérité forcenée de Gallicanus ne s'en tient pas là. Il échauffe de plus en
plus la populace, et l'engage à attaquer le camp. Pour cela il lui fournit des
armes, en faisant ouvrir des arsenaux : un grand nombre s'armèrent de tout ce
qu'ils trouvèrent sous leur main : les gladiateurs que l'on tenait rassemblés, et
que l'on formait en diverses écoles, se joignirent au peuple ; et Gallicanus à la
tête de cette troupe confuse et tumultueuse, vint livrer l'assaut au camp des
prétoriens.
Ceux-ci, bien armés et dressés à tous les exercices militaires, n'eurent pas de
peine à rendre inutile une pareille attaque. Enfin le peuple se lassa, et sur le soir
chacun songea à se retirer chez soi. Les prétoriens voyant leurs adversaires qui
tournaient le dos et marchaient négligemment comme s'ils n'avaient rien eu à P
craindre, sortent sur eux, en font un grand carnage, et rentrent ensuite dans leur
camp, dont ils avaient eu soin de ne pas s'écarter beaucoup.
De ce moment il se forma une guerre civile dans Rome. Le sénat prit parti pour
le peuple, et ordonna des levées de troupes. Les prétoriens de leur côté,
quoiqu'en petit nombre vis-à-vis d'une multitude infinie, se défendirent avec tout
l'avantage que leur donnaient leur expérience dans la guerre et une place bien
fortifiée : et jamais le peuple ne put réussir à faire brèche à leur camp.
Il me paraît étonnant que dans uni mouvement si terrible, il ne soit fait aucune
mention ni du préfet de la ville, ni du préfet des cohortes prétoriennes. Peut-être
devons-nous nous en prendre à la négligence des historiens. Balbin lui-même ne
fait pas ici tin beau personnage. Renfermé dans son palais, il publiait des édits
pour exhorter le peuple à la paix ; il promettait amnistie aux soldats qui ne
semblent pourtant pas avoir été les plus coupables, et aucun des deux partis ne
l'écoutait : leur fureur réciproque s'allumait par les obstacles.
Les généraux du peuple s'avisèrent d'un expédient pour vaincre l'obstination des
prétoriens, et ils coupèrent les canaux qui portaient l'eau dans leur camp. Les
prétoriens au désespoir font une sortie ; il se livre un combat qui fut longtemps
disputé, mais dans lequel le peuple enfin succomba et prit la fuite. Les
vainqueurs le poursuivent l'épée dans les reins, et entrent dans la ville : mais là
ils se virent assaillis d'une grêle de pierres et de tuiles, qu'on leur lançait de
dessus les toits des maisons. Ils ne balancèrent pas à y mettre le feu. L'incendie

devint furieux : il consuma tout un quartier, qui excédait en étendue et en
richesses les plus grandes et les plus opulentes villes de l'empire.
Il paraît que la violence du mal força Balbin de sortir de son inaction. Il se
présenta, il voulut interposer son autorité pour apaiser le désordre. On le
méprisa, et il fut même blessé, les uns disent d'une pierre lancée contre lui, les
autres d'un coup de bâton. L'unique remède fut de montrer aux séditieux le
jeune César Gordien, qui était adoré également des deux partis. Le nom qu'il
portait, la vénération pour la mémoire de son aïeul et de son oncle, le rendaient
infiniment cher au peuple et aux soldats. On le produisit monté sur les épaules
d'un homme de la plus haute taille, et dès qu'il parut avec la pourpre impériale,
les esprit se calmèrent, et le tumulte cessa.
Le sénat jouit ainsi de quelque tranquillité, et put se livrer uniquement aux soins
de la guerre, pour laquelle il prit les mesures les mieux entendues. Il s'agissait
d'empêcher l'entrée de Maximin en Italie. Le sénat envoya dans toutes les villes
qui pouvaient se trouver sur sa route des hommes titrés et qui eussent de
l'expérience dans l'art militaire, et il leur donna tout pouvoir pour rétablir les
fortifications, lever des troupes, faire en un mot tout ce qui serait nécessaire
pour mettre leurs places en état de défense. ll ordonna que l'on abandonnât tons
les lieux qui n'étaient pas fortifiés, et que les habitants se retirassent dans les
villes avec leurs grains, leurs bestiaux, et tout ce qu'ils possédaient, afin que
quand même l'ennemi pénétrerait dans le pays, il ne trouvât rien pour faire
subsister son armée. Des défenses furent portées dans toutes les provinces de
fournir aucunes provisions soit de guerre, soit de bouche, à Maximin, avec
menaces de traiter en ennemi public quiconque lui prêterait aucune aide. Enfin
l'on poussa la précaution jusqu'à faire garder tous les ports et toutes les rades de
l'Italie, et à barricader tous les grands chemins, et même les chemins de
traverse, afin que rien ne pût passer qui ne fût visité et examiné, et que l'ennemi
public ne reçût ni nouvelles ni secours par quelque voie que ce pût être. Maxime,
qui devait présider à l'exécution de ces différents ordres, se transporta à
Ravenne, pour être plus à portée de l'ennemi, qui arrivait par les Alpes
Pannoniennes.
Maximin n'avait pas fit beaucoup de diligence. Car c'est au mois de mai de l'an
de J.-C. 237 que les Gordiens furent proclamés empereurs en Afrique : et son
armée n'arriva aux portes de l'Italie qu'au commencement du printemps de l'an
238. J'ai rapporté la principale cause de ce retardement, savoir la froideur que
Maximin trouva dans ses troupes pour ses intérêts. Il lui fallut du temps pour
réchauffer dans leurs cœurs un zèle éteint par sa mauvaise conduite. Nous
pouvons ajouter que le dessein d'entrer en armes en Italie ayant été pris en
conséquence d'un mouvement subit et imprévu, les préparatifs d'une telle
entreprise traînèrent nécessairement en longueur. Ce qui est certain, c'est qu'on
ne peut attribuer ce délai au caractère de Maximin, qui poussait l'activité jusqu'à
l'emportement et la fureur.
A la nouvelle de la mort des Gordiens, il avait conçu quelque espérance d'une
soumission volontaire de la part de ceux qu'il traitait de rebelles ; mais l'élection
des empereurs Maxime et Balbin lui prouva que la haine du sénat était
irréconciliable, et que la force des armes pouvait seule réduire des cœurs aussi
ulcérés. Il employa donc le reste de l'année à faire des apprêts formidables ; et
voici de quelle manière il disposa sa marche, lorsqu'il approcha de l'Italie au
temps que j'ai marqué.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
1
/
198
100%