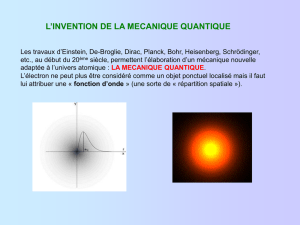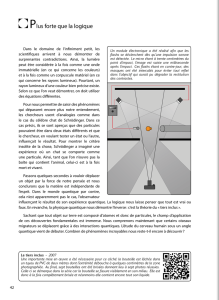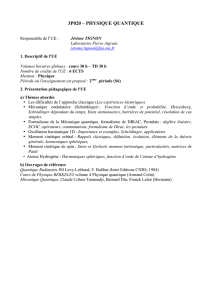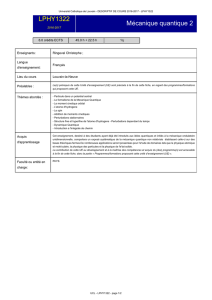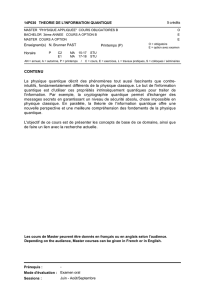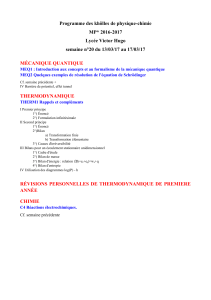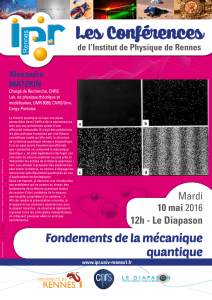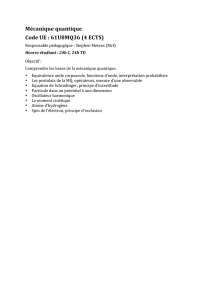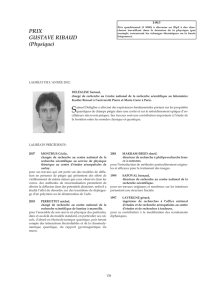L`interprétation de la Mécanique Quantique

Sommaire
Une table des matières détaillée figure à la fin du livre
Préface de Michel Bitbol 5
Introduction 9
Chap. 1 – Le réalisme scientifique face au problème de la mesure 15
1.1 Introduction 15
1.2 Le réalisme scientifique et la description classique du monde 16
1.3 L’interprétation standard de la mécanique quantique 40
1.4 La description quantique de la mesure 63
1.5 La théorie de la décohérence 78
1.6 La théorie de l’onde pilote 85
1.7 La théorie de la localisation spontanée 93
1.8 Les interprétations modales 101
1.9 Les mondes multiples et les esprits multiples 108
1.10 Conclusion 119
Chap. 2 – Vers une conception pragmatiste de la connaissance 123
2.1 Introduction 123
2.2 Resituer la connaissance dans la pratique 123
2.3 Le rôle des moyens de connaissance 135
2.4 Le nouvel expérimentalisme 148
2.5 Conclusion 163
Chap. 3 – La contextualité de la mécanique quantique 165
3.1 Introduction 165
3.2 Le débat de 1935 entre Bohr et Einstein 165
3.3 Violation des inégalités de Bell et non-localité 197
3.4 Les preuves de la contextualité 225
3.5 Conclusion 231
Chap. 4 – Une interprétation pragmatiste de la mécanique quantique 233
4.1 Introduction 233
4.2 Définitions pragmatiques 235
4.3 Les fonctions pragmatiques 251
4.4 Le formalisme des espaces de Hilbert 254
4.5 Le produit tensoriel 285
4.6 L’équation de Schrödinger 288
4.7 L’opérateur densité 296
4.8 Le postulat de projection 302
4.9 Le problème de la mesure revisité 316
4.10 Conclusion 329
Conclusion 331
Bibliographie 341
Table des matières 357


Préface de Michel Bitbol
Ce livre offre plus et mieux qu’une « interprétation » supplémentaire
de la mécanique quantique. Il conduit une enquête précise, documentée,
éclairante, sur ce qui se tient sous le niveau des interprétations, sur ce
qu’aucun interprète des théories quantiques ne devrait ignorer au sujet de
leur maniement et de leur mission première, sous peine de s’égarer dans
des spéculations débridées. En même temps, Manuel Bächtold montre
que la simple tentative d’aller au-delà de sa proto-interprétation, la simple
interrogation sur ce à quoi devrait ressembler le monde pour être
correctement représenté par la mécanique quantique, suffit à faire surgir,
sous une forme ou une autre, les paradoxes bien connus de cette théorie.
Dès lors, la proto-interprétation pragmatiste s’impose face aux
interprétations comme la seule stratégie qui ne soit pas génératrice de
difficultés conceptuelles, mais qui au contraire les évite d’emblée, par
construction, au lieu d’avoir à les résoudre après coup. Elle devient elle-
même une forme d’interprétation concurrente des autres, tout en prenant
le pas sur chacune d’entre elles comme son soubassement inévitable.
Les théories quantiques attendent depuis longtemps ce genre de
clarification. Elles ont atteint un degré d’efficacité, mais aussi de
cohérence et de systématicité, rarement égalé dans l’histoire de la
physique. Par-delà leurs applications technologiques, qui témoignent
quotidiennement de leur fécondité et de leur base croissante d’attestation,
elles interviennent dans l’architecture de quasiment tous les programmes
actuels de généralisation et d’unification des théories physiques. Leurs
règles d’utilisation, guidées par un formalisme algébrique élégant,
atteignent une rigueur normative que même les théories classiques
pourraient leur envier. Et pourtant, on le sait, et on ne cesse de s’en
plaindre depuis leur création, leur signification reste controversée. Cette
signification reste écartelée entre la lecture purement épistémologique des
créateurs de l’esprit de Copenhague (Bohr et Heisenberg), et les
nombreuses propositions de lecture ontologique qui n’ont pas manqué
dans l’histoire, de l’invocation de prédicats régis par des logiques non-
classique à la croyance en une pluralité de mondes, en passant par les
théories à variables cachées. Le premier type de lecture a l’avantage
d’être à la fois immédiatement efficace, économique pour la pensée, et
capable de désamorcer les paradoxes à la source. Le second type de
lecture, pour sa part, a l’avantage d’offrir des images auxiliaires qui
orientent les recherches, de satisfaire à des exigences de la pensée qui ne

6 Préface
se bornent pas à l’économie, et aussi d’inciter à des travaux théoriques et
expérimentaux importants pour les fondements théoriques, sous le
(curieux) prétexte de résorber des paradoxes qu’il a contribué à
engendrer. Malgré ses mérites évidents, le premier type de lecture a
connu une longue période de disgrâce (des années 1960 aux années 1990,
environ) pour des raisons qu’il est facile de comprendre après-coup :
xSa formulation canonique, issue des textes des pères fondateurs que
sont Bohr et Heisenberg, laisse subsister bien des régions obscures ;
xSes qualités de parcimonie se retournent en autant de défauts, par
contraste avec le stimulant multidimensionnel pour la recherche
qu’offrent des lectures « réalistes » de la mécanique quantique.
Le présent livre fournit des pistes extrêmement convaincantes pour
réhabiliter la lecture « copenhaguienne » de la mécanique quantique, en
s’attaquant simultanément aux deux faiblesses qui lui sont reprochées.
D’une part, le recours parfois confus des héritiers de l’esprit de
Copenhague à des éléments anciens de théorie de la connaissance, à des
considérations sur le sujet voire sur la conscience, est mis de côté et
remplacé par une analyse systématique des pratiques de manipulation
instrumentale et d’anticipation de leurs résultats. D’autre part, le rejet
iconoclaste des « images du monde » se voit atténué par une prise en
compte de leur fonction dans l’activité de recherche. Dans l’esprit du
dépassement de l’empirisme classique (phénoméniste et réducteur) par
l’empirisme constructif de Van Fraassen, Manuel Bächtold formule un
« pragmatisme constructif » qui prend pleinement en compte le rôle que
peuvent jouer les représentations dans le processus de l’« enquête ». Il
admet en particulier le concept problématique de système physique, à la
manière distanciée dont John Dewey admettait le concept d’objet : « Les
choses existent en tant qu’objets pour nous seulement dans la mesure où
elles ont été antérieurement déterminées comme résultats des enquêtes »1.
Le résultat de cette reprise du meilleur de la lecture « copenhaguienne »,
est une conception enfin mûre des théories quantiques : libérée des
paradoxes qui la plombent dans ses lectures réalistes, mais à nouveau
pourvue de tous les moyens de la fécondité scientifique ; lucide sans
risquer la stérilité.
Les deux résultats, conciliant l’exigence épistémologique avec les
besoins scientifiques, sont atteints à travers un exposé détaillé,
systématique et limpide de la mécanique quantique, de ses postulats, puis
1. Dewey, J., Logique, la théorie de l’enquête, Paris : PUF, 1993, p. 184.

Préface 7
de leur sens à la fois minimal et suffisant pour la recherche. Cela laisse
espérer qu’au-delà de sa portée philosophique, ce livre serve un jour
prochain d’instrument pédagogique central pour l’exposé des théories
quantiques au niveau d’une Licence de sciences de la nature. Il éviterait
aux futurs étudiants en physique, en chimie, ou en biologie moléculaire,
d’être confrontés à la non-pédagogie qui sévit trop souvent à l’heure
actuelle : celle qui consiste à s’en tenir à des calculs silencieux, d’autant
plus lourds qu’ils sont ininterprétés, ou bien à ce que B. d’Espagnat1 a
dénoncé comme le message schizophrénique de l’enseignement
universitaire, alliant une terminologie teintée d’ontologie à des
déclarations platement positivistes. Déjà pertinente pour la physique
expérimentale, comme pour les tentatives actuelles de reconstruction de
la mécanique quantique en termes de théories de l’information, une
lecture pragmatiste aussi aboutie que celle de Manuel Bächtold devrait
libérer les imaginations et les enthousiasmes des chercheurs en formation.
Elle pourrait y parvenir en retournant la trop célèbre
« incompréhensibilité » de la mécanique quantique en nouvelle méthode
de sa compréhension. Au lieu de regretter que chaque tentative de
traverser le plan des opérations formelles et instrumentales vers un
tableau de la réalité se solde par des paradoxes, on se servirait des
paradoxes comme moyen d’élucider l’écart entre les opérations de la
physique microscopique et celles qui nous permettent ordinairement de
dresser un tel tableau. Au lieu de se plaindre de l’impression d’étrangeté
que donne la théorie à fondement probabiliste qu’est la mécanique
quantique, on la reconnaîtrait, à la manière dont J. Cavaillès reconnaissait
les probabilités elles-mêmes, comme l’archétype d’une approche
scientifique : « Si toute loi physique n’est qu’un pari d’action, le scandale
de la probabilité cesse : loin d’être un substitut inadéquat pour notre
pouvoir de connaître, elle est le type même, le ressort de toute activité
scientifique »2. Au lieu de se lamenter de ce que la mécanique quantique
est seulement une « théorie qui marche », on arriverait à la comprendre
désormais comme réalisation des conditions nécessaires à la « bonne
marche » de toute théorie de ce type. Au lieu de déplorer qu’en physique
1. D’Espagnat, B., Le réel voilé, Paris : Fayard, 1994.
2. Cavaillès, J., « Du collectif au pari, À propos de quelques théories récentes sur les
probabilités », in : Cavaillès, J., Œuvres complètes de philosophie des sciences, Paris :
Hermann, 1994.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%