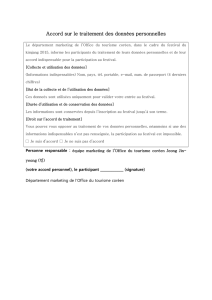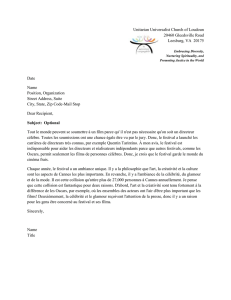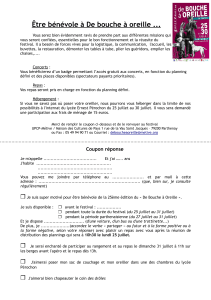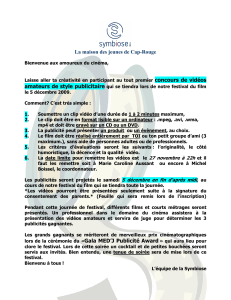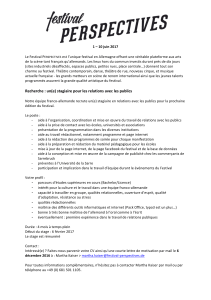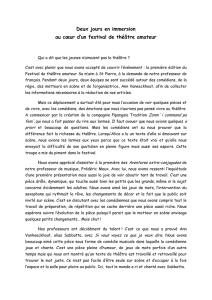le théâtre documentaire traditionnellement mené

LE THÉÂTRE
EST-IL UN MÉDIA ?
cahier spécial

En couverture : Les Témoins, de Julien
Bouffier (étape de travail, juillet 2010).
Photo : Marc Ginot.
Cahier spécial / MOUVEMENT n° 59
(avril-juin 2011) réalisé en coédition
avec le festival Hybrides3,
avec le soutien du Centre national
des écritures du spectacle / La
Chartreuse de Villeneuve lez Avignon,
et du Médiator - Scène conventionnée
à Perpignan.
Coordination : Jean-Marc Adolphe
et Charlotte Imbault
Conception graphique : Sébastien
Donadieu
Edition : Pascaline Vallée
Partenariats/publicité : Alix Gasso
Ont participé à ce numéro : Jean-Marc
Adolphe, Eric Demey, Charlotte
Imbault, Claire Kueny, Bruno Tackels,
Dominique Vernis
MOUVEMENT, la revue indisciplinée
6, rue Desargues - 75011 Paris - France
tél. +33 (0)1 43 14 73 75;
www.mouvement.net
Mouvement est édité par les Editions
du Mouvement, SARL de presse au
capital de 4 200 €, ISSN 125 26 967
Directeur de la publication : Jean-Marc
Adolphe. © mouvement, 2011. Tous
droits de reproduction réservés
Cahier spécial Mouvement n° 59.
Ne peut être vendu.
Le festival Hybrides3 est proposé par la
compagnie Adesso e sempre en
collaboration avec le Théâtre Jean Vilar,
L'Agora - cité internationale de la danse,
le Centre chorégraphique national
de Montpellier Languedoc-Roussillon,
la Chapelle, Kawenga, le Trioletto,
le Rockstore, le Café de l'esplanade,
la Salle 3, le Centre national des
écritures du spectacle / la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon, le TILT festival/
Théâtre de l’Archipel Perpignan.
Le festival Hybrides est soutenu par la
Ville de MontpellierF.
Numéros de Licences : 2-1038343 / 3-
1038344
Directeur : Julien Bouffier
Administratrice : Nathalie Carcenac
Coordination : Fatiha Schlicht
tél. 06 33 37 18 81 /
AU THÉÂTRE, TOUT EST
EN TRAIN D'ARRIVER
C'est arrivé (la chose qui). Ça arrive (la chose
là). Cela va arriver (la chose inconnue). Le
théâtre est un art de la conjugaison. Ce que
soupèse la mémoire, ce que vit l'instant, ce que
prévoit confusément l'action. Le théâtre n'est
pas un média, au sens où il ne ferait que repor-
tage de l'événement ayant eu lieu. Le théâtre
est un média, au sens où il fait chronique d'un
passé et d'un devenir, dans le présent de la
(re)présentation. Une archive vivante, quoi.
Qui, parfois, anticipe sur le cours des choses.
Vendredi 21 janvier 2011, au théâtre de l'Agora
d'Evry, en région parisienne, Fadhel Jaïbi et
Jalila Baccar présentaient avec leur compagnie,
Familia Productions, le spectacle Amnésia, créé
un an plus tôt à Tunis. Lequel s'est avéré parfai-
tement prémonitoire, et résonne étrangement,
en ces jours de janvier 2011, quand le soulève-
ment tunisien a fait fuir Ben Ali et invente
sa propre révolution. Sans aucun artifice scéno-
graphique (ni vidéo, ni nouvelles technologies),
le spectacle de Fadhel Jaïbi et Jalila Baccar
réfléchit la situation d'un pays que nos
dirigeants, pressés d'y passer leurs vacances,
refusaient de voir comme une « dictature
univoque ».
Le théâtre, dans sa fonction dramaturgique,
vaut donc comme média, ou, peut-être, comme
contre-média (il n'est pas indifférent que, la
plupart du temps, la représentation théâtrale
commence quand s'achève la grand-messe des
journaux télévisés de 20h). Il n'est pas, pour
autant, un média de l'immédiat. Le filtre de
l'écriture, de la composition, des répétitions, de
la mise en scène, permet de distiller la pré-
gnance de l'événement. Le théâtre joue un peu
le rôle qui fut celui, jadis, des colporteurs. Mais
notre perception du monde est aujourd'hui
contaminée par la multiplicité des écrans et des
sources d'information qui nous arrivent. Sans
céder à la tentation du zapping, le théâtre doit
rivaliser avec cette arborescence éclatée qui
constitue notre quotidien de citoyens-consom-
mateurs. Hybrides, forcément hybrides, les
scènes contemporaines se sont mises à mélan-
ger le texte, le mouvement, le son, les images,
pour impliquer le spectateur dans ce qu'on
pourrait qualifier d'action du sens (après une
conception dramaturgique qui donnait la pri-
mauté absolue au sens de l'action).
Nous en sommes là, à tenter de reconnaître ce
que nous ne connaissons pas encore, qu'impar-
faitement. Cela tombe bien : le monde est
inachevé.
A Montpellier et à l'initiative du metteur en
scène Julien Bouffier, faisant extension jus-
qu'à Villeneuve lez Avignon (à l'est) et
Perpignan (au sud) en étroite connivence avec
le TILT festival, le jeune festival Hybrides s'at-
tache à pister les voies d'un « théâtre docu-
mentaire », en prise avec le monde. « Revue
indisciplinée », Mouvement s'est donné en sous-
titre ces quelques mots : « artistes, créations,
esthétique et politique. » Autant dire que la
rencontre entre Hybrides et Mouvement allait
de soi. Elle se matérialise par cette première
édition d'un cahier spécial, dans le croisement
et la continuité de nos chemins respectifs,
médias séparés, mais unis d'une même volonté
de capter le réel dans l'épaisseur (et parfois la
légèreté) de ses représentations.
Mais alors, de quoi le théâtre est-il le média ? De
lui-même. De nous-mêmes. Du monde même.
D'un espace-temps où tout (mémoire, présent,
avenir) serait en train d'arriver.
Jean-Marc Adolphe
adessoesempre.com
Le festival Hybrides remercie les artistes
de la Cie Adesso e sempre et les
bénévoles présents au festival.
La Compagnie Adesso e sempre est
subventionnée par le ministère de la
Culture / Drac Languedoc-Roussillon au
titre des compagnies conventionnées, la
Région Languedoc-Roussillon, le
Département de L'Hérault, la Ville de
Montpellier.
Partenaires :
Le théâtre, dans sa fonction
dramaturgique, vaut comme média, ou,
peut-être, comme contre-média.

Dès son origine, le cinéma s’est préoccupé de
produire des documents qui relayent la réalité
ambiante qui l’entoure, au point d’en faire un
genre, le documentaire, qui n’a cessé de gagner
ses lettres de noblesse aux côtés de la production
de fictions. Le travail des frères Lumière est
même intégralement fondé sur ce travail de col-
lectage de documents immédiats. Leur vision
géniale, qui consiste à faire rentrer dans le champ
de la caméra la vie qui l’entoure, a largement
nourri la manière de « rapporter les faits » dans
le journalisme du XXesiècle. Dans la Grèce antique
déjà, les premiers « historiens » étaient des
témoins directs qui racontaient ce qu’ils avaient
vu. Ils étaient en effet sur les champs de bataille,
comme guerriers (tout citoyen l’était), et rap-
portaient les événements auxquels ils avaient
assisté, en les consignant par écrit. Mais pour
les consigner, il faut bien que s’écoule le temps
de la consignation. On ne peut écrire l’horreur
dans le temps même où on la vit. C’est ce délai,
ce déplacement qui crée la fiction.
Le poète est celui qui s’empare des matières
brutes. Son travail consiste en un détour, qui
s’éloigne de la réalité immédiate, par la média-
tion du récit. Mais derrière cette nécessité de la
médiation et du détour, revient souvent, lanci-
nante dans l’histoire, la tentation de la restitu-
tion directe : Parler de l’événement en temps
réel, à mesure qu’il se produit. Réintégrer le jour-
naliste dans le travail du dramaturge. Ce fantasme
a toujours été à l’œuvre dans l’esprit des arti-
sans du théâtre. Dès l’origine. Les dramaturges
grecs écrivent ce qui vient d’arriver à la cité,
pour qu’elle le comprenne mieux. En même
temps, ce fantasme est un tabou. Un tabou et
un rêve impossible. Un rêve impossible parce que
le théâtre, nécessairement, a besoin d’un temps
retard, d’un délai pour rapporter ce qui a eu lieu.
L’homme qui rapporte les histoires humaines,
l’historien, est d’abord le témoin de ces histoires
– c’est d’ailleurs le même mot en grec…
Les tragédies rapportent les événements par la
bouche du messager, personnage central du
théâtre. Il vient dire, ici et aujourd’hui, sur scène,
les bruits et les fureurs de ce qui s’est passé, là-
bas, hier. Ce décalage est nécessaire, incompres-
sible. Plus grave, plus pressant : il est nécessaire,
politiquement nécessaire. La seule fois où un
poète s’est autorisé à le réduire à néant, ce fut la
guerre civile. Le poète Phrynichus a mis en scène
un dramatique épisode qui venait juste d’avoir
lieu – le « sac de Millet », une ville d’Ionie colo-
nisée par les Athéniens, et réduite en cendres
par les Perses, avec un art de la barbarie poussant
la cruauté jusqu’aux limites de l’imagination. En
réveillant cette douloureuse humiliation, la tra-
gédie eut un effet terrible : « Tout le théâtre fon-
dit en larmes », et la cité sombra dans le désordre.
Pour le punir, les Athéniens lui infligèrent une
terrible amende, et interdirent aux poètes
d’écrire sur l’actualité chaude et immédiate. Tous
les dramaturges ont obéi à cette prescription,
y compris Shakespeare, qui écrit ses tragédies
historiques trente ans après la fin de la guerre
des Roses.
Nous sommes encore aujourd’hui sous le coup
du « syndrome de Millet ». L’actualité pure est
un tabou pour la scène, et malheur à ceux qui
transgresseraient la règle… C’est que le théâtre
a besoin de temps pour digérer ce qui advient. En
le faisant passer sur la scène sans médiation, il
se condamne lui-même à disparaître.
Il y a bien sûr quelques heureuses exceptions.
Le Groupov, avec Rwanda 94, raconte le géno-
cide des Tutsis sous toutes ses coutures, y com-
pris en conviant une « vraie » rescapée sur la
scène. Dans ses « Journaux Théâtraux » (JT),
Julien Bouffier, avec sa compagnie Adesso e
sempre, aborde frontalement cette question :
« comment le théâtre peut-il parler de ce qui se
déroule dans le monde au moment de sa repré-
sentation ? » Il répond en affirmant la nécessité
de s’approprier la forme du « journal » quoti-
dien, pour le faire muter sur la scène, lui hybride
qui peut tout accueillir : l’écrit, le témoin direct,
l’écrit construit à partir du témoin direct, les
images satellites en temps réel, les réseaux
sociaux et tous les dispositifs technologiques
qui permettent de rapprocher la parole de tous
ceux qui sont loin(1). Comment rendre compte,
et en temps réel, par exemple de la catastrophe
qui ébranle Haïti ? Le metteur en scène Elie
Commins reprend cette question à son compte
en s’emparant de la parole développée sur Twitter
à l’occasion de catastrophes naturelles ou de
crises sociales. Il a notamment construit un spec-
tacle sur les émeutes de Téhéran, au moment des
élections de juin 2009, en s’appuyant sur les
innombrables messages que les Iraniens s’en-
voyaient durant les événements. Mais remar-
quons au passage que ces messages écrits en
direct sont mis en scène de façon différée ! Il
semble bien que le théâtre résiste encore à cette
logique de « duplex théâtral » généralisé.
Pour contrer cette difficulté, les artistes peu-
vent également quitter la scène et rejoindre la
L’actualité pure reste un tabou pour la scène : le théâtre
a nécessairement besoin d’un temps retard pour
rapporter ce qui a eu lieu. Mais comment la réalité du
monde peut-elle documenter le plateau ?
OÙ ÉTIEZ-VOUS LE
11 SEPTEMBRE 2001?
Comment le théâtre peut-il parler de
ce qui se déroule dans le monde au
moment de sa représentation ?
Haïti, janvier 2010.
Photo : Frédéric
Sautereau.
Who’s Afraid of
Representation? de
Rabih Mroué. Photo :
Samar Maakaroun.
Un homme debout, de
Jean-Michel Van den
Heyden. Photo : Loupix.

rue, pour en faire leur miel théâtral. C’est ce que
fait depuis des années Sébastien Barrier, en
marge du collectif GdRA, en traînant les guêtres
du céleste Ronan Tablantec, un navigateur bre-
ton improbable qui bourlingue dans les mots et
sort de sa malle cabossée les objets témoins de
ses multiples tours de monde. Ce conteur des
temps urbains fait rentrer dans son histoire tous
les événements qui affectent l’espace public où
il se pose. Sa capacité à intégrer l’imprévu, son
sens de la répartie, son incroyable capacité à faire
vivre les (fausses) histoires de ceux qui l’écoutent
(vraiment) en font un véritable écrivain public.
Sa gouaille provocante et tendre à la fois trans-
forme la grisaille du monde en récit fabuleux.
Ses apparitions font de lui un grand poète de
l’immédiat, doublé d’un clown politique qui se
joue de toutes les cruautés de la réalité.
Vouloir faire du théâtre un média est une gageure
impossible, mais nécessaire. Plus que jamais les
artistes d’aujourd’hui sont conscients de ce para-
doxe et l’éprouvent sans cesse dans leur travail.
Saisir le monde au ras du réel, tout en sachant
qu’il passe à la scène, et qu’il faudra donc com-
poser avec ses lois, ses exigences, qui suppo-
sent détour et patience du temps.
Sur un plateau en effet, il est des choses que l’on
n’a jamais pu montrer : le combat, le crime, la
catastrophe – autant de drames qui affectent
les hommes, mais qui ne peuvent être livrés qu’en
coulisses, hors-champ, sur les champs de
batailles, à moins que ce soient les champs
d’épandage, ou de ruines. Porter sur la scène le
drame humain comme jamais il ne s’est montré,
cela porte un nom : c’est l’obscène – la tâche que
se donnent aujourd’hui de plus en plus d’artistes.
L’obscène au théâtre, comme dans la vie, fait ce
qui ne se fait pas : montrer là, devant nous qui
sommes rassemblés, ce qui ne se montre pas,
mais qui se raconte, avec force tours et détours.
L’obscène au XXesiècle connaît un cas limite, que
l’on a pu voir au Festival d’Avignon, et qui a pris
le nom de « syndrome de Rwanda 94 » : dans un
spectacle du Groupov, une femme rescapée du
génocide vient raconter son histoire, son sau-
vetage, son miracle. Sur scène, elle ose l’obs-
cène absolu et vient la dire, cette histoire
impossible, cette histoire négation de l’histoire ;
elle vient la redire, tous les soirs que Dieu fait et
défait, à l’écoute de son témoignage.
Limite absolue de l’obscène : l’acteur-témoin,
le témoin acteur de sa propre vie, qui vient redire,
rejouer, relancer, balancer, dénoncer, invoquer,
exorciser une vie impossible sur le plateau du
théâtre. Quels sont ces mots obscènes qu’elle
ose dire sur la scène ? Les siens (de femme res-
capée) ? Ceux d’une autre (cette femme qui
revient d’un monde dont on ne revient pas) ?
L’obscène, on le voit, est un défi, un cri inau-
dible lancé au théâtre. Que bien peu osent rele-
ver tant il est dangereux.
Dans notre monde alentour, l’obscénité rode,
elle est là, partout, mais elle n’apparaît comme
obscène qu’à partir du moment où quelqu’un la
rapporte, et ne la réduit pas au silence assourdis-
sant de l’événement. Quand ce dernier passe
dans la parole du plateau, les choses arrivent
nécessairement du mauvais côté, du gauche –
sinistre apparition d’une parole incarnée qui ose
montrer sur la scène ce que l’image seule réussit
aujourd’hui à nous cacher de partout.
Fiction télévisuelle obscène : imaginons, un seul
instant, des mots, des vrais mots posés sur ce
qui se montre à vingt heures, dans tous les foyers
télévisuels du monde. Rêvons d’un journal télé-
visé qui dise le nom de ce qu’il montre, à com-
mencer par les noms gommés des cadavres, de
tous ceux dont on informe prétendument les
images, sans en oublier un seul. Alors arrive l’obs-
cène sur la scène. Même la liste complète des
noms propres des otages français retenus dans le
monde, nous ne la possédons pas.
Dès sa première édition, le festival Hybrides s’est
posé ces questions. Comment la réalité du monde
peut-elle documenter la scène du théâtre ? La
réponse en passe nécessairement par le choix
des thèmes, et par la volonté de ne pas les trai-
ter par métaphore. L’enjeu est bien d’affronter,
d’endurer la réalité, et de trouver la juste façon
de traiter les questions délicates, au cœur sen-
sible de notre société : l’expérience de la pri-
son, la puissance du phénomène télévisuel, le
trouble des nouvelles communautés qui pren-
nent corps dans la valeur du travail à l’ère tech-
nologique, le drame de l’immigration et le mythe
du retour au pays, la place des artistes au Moyen-
Orient, les catastrophes dites « naturelles », ou
encore les émeutes et les révoltes de la jeunesse.
Autant de thèmes qui collent en effet à nos pré-
occupations actuelles. Avec cette nouvelle diffi-
culté : la définition qui commande à l’actualité
suppose la réactivité, mais aussi la fragilité de
l’événement, qui n’a pas vocation à durer, mais
à laisser la place à l’événement du lendemain.
Pour les artistes qui s’emparent de cette question
du théâtre documentaire, il va de soi (mais il est
important de le redire) que le répertoire du
théâtre passé ne permet pas d’être à la hauteur
des questions posées par notre époque. Hamlet
est un chef-d’œuvre, mais il ne permet (vrai-
ment) pas de parler de Wikileaks, de la révolution
tunisienne, des guerres ethniques, de l’islamisme
ou de la crise financière mondiale.
Tout l’enjeu d’un théâtre documentaire est bien
de réagir vite, mais aussi de durer, et de tenir le
fil des questions soulevées. C’est ce que propo-
sent les acteurs et performeurs Yan Duyvendack
et Omar Ghayatt, respectivement suisso-hollan-
dais et égyptien, avec Made in Paradise, un spec-
tacle puissant qui fait bouger les lignes et grincer
nos préjugés, même inconscients.
Au fil d’une vingtaine d’épisodes, les deux
hommes racontent l’histoire de leur rencontre,
la violence des clichés qui empoisonnent forcé-
ment la relation de travail, et les difficultés chro-
niques d’un lien forcément conflictuel. Nous ne
pourrons en voir que cinq, il s’agit donc de voter,
à la suisse, et comme personne n’est d’accord,
c’est la version d’autorité, à l’égyptienne, qui
finit par compléter le choix.
L’épisode en tête de toutes les sélections s’inti-
tule : « Où étiez-vous le jour du 11 septembre
2001 ? » Après le récit du Suisse, banal et empa-
thique, l’Egyptien raconte la liesse qui s’empare
de son quartier du Caire, avec moult détails,
criants de vérité. Brutalement, il décroche, dévi-
sage les spectateurs massés en cercle autour de
lui : « Vous m’avez cru ? Vous m’avez cru. Vous
avez cru que je vous racontais mon histoire ? Cette
histoire est la seule que vous pouvez croire, venant
d’un musulman. »
Chaque spectateur prend sa question dans l’es-
tomac, perçante comme un couteau. Quelques
minutes plus tard, les deux acteurs nous deman-
dent ce que nous savons de l’Islam… Et les gens
parlent, vraiment, de cette question centrale
dont nous savons si peu de choses, ici au nord
de la Méditerranée.
Tapi dans l’ombre de la programmation
d’Hybrides, il y a ce doute réel, lancinant : pour-
quoi – pour quel sens – faire encore du théâtre ? Et
il y a cette proposition de travail, qui n’est pas
une réponse, mais plutôt cette évidence : l’huma-
nité meurt un peu moins à se raconter, à se por-
ter sur les scènes, par le mauvais côté. Ce n’est
pas l’évidence du théâtre, mais la certitude, jus-
tement, que le théâtre n’est pas évident, sans
réelle transparence, jamais acquis, toujours en
train de se perdre, pour le pire, avec cette insis-
tance impérieuse : il faut y revenir, y résister,
reconquérir encore aujourd’hui ce monde du faux
et y camper, provisoirement, pour un instant,
les détresses de chacun de ceux qui font le monde
– le vrai, dit-on.
Regarder la modernité en face, c’est accepter sa
redoutable obscénité. La représentation du
déchirement humain oblige au déchirement des
représentations. Si la scène prend la responsa-
bilité de parler vraiment de la guerre et de nos
catastrophes continues, elle doit assumer que
la guerre pénètre dans nos phrases, dans nos
formes et nos manières de dire. La modernité
entendue de cette oreille arrive encore une fois
du mauvais côté. Elle nous fait entendre le monde
comme après un bombardement. Il est obscène,
et il faudra bien l’entendre, et s’en faire les
reporters. Au plus près de l’événement, au plus
près de la scène.
Bruno Tackels
1. Remarquons au passage que nous avons affaire ici à l’exact contraire de
la définition de l’aura du théâtre telle que Benjamin l’avait magnifique-
ment saisie : l’apparition d’un lointain, aussi proche soit-il.
Entretien autour des Témoins,
avec Julien Bouffier.
Depuis plusieurs années, vous
vous intéressez à ce que l’on
nomme « l’actualité », aux
événements du présent le plus
immédiat, et à la manière dont le
théâtre peut s’en emparer. Vous
en venez donc à vous interroger
sur le journalisme, et sur le lien
qu’il peut y avoir entre ce travail
et celui des fabricants de fiction...
« A l’origine de ce processus, il y a
cette volonté d’en finir avec les
histoires anciennes pour
construire notre théâtre, et pour
faire vivre une scène qui parle
vraiment la langue d’aujourd’hui.
J’ai beaucoup de mal avec l’idée
que les auteurs classiques révèlent
les questions de notre société
actuelle. J’y vois des détours et
des circonvolutions inutiles,
malgré la beauté de ces langues.
On pourrait vous objecter qu’il
existe des textes contemporains
qui s’emparent pleinement des
questions de notre temps.
« J’y ai cru un temps, mais il n’y en
a pas tant que cela ! En France,
peu de dramaturges écrivent en
serrant au plus près les
événements qui nous entourent. Et
il y a sans cesse la tentation de les
contourner par un travail formel et
stylisé sur la langue. D’où mon
désir de travailler avec d’autres
supports, pour retrouver plus
d’immédiateté, et gagner en
précision sur ce que je veux
raconter de notre société. Dans Les
Vivants et les morts, un romancier
et cinéaste, Gérard Mordillat,
s’empare de la question ouvrière et
décrypte le drame d’une usine qui
ferme ses portes. Je cherche
ailleurs, en puisant dans l’actualité
directe, qui ne cesse de nous
raconter des histoires. Avec les
questions qu’elle soulève : quel
événement fait l’actualité ? Que
signifie l’actualité ? Comment
envisager son caractère mouvant ?
A-t-elle un sens, puisqu’elle
change en permanence ?
Contrairement au journalisme
de reportage, qui produit des
« papiers chauds »(contrairement
aux « froids », écrits avec le recul
de l’analyse), le théâtre ne peut
avoir lieu dans le feu de l’action.
« Oui, comme s’il fallait attendre
que le corps soit froid pour en
parler sur une scène…
Tout l’enjeu est de se donner
les moyens d’un véritable travail
théâtral tout en étant
dans l’immédiateté.
« C’est bien ce défi que nous
avions relevé à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon, les deux
années précédentes, en proposant
des “Journaux Théâtraux”. Chaque
jour, pour ces “JT”, il s’agissait
de trouver de l’information,
de créer une histoire et de
la restituer le soir sur le plateau.
Nous avons prolongé cette
recherche avec Les Témoins,
dont une première version a été
présentée à la Chartreuse
durant le Festival d’Avignon 2010,
et que nous déclinerons durant
cette 3eédition d’Hybrides. Dans
notre projet, cette mise
en perspective à travers le temps
qui passe est essentielle. Les
Témoins n’ont pas pour vocation
de se focaliser exclusivement
sur cet événement. Il s’agit plutôt
d’une sorte de média qui se
décline en différents épisodes,
traitant de multiples questions qui
se constituent en feuilleton.
Par exemple, l’arraisonnement de
la flottille au large de Gaza par les
Israéliens montrent bien que
l’image devient rapidement une
arme. Comment le théâtre peut-il
la relayer ? »
UN THÉÂTRE
D’ACTUALITÉ
L’enjeu d’un théâtre documentaire est
de réagir vite, mais aussi de durer, de
tenir le fil des questions soulevées.
Who’s Afraid of
Representation? de
Rabih Mroué. Photo :
Houssan Mchaiemch.

« La guerre a toujours existé. Elle est destinée à être la
compagne de l’homme », écrit Le Clézio. Elle est même
devenue un spectacle mondial, face auquel le théâtre,
entre mythe et histoire, s’inscrit dans la chair du monde.
LA CATASTROPHE
PERMANENTE
Vingt ans déjà. Le 17 janvier 1991, un déluge de
bombes américaines pleuvait sur Bagdad. Et CNN,
lucarne du « in real time », en assurait mondia-
lement la diffusion simultanée. Même plus besoin
des écrans du cinéma, ni même d’acteurs, pour ce
scénario post-hollywoodien au titre accrocheur :
Tempête du désert. Un film d’action qui fut
à Lawrence d’Arabie ce que le cinéma parlant fut
au muet. La naissance d’une industrie. Le story-
telling de la guerre, avec produits dérivés sur
consoles vidéo. Plus besoin de dialogues, même
les images sont de synthèse, le nouvel ordre mon-
dial est binaire : le premier qui ne tue pas est
mort. Depuis que les grands enfants du
Pentagone ont sacrifié leurs soldats de plomb
au profit des effets spéciaux, le laser game de la
guerre a ses fabricants d’images, recrutés parmi
les scénaristes de La Guerre des étoiles. C’est qu’il
faut vendre le spectacle et ses colifichets.
Bataille des quotas. Le tiers-monde a aussi sa
propre industrie cinématographique, et veut son
quart d’heure de gloire sur CNN. En pleine fré-
nésie technologique, l’âge des cavernes profite
de la démocratisation de la vidéo et se découvre
un scénariste hors pair, Oussama Ben Laden. A la
surprise générale, c’est un film afghan, Twin
Towers, qui rafle le prix de la mise en scène en
septembre 2001, premier acte d’un long feuille-
ton planétaire, Al-Qaida. Comme le disait Régis
Debray, « l’art militaire suppose une visibilité, et
exige un public. Notre nouveau milieu technique
optimise les retombées publicitaires de l’acte meur-
trier, avec le lignage de l’instant, la dramatisa-
tion, l’effacement du collectif, le manichéisme.
On ne joue pas devant une salle vide, et un poseur
de bombes sans preneurs de vues, c’est un épisto-
lier sans timbre, ou un acteur sans public. Quand
c’est le simulacre qui fait l’acte, et la caméra, la
manifestation, le monde entier s’offre en théâtre
d’opérations, pourvu qu’il soit câblé. »(1)
Illusion, cependant, que dans ce théâtre d’opé-
rations, tout serait à vue. Comme l’écrivait déjà
Henri Barbusse après la Première Guerre mon-
diale : « La pleine bataille est trop grande pour
qu’on la voie autrement que par les signes qu’on
lit. »(2) A une époque où n’existaient ni cinéma,
ni télévision, ni Internet, la tragédie grecque,
ce « théâtre d’avant la psychologie », « au carre-
four du mythe et de l’histoire »(3), assurait déjà la
chronique des conquêtes et défaites, en person-
nifiant l’action. S’il s’agit « d’inscrire la politique
et l’histoire dans la chair du monde »(4), le théâtre
peut bien rivaliser avec les mass-medias. La fin du
XXe siècle ne manque pas de pièces nées du fracas
des bombes. Napalm, d’André Benedetto, et V
comme Vietnam, d’Armand Gatti, créés en 1967,
s’inscrivaient ainsi dans un théâtre de l’enga-
gement, en lien avec les luttes anti-impérialistes
de l’époque. On pourrait encore citer Rwanda 94,
du Groupov ou Les Cercueils de zinc (1992), « essai
d’effraction » magistralement adapté par Didier-
Georges Gabily des témoignages recueillis par
Svetlana Alexievitch sur la guerre d’Afghanistan.
Les guerres sont multiples, leur théâtre inces-
sant, et pas toujours sous les projecteurs. Ne
parlons pas même des coulisses politiques de ces
« ballets diplomatiques » dont on sait combien ils
sont ourdis par de piètres intrigues. Parlons de
ce qui est tu, dans la permanence de conflits qui
n’en finissent jamais vraiment, comme au Moyen-
Orient. Invitée à Hybrides3 en partenariat avec
Kawenga , la compagnie franco-belgo-libanaise
Arcinolether s’attèle depuis 2006 à un Projet
Liban qui se nourrit d’archives vidéos et sonores
pour révéler autant les stigmates du conflit dans
une ville comme Beyrouth que la vanité des per-
ceptions iconographiques qui en sont issues.
Loin des clichés s’écrivent des humanités bles-
sées. Dans Alger Terminal 2, Rachid Akbal et
Julien Bouffier évoquent l’horreur des « années
noires » en Algérie à travers le périple de Kaci,
venu à Alger retrouver son fils, sans cesser d’être
hanté par le souvenir d’Aïcha, son amour de jeu-
nesse tuée dans un massacre à Relizane.
Nous sommes entrés dans un monde de « catas-
trophe permanente » :« La guerre a commencé,
personne ne sait où ni comment. En fait, elle a
toujours existé, il y a eu des trêves, l’illusion de la
paix, mais elle est destinée à être la compagne de
l’homme », écrit Jean-Marie Gustave Le Clézio(5).
La guerre n’a même plus besoin d’être ouverte-
ment guerrière. Dans War is War, la compagnie
The Erasers mixe le cinglant jonglage des méta-
phores de la guerre contemporaine, qu’elles
soient langagières (la propagande commerciale),
visuelles (le choc des images), scientifiques (les
armes biologiques), ou tout simplement… diver-
tissantes (les jeux vidéo). La guerre est hybride,
mais le festival Hybrides, lui, n’est pas en guerre.
Il en dévisage juste les leurres.
Jean-Marc Adolphe
1. Régis Debray, « La juste mise en scène », allocution lors du colloque
Mises en scène du monde, au TNB de Rennes, en novembre 2004. Mises en
scène du monde, édition Les Solitaires Intempestifs, 2005.
2. Henri Barbusse, Ce qui fut sera, 1930.
3. Georges Banu, Avant-propos. Tragédie grecque. Défi de la scène contem-
poraines. Etudes théâtrales n° 2, 2001.
4. Myriam Revault d’Allonnes, Merleau-Ponty, La chair du politique,
Michalon, 2001.
5. J.M.G Le Clézio, La Guerre, Gallimard, 1970.
« Notre nouveau milieu technique
optimise les retombées publicitaires
de l’acte meurtrier. » (Régis Debray)
Alger Terminal 2 de
Rachid Akbal, mise en
scène Julien Bouffier.
Photo : Régine Abadia.
La compagnie
Arcinolether
à Beyrouth.
Photo : D. R.
War is War, de The
Erasers. Photo : D. R.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%