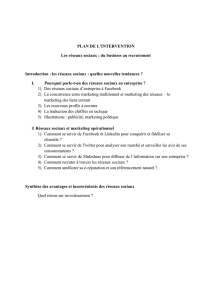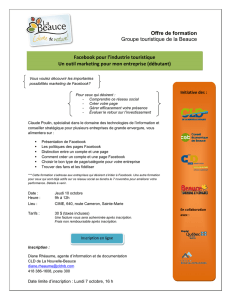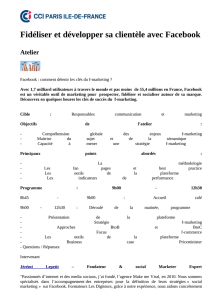Utilisation du réseau Facebook dans une campagne de prévention

Communiquer
Revue de communication sociale et publique
10 | 2013
Diversité des usages santé d’Internet et enjeux de
communication
Utilisation du réseau Facebook dans une
campagne de prévention pour jeunes adolescents :
analyse secondaire des données d’une étude
postcampagne
Use of the Facebook network for a prevention campaign adressed to teenagers:
data’s secondary analysis from a post-campaign study
Claude Giroux
Édition électronique
URL : http://communiquer.revues.org/532
DOI : 10.4000/communiquer.532
ISSN : 2368-9587
Éditeur
Département de communication sociale et
publique - UQAM
Édition imprimée
Date de publication : 1 décembre 2013
Pagination : 127-146
Référence électronique
Claude Giroux, « Utilisation du réseau Facebook dans une campagne de prévention pour jeunes
adolescents : analyse secondaire des données d’une étude postcampagne », Communiquer [En ligne],
10 | 2013, mis en ligne le 01 février 2015, consulté le 01 octobre 2016. URL : http://
communiquer.revues.org/532 ; DOI : 10.4000/communiquer.532
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
© Communiquer

Certains droits réservés © Claude Giroux (2013)
Sous licence Creative Commons (by-nc-nd).
ISSN 1913-5297
127
www.ricsp.uqam.ca
Ri P
CS
Revue internationale
Communication sociale et publique
Utilisation du réseau Facebook dans une
campagne de prévention pour jeunes
adolescents : analyse secondaire des données
d’une étude postcampagne
Claude Giroux, B. Pharm., MA,
Doctorant en communication publique, coordonnateur de la recherche, Direction des communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec1
Résumé
L’emploi de Facebook lors de campagnes sociales est récent et peu étudié. L’analyse
secondaire des données provenant de l’évaluation de certaines campagnes permet
d’améliorer nos connaissances à cet égard. L’étude présentée s’appuie sur l’évaluation d’une
campagne de prévention du tabagisme où Facebook servait d’alternative à la diffusion
scolaire. Deux recherches évaluatives ont conrmé la pertinence du véhicule pour cette
campagne ciblant des jeunes âgés de 11 à 14 ans. Reprenant les données de ces travaux dans
une perspective élargie, notre analyse examine le recours à l’instrument lors de campagnes
de prévention ciblant des adolescents. Facebook étant théoriquement inaccessible aux
moins de 13 ans, la question revêt un intérêt particulier. Tout en reconnaissant la pertinence
du réseau social, l’étude suggère la faible validité des informations fournies par Facebook
sur l’âge des utilisateurs. Cette étude illustre l’intérêt de l’analyse secondaire de données
provenant d’évaluations postcampagnes dans l’examen des campagnes de santé publique.
Mots-clés : Facebook; réseaux sociaux; promotion de la santé; campagnes sociales;
prévention du tabagisme; adolescents; analyse secondaire; publicité, marketing.
The use of Web 2.0 in health promotion campaigns is a recent practice. Secondary analysis
of campaign’s evaluations offers an interesting avenue to complete our knowledge on that
topic. This article is based on data from researches commissioned by public authorities
to evaluate an anti-tobacco campaign using online social networks as a substitute to
traditional diffusion in schools. The rst evaluation conrmed the usefulness of Facebook
in broadcasting health promotion material to kids aged 10 to 14 years old. As Facebook
is theoretically closed to users aged less than 13 years, these results are of some interest
and conrm the potential of Facebook to reach preteens or teens. The lack of validity of
the data regarding the age of registered Facebook users also suggest caution when using
such material. This study illustrates the potential for health promotion researchers of
analysing evaluation data from public health campaigns.
Keywords : Facebook; social networking; health promotion; social campaigns;
smoking; teenagers; secondary analysis; social advertising; marketing.
1. Le contenu de ce texte n’engage que son auteur et ne véhicule aucune opinion ou position gouvernementale.

RICSP, 2013, n. 10, p. 127-146
128 | C. Giroux
« When surveys intended for purely practical purposes also yielded substantive ndings of
scientic signicance, that was an extra dividend and the pleasures of work were enhanced. »
(Hyman, O’Gorman et Singer, 1991, p. 13)
Facebook fait partie des instruments prisés par les publicitaires de notre époque. Peu de
travaux scientiques traitent cependant de son intégration aux campagnes de promotion
de la santé et des modalités d’évaluation de ce type d’action. Utilisant une approche où
la publicité sociale est considérée comme un phénomène dont la complexité justie
l’intégration de contributions interdisciplinaires, nous présentons une analyse secondaire
de données initialement colligées par les responsables d’une campagne gouvernementale de
prévention du tabagisme.
Les résultats de deux études postcampagnes qui sont analysés, permettent d’examiner
la pertinence de Facebook dans des campagnes de santé publique ciblant une population de
moins de 13 ans, et d’estimer la validité des informations sociodémographiques présentes
sur Facebook.
L’approche utilisée
Depuis plusieurs décennies (Renaud et Bouchard, 2005; Schevitz, 1918), les agences de
santé publique orchestrent des campagnes de publicité sociale (Wakeeld, Loken et Hornik,
2010). Ces campagnes de promotion de la santé combinent des fondements théoriques
(communication persuasive, causes du tabagisme, théories des médias, communication
du risque, etc.) à différentes considérations pratiques liées aux tendances publicitaires ou
aux contraintes inhérentes à chaque campagne (économiques, politiques, stratégiques,
administratives). L’interaction de ces éléments et le fait que certaines contraintes
techniques sont rarement mentionnées par les promoteurs compliquent le travail des
chercheurs souhaitant étudier la création et l’évolution de campagnes de promotion de la
santé (Renaud, Caron-Bouchard, Martel, Gagnon et Pelletier, 2009).
Notre démarche s’appuie sur la conviction qu’il est utile de situer l’étude des pratiques
de publicité sociale dans une perspective élargie, malgré les difcultés caractérisant
l’analyse de phénomènes aussi complexes. Espace où interagissent les différentes théories
de la persuasion, territoire de chevauchement de différentes disciplines scientiques,
instrument d’intervention en santé des populations…la publicité sociale est à la fois un
objet de réexion et une pratique professionnelle ancrée dans le quotidien des sociétés
contemporaines. Cette dualité inhérente doit être prise en compte. Les dimensions
théoriques des campagnes sociales sont analysées, scrutées, étudiées par des chercheurs
et des groupes d’experts. En concentrant nos efforts sur ces enjeux, on risque cependant de
perdre de vue le fait qu’une publicité n’existe sans être soutenue nancièrement, produite et
ultimement diffusée vers son public. Un public qui évolue dans un univers caractérisé par
un encombrement publicitaire sans précédent (Randolph et Viswanath, 2004; Rosengren,
2008). Une compréhension globale de la publicité sociale peut difcilement être réduite à
l’observation de certaines de ses composantes.
Le phénomène est complexe et polymorphe, ce qui permet aux chercheurs de
différentes disciplines intéressés à de diverses questions de contribuer à l’amélioration des
connaissances. Une même campagne se présente, pour les publicitaires ou les spécialistes
de la santé publique, comme une activité professionnelle s’appuyant sur différents savoirs
théoriques et pratiques (Grier et Kumanyika, 2010; Nyilasy et Reid, 2009). Par ailleurs,
pour les décideurs, elle s’avère un dé de gestion (Lilien, 2011). Pour les institutions qui la
produisent, elle constitue une préoccupation organisationnelle (Polit, 2012). Alors que pour

Utilisation du réseau Facebook dans une campagne de prévention pour jeunes adolescents | 129
l’État, il s’agit aussi d’un enjeu stratégique ou politique (Arkin, Denniston et Romano, 1990;
Berlivet, 2004; Raftopoulou et Hogg, 2010).
Cette complexité explique probablement les limites des connaissances actuelles sur les
campagnes sociales. La nature plurielle et les contours ous de ces campagnes cadrent mal
avec les contraintes de recherches appartenant à une seule tradition disciplinaire (Kreps
et Maibach, 2008). Dans son approche de la publicité sociale, un chercheur restreint
généralement son étude à une dimension, selon son expertise et en fonction du temps et
des budgets disponibles. Son travail doit aussi répondre aux préoccupations du public à qui
les résultats sont destinés. Cette nécessaire réduction de la complexité, justiée puisqu’elle
facilite l’étude du sujet, ne doit pourtant pas en masquer les différentes dimensions et leurs
interactions.
La place du marketing dans l’étude des phénomènes de publicité sociale
Tenir compte de travaux provenant d’autres disciplines aide à reconstruire la globalité de
la publicité sociale, en liant et en associant les différentes pièces d’un véritable casse-tête
interdisciplinaire (Parrott et Kreuter, 2011). Le rapprochement des théories de la persuasion
et des théories des médias, comme le fait Frenette (2009) dans son approche en tandem de
la publicité sociale, ou comme le proposent Kreps et Maibach (2008) en plaidant pour le
rapprochement des sciences de la communication et des sciences de la santé, témoignent
d’une perspective d’intégration de cet ordre. Les contraintes d’une vision transdisciplinaire,
exigeant des chercheurs qu’ils s’aventurent hors de leur zone de confort, sont justiées
puisque l’exercice est destiné à améliorer la santé des personnes et des populations (Parrott
et Kreuter, 2011).
Les campagnes de promotion de la santé illustrent bien la complexité de la publicité
sociale. Elles sont étudiées en santé publique (Gray et al., 2012; Wakeeld et al., 2010),
en sociologie (Pratkanis et Aronson, 2002), en politique (Raftopoulou et Hogg, 2010), en
psychologie (Jessop et Wade, 2008; Philip, 2004), en communication (Bouman et Brown,
2010; Paek, 2008) et en marketing (Bernhardt, 2004; Parrott et Kreuter, 2011). L’apport
du marketing semble toutefois limité dans le discours entourant les campagnes sociales,
symptôme probable d’un malaise des milieux sanitaires à associer la santé aux activités
mercantiles (King, 2002; Ling, Franklin, Lindsteadt et Gearon, 1992).
Quand on le dit « social », le marketing s’intègre plus facilement aux réexions qui
portent sur le recours à la publicité pour promouvoir la santé (Daniel, Bernhardt et Eroglu,
2009; Edgar, Volkman et Logan, 2011; Loss et Nagel, 2010), sans pour autant s’affranchir
des doutes éthiques entourant des contributions provenant du domaine publicitaire
(Freimuth, Hammond et Stein, 1988; Loss et Nagel, 2010).
L’analyse qui suit s’appuie sur des données obtenues lors de recherches postcampagnes,
une pratique de recherche normale en marketing. Certains scientiques excluent d’emblée ce
type de recherches de leurs analyses, privilégiant les données provenant de revues savantes
ou d’ouvrages scientiques (Snyder et Hamilton, 2002). Plusieurs autres (Bertrand,
Goldman, Zhivan, Agyeman et Barber, 2011; DuRant, Wolfson, LaFrance, Balkrishnan et
Altman, 2006; Russell, Clapp et Dejong, 2005; Scheier et Grenard, 2010; Valente et Saba,
1997), par contre, y ont recours. C’est le choix que nous avons fait, cherchant à construire de
nouveaux savoirs en analysant dans une perspective de communication et de santé publique
des résultats issus de la recherche en marketing.

RICSP, 2013, n. 10, p. 127-146
130 | C. Giroux
L’analyse secondaire de donnée et la recherche en publicité sociale
L’analyse secondaire de données consiste à utiliser, dans une étude, des données provenant
de recherches précédentes (Doolan et Froelicher, 2009; Gomm, 2009; Heaton, 2008).
Essentiellement, on utilise ces informations pour répondre à des questions de recherche
différentes de celles posées dans la démarche initiale. On considère que la réutilisation de
résultats par un chercheur impliqué dans une première enquête (situation relativement
fréquente) est une forme de recherche secondaire (Gomm, 2009; Heaton, 2008). C’est le
cas ici.
La pertinence d’utiliser l’analyse secondaire repose sur différents critères, dont la
crédibilité de l’étude primaire qui doit convenir à la nouvelle question de recherche (Doolan
et Froelicher, 2009). À cet égard, on convient généralement de la qualité des résultats
de recherches publiées par l’État, considéré comme une source importante de données
secondaires (Gauthier et Turgeon, 1995). Dans les sphères gouvernementales, la recherche
portant sur une campagne de publicité, même si elle compose avec plusieurs obstacles
(Arkin et al., 1990), est généralement considérée comme utile et nécessaire (Silk, Atkin
et Salmon, 2011). Certaines instances publiques en font même une obligation (Brug, Tak
et Velde, 2011). Avantage supplémentaire, la transparence imposée aux administrations
publiques modernes facilite l’accès aux rapports d’évaluation portant sur les campagnes
de publicité gouvernementales; Il serait plus difcile d’obtenir des informations de cette
nature dans le cas de campagnes commerciales où des enjeux de compétitivité justient
souvent le secret des informations récoltées.
Dans le cas de la campagne liée aux données utilisées, la collecte de données et son
analyse avaient été conées à une entreprise commerciale de recherches et sondages,
mandatée et supervisée par l’institution ministérielle, mais indépendante des publicitaires.
Cette entreprise a présenté deux rapports (SOM, 2012a; SOM, 2012b), non publiés mais
accessibles aux chercheurs.
La campagne étudiée
Prémisses théoriques d’une campagne de prévention du tabagisme ciblant les
jeunes
Le tabagisme est un problème de santé publique contre lequel plusieurs gouvernements,
depuis des décennies, ont mené diverses campagnes publicitaires, (Brinn, Carson, Esterman,
Chang et Smith, 2010; Peracchio et Luna, 1998; Vallone, Duke, Cullen, McCausland et
Allen, 2011). Au sein des différentes actions de protection de la santé publique, la lutte
au tabagisme serait l’enjeu bénéciant des plus importants investissements publicitaires
(Cohen, Shumate et Gold, 2007). L’efcacité de campagnes anti-tabagiques est admise
(Lalonde et Heneman, 2004), malgré certaines réserves portant sur la méthodologie des
études publiées (Brinn et al., 2010).
Le tabagisme est lié à plusieurs facteurs qui relèvent autant des personnes que de leur
environnement (O’Loughlin, Karp, Koulis, Paradis et DiFranza, 2009). Les déterminants
du tabagisme varient avec l’âge des individus, les époques ou les contextes culturels
(O’Loughlin et al., 2009), et les résultats d’une même campagne vont de bons à mauvais
selon la défavorisation du milieu où elle est diffusée (Lasnier, Leclerc et Hamel, 2012).
Tenant compte de la diversité de ces éléments, il semble utopique d’espérer découvrir une
stratégie préventive unique, sorte de « prêt-à-porter » publicitaire convenant à toutes les
situations (Audrain-McGovern et al., 2004).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%
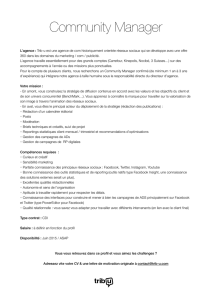

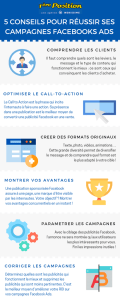
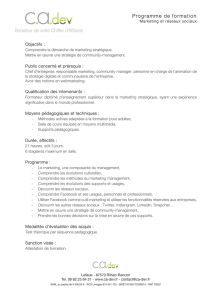
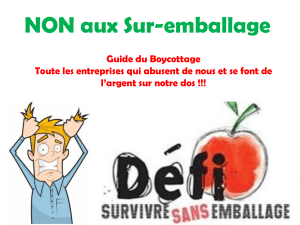
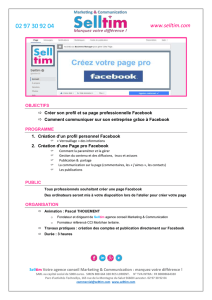
![[VDD] Facebook Power Volume1](http://s1.studylibfr.com/store/data/009052136_1-ce4c1a3d400417983bfd11b8a49bb2a0-300x300.png)