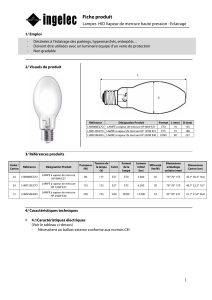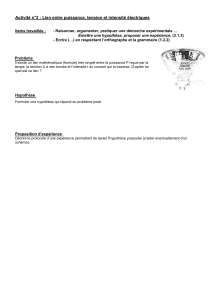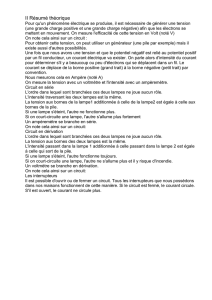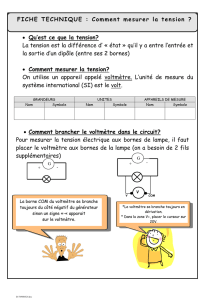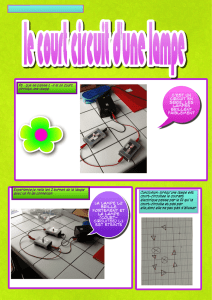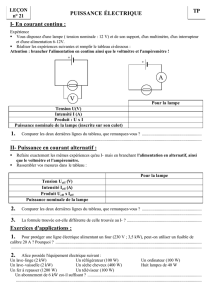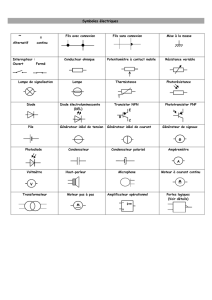Effet photoélectrique

Effet photoélectrique
EA 3400 11211
Mode d’emploi
et
résultats expérimentaux
Centre technique et pédagogique
de l’Enseignement de la Communauté française
Version 01

1. Champ d’utilisation de l’appareil
L’appareil permet de mettre en évidence l’effet photoélectrique, de faire une estimation de la valeur de
la fréquence de ce seuil de l’effet photoélectrique ainsi qu’une estimation de la constante de Planck.
Pour fonctionner, l’appareil nécessite une lampe à vapeur de mercure (réf. CTP: SL 0500 31216)
et son alimentation, ainsi qu’un voltmètre.
2. Description de l’appareil
L’appareil (schéma 1) est constitué d’un support sur lequel sont placés:
• le dispositif de fixation de la lampe à vapeur de mercure;
• une tour à base rectangulaire sur laquelle se trouvent:
- une cellule photoélectrique (logée dans un boîtier de protection en aluminium
peint en noir),
- deux douilles destinées au raccordement du voltmètre,
- un interrupteur permettant la remise à zéro de l’appareil;
• une alimentation électrique (à raccorder au secteur 230 V ~).
L’appareil comprend en outre un jeu de trois filtres (jaune-orange, vert, bleu).
1

La cellule photoélectrique est une ampoule de verre vide d’air dans
laquelle se trouvent un demi-cylindre métallique P, appelé cathode,
recouvert d’une couche photosensible (par exemple: sodium, potassium,
oxyde de césium...) et un fil conducteur F disposé selon l’axe du demi-
cylindre. Le schéma 2 présente une coupe transversale de cette cellule.
3. Principe de fonctionnement
Lorsque la cellule est éclairée par de la lumière provenant,
par exemple, d’une lampe à vapeur de mercure, il est
possible que la plaque P émette des électrons (appelés
parfois photoélectrons). Ceci dépend de la longueur d’onde
de la lumière incidente et de la nature du revêtement de la
plaque.
La cellule est raccordée à un condenseur AB (C = 500 pF)
comme le montre le schéma 3.
Si de la lumière arrive sur la plaque P de la cellule
avec une longueur d’onde adéquate (l< 700 nm), des
électrons e en sont extraits; la plaque P, ayant perdu
des électrons, se charge positivement (schéma 4).
Une cellule photoélectrique, lorsqu’elle est éclairée,
constitue un générateur.
Dans le montage ci-contre (schéma 4), la cellule
photoélectrique charge le condensateur AB. En raison
de la grande résistance interne de la cellule, quelques
secondes s’écoulent avant que la charge du
condensateur atteigne sa valeur maximale.
2

Le graphique bien connu ci-contre montre
l’évolution au cours du temps de la tension
U’ aux bornes du condensateur au cours
de sa charge.
La tension U aux bornes du condensateur
chargé permet de déterminer l’énergie
cinétique des électrons émis par la plaque
P.
En appliquant le principe de la conservation de l’énergie, on a:
énergie fournie = énergie reçue
hn= Wextr + Ekoù h: constante de Planck
n: fréquence de la lumière
Wextr: travail d’extraction
Ek: énergie cinétique des électrons
Mais: Ek= eU où e: charge de l’électron
Alors: hn= Wextr + eU
Si l’on éclaire l’ampoule avec de la lumière violette, on constate que la tension U est supérieure à celle
obtenue lorsqu’elle est éclairée avec de la lumière jaune.
Si l’on éclaire l’ampoule avec de la lumière rouge ou infrarouge, plus aucune tension n’apparaît aux
bornes de l’ampoule. À la limite, lorsque la lumière incidente a la fréquence qui convient pour
uniquement arracher les électrons de la plaque P, sans leur donner d’énergie cinétique, U = 0.
Alors: hn= Wextr
La fréquence de la lumière correspondant à ce phénomène est appelée fréquence de seuil n0.
L’équation (2) devient:
Wextr = hn0
En remplaçant (3) dans (1), on a:
3
U = (n– n0)
h
e
(1)
(2)
(3)

Cette équation est celle d’une droite représentant la
tension U aux bornes du condensateur en fonction de la
fréquence nde la lumière incidente. La pente de cette
droite vaut . La charge de l’électron étant connue
(e = 1,6 . 10–19 C), on peut calculer la valeur de la
constante de Planck h.
Le point de percée de cette droite avec l’axe des
fréquences donne la fréquence du seuil n0de l’effet
photoélectrique.
4. Principe des mesures
Pour chaque fréquence de la lumière incidente, il faut mesurer la tension qui apparaît aux bornes du
condensateur.
Pour sélectionner la fréquence de la lumière qui atteint la cellule photoélectrique, il faut interposer un
filtre très sélectif entre une source de lumière polychromatique (ici, la lampe à vapeur de mercure) et
la cellule.
Le graphique ci-dessous montre les principales raies émises par une lampe à vapeur de mercure et
leur intensité relative IR.
4
h
e
Théoriquement, chaque filtre laisse passer une fréquence bien déterminée de la lumière de la lampe à
vapeur de mercure. Malheureusement, le prix des filtres très sélectifs est particulièrement élevé1. Le
matériel proposé présente un bon compromis entre la qualité des filtres (donc des mesures) et le coût
de l’appareil. Celui qui le souhaite peut toujours se procurer d’autres filtres correspondant à d’autres
fréquences de la lumière produite par la lampe à vapeur de mercure ou par toute autre lampe spectrale
(par exemple, une lampe à vapeur de sodium).
1Le prix de ces filtres varie, suivant leurs dimensions, entre 125 et 150 pièce.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%