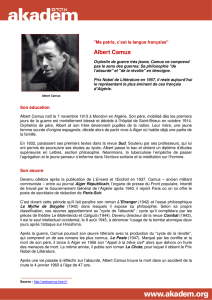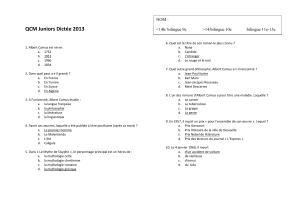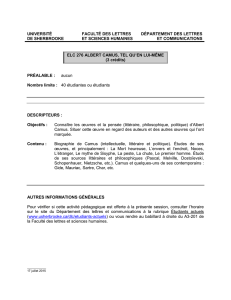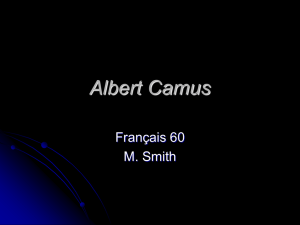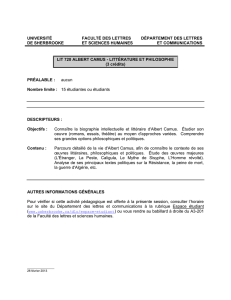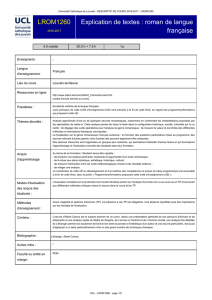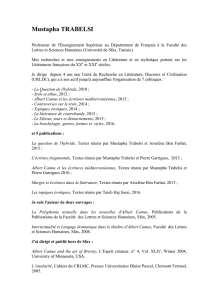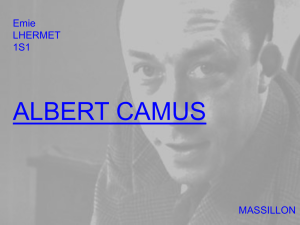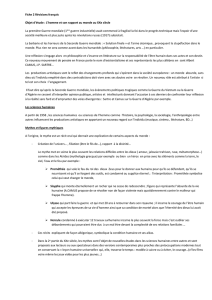Note relative à la relance de l`exécution du PAI

AVANT-PROPOS
Le 4 janvier 1960, à 13 h 55, sur la route de Sens à Paris,
une voiture qui roule à vive allure dérape et vient heurter un
platane. Parmi les quatre personnes à bord, deux femmes sont
légèrement blessées. Le conducteur de la voiture, monsieur
Michel Gallimard, éditeur d’Albert Camus, mourra quelques
jours plus tard.
Le quatrième passager, cependant, gît entre la carrosserie
fracassée. C’est Albert Camus. Il a été tué sur le coup ! « À
demi engagé par le choc dans la malle arrière, les yeux un
peu exorbités, l’air calme comme étonné », c’est par un « bruit
terrible » que cet écrivain, créateur et chroniqueur sombre
dans la mort : « le grand vide où le cœur de l’homme
s’apaise », disait-il.
Ce défenseur de l’humanité absurde avait vu le jour le
7 novembre 1913 à Mandovi, département de Constantine en
Algérie. Fils d’un ouvrier agricole et d’une mère servante,
Albert Camus n’eut guère de chance dans sa vie. Il a un an
lorsque son père meurt au champ d’honneur. Enfant pauvre
mais studieux, le jeune Camus obtient son baccalauréat à l’âge
de seize ans. Il n’a pas le temps de respirer ; la tuberculose
l’attend, ce qui compromet au grand jamais son rêve de briguer
une agrégation de philosophie.
9

Il fait alors le fou pour ne pas le devenir. À vingt ans, il se
marie et divorce aussitôt. Il exerce plusieurs petits métiers
dans la privation et une totale pauvreté. Entre-temps, il écrit,
anime des troupes théâtrales et devient journaliste. En 1940, il
se remarie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Albert
Camus émigre en France où il prend part à la rédaction du
journal Combat dont il devient rédacteur en chef après la
libération.
Au lendemain de la guerre, Albert Camus est un écrivain
déjà connu. Ses idées passionnent les gens de nombreux pays
encore sous le choc des ruines morales et matérielles laissées par
les deux guerres mondiales. Le 17 octobre 1957, l’Académie
royale de Stockholm lui décerne le prix Nobel de littérature.
N’est-ce pas là une récompense méritée dont il faut jouir ?
Mais encore une fois, la mort est là. Elle le guette !
Avec ses vingt-deux titres ‒ dont cinq récits ‒, cinq pièces
de théâtre, dix essais et les deux carnets, l’œuvre d’Albert
Camus apparaît dans son ensemble comme un plaidoyer en
faveur de l’homme1, l’homme seul et étranger au monde,
l’homme victime du mal alors qu’il est souvent innocent, un
homme qui vit dans un perpétuel balancement entre le bien et
le mal, le oui et le non, la mesure et la démesure, l’envers et
l’endroit, l’exil et le royaume, entre le bonheur et le malheur…
Bref, un homme toujours en situation frontière. L’œuvre même
d’Albert Camus est le reflet de cette alternance de contraires.
Elle se situe entre la philosophie et la littérature et souvent
entre la philosophie et la poésie.
Cette bipolarité n’étiole cependant pas la profondeur de la
pensée d’Albert Camus. Elle n’atténue également en rien la
pertinence des analyses profondes que Camus fait sur le tragique
de la condition humaine ; une condition qui fait de l’homme
un être mortel rivé au temps et soumis à l’histoire, un homme
10

qui ne gagne que le fruit de sa peine et dont les quelques rares
occasions de joie laissent traîner derrière elles une ombre de
peine et de douleur, d’où l’angoisse existentielle qui fait de sa
vie tout un drame.
Qui resterait indifférent face au bonheur simple et multi-
forme dont Camus se fait le défenseur ? Dans ses œuvres de
jeunesse, ce bonheur se profile à l’horizon. Il se révèle petit à
petit, prend forme, mais s’embourbe finalement dans les vagues
de l’existence où il devient flou et brouillé. Il suffira alors d’un
éclair intuitif pour percevoir ce bonheur fulgurant et passager,
un bonheur fait de petites choses, simples et quotidiennes, un
bonheur qui n’exclut pas les échecs, les soucis, la trahison et
les compromissions, un bonheur à ne pas rechercher dans des
événements extraordinaires et miraculeux. Un bonheur qui
finalement est possible, mais à une condition : il suffit tout
simplement de le vouloir, car notre vie n’est heureuse que si
nous la revêtons d’une signification heureuse.
Notre sensibilité face à la présence du mal au monde ‒ que
nous partageons du reste avec Albert Camus ‒ ne nous conduit
pas forcément à partager avec lui les conclusions qu’il en tire.
Devant la mort, la misère des hommes, l’injustice et la souf-
france des innocents, Camus condamne et refuse toute idée
d’absolu (Dieu). Il le remplace par l’homme dont il fait la
seule fin de ce monde. Cet athéisme fondé sur l’amour de
l’homme est en quelque sorte légitime. Cependant, n’est-il pas
aussi le fruit de la simple émotivité et n’apparaît-il pas comme
un chemin qui ne mène nulle part ?
Par contre, la présence du mal, le silence déraisonnable du
monde et de l’absolu constituent pour nous un questionnement
sans cesse renouvelé et une invitation à s’interroger davantage
sur les deux grands mystères que sont la personne humaine et
l’absolu.
11


INTRODUCTION
Y a-t-il quelqu’un ? Ce n’est certes pas uniquement le senti-
ment d’un homme débarquant pour la toute première fois dans
un pays étranger, puisque tout voyageur en quête d’hospitalité
l’éprouve.
L’impression du rien et du nulle part que l’on ressent, les
visages inconnus qui vous regardent sans vous voir parce
qu’avec des yeux morts…, tous ces corps-robots soumis au
temps et à la productivité et dont l’existence est régie par la
dialectique de l’exploitation de l’homme par l’homme, la lutte
des classes, le conflit des générations, les relations fonction-
nelles, les rapports du maître-esclave et de l’« homo homini
lupus »…, on en vient parfois à se demander si parmi ces
gens-là, il existe une âme qui vive.
L’homme dans sa condition de sujet et non de situation se
fait de plus en plus rare. Il n’y a que le vécu qui compte et qui
conditionne le sens de la vie. Vivre, c’est faire avec, puisque
l’on a oublié l’essentiel, à savoir : le sens du bien, du vrai, de
la justice, de l’unité, du beau, du don et du sacrifice ; en bref,
les valeurs !
De nos jours où les catéchismes sont usés, les codes péri-
més et tous les dés pipés, l’homme devrait s’interroger sur
l’orientation de son action. Travaille-t-on à sa ruine ou à son
ennoblissement ? Qu’est-ce qui justifie un État totalitaire ou
13
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%