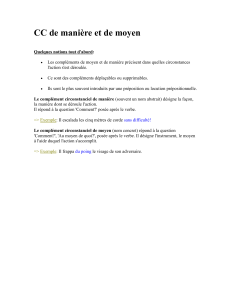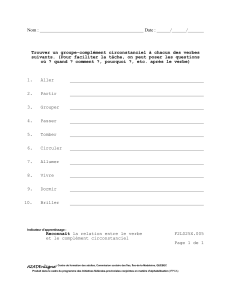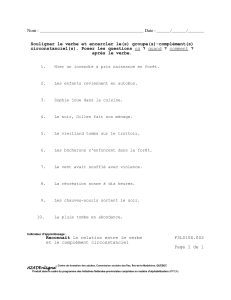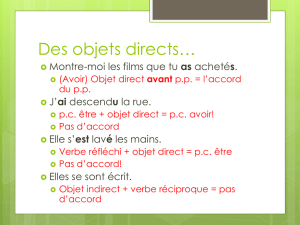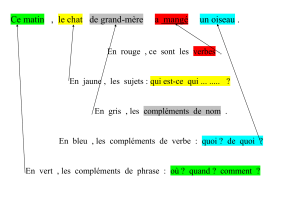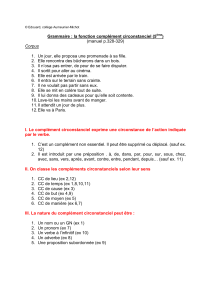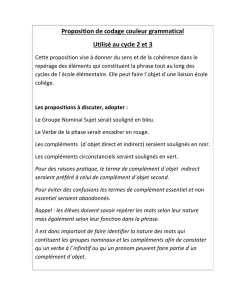VERSION AUTEUR

De l’apport de l’histoire dans l’enseignement de la
langue. L’exemple des compl´ements du verbe.
B´ereng`ere Bouard
To cite this version:
B´ereng`ere Bouard. De l’apport de l’histoire dans l’enseignement de la langue. L’exemple
des compl´ements du verbe.. Le Fran¸cais Aujourd’hui, Armand Colin / Dunod ; Association
fran¸caise des professeurs de fran¸cais ; Association fran¸caise des enseignants de fran¸cais (AFEF),
2016, Enseigner la grammaire : contenus linguistiques et enjeux didactiques. pp.15-31. .
HAL Id: hal-01250767
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01250767
Submitted on 2 May 2016
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,
´emanant des ´etablissements d’enseignement et de
recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires
publics ou priv´es.

1
DE
L
’
A
PP
O
R
T
DE
L
’
H
I
S
T
O
I
R
E
DANS
L
’
E
N
S
E
I
G
N
E
M
E
N
T
DE LA
L
A
N
G
U
E
L
’
E
X
E
M
P
L
E
DES COMPLÉMENTS DU
VE
R
B
E
Bérengère
B
O
U
A
R
D
Université de Lo
rr
a
i
n
e
CNRS
-
UMR
7118
Laboratoire
d
’
A
n
a
l
y
se
et traitement
i
n
f
o
rm
a
t
i
qu
e de
la langue française
-
AT
I
L
F
Nous nous intéressons ici
à
l
’
o
b
je
t
«
complément
du
verbe » dans
l
’
e
n
s
eig
n
e
-
ment de la
langue
au
collège.
À partir de cet
exemple,
et
dans
le contexte
actuel de
réforme des programmes
et de la
terminologie
pour
l
’
é
c
o
le
élé-
mentaire et le
collège
1
, nous tenterons
de montrer que la
réflexion sur les
contenus
d
’
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
et
sur
leur
désignation
ne peut être
a
n
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
et
gagne
à
être mise
en
relation avec
l
’
h
is
t
oir
e
des savoirs linguistiques.
Pour
cela, nous procèderons
à la
comparaison des trois terminologies
gramma-
ticales officielles
de 19102 , 19753 , et 19974
sur
deux
points précis
:
les
compléments
du
verbe
et la
typologie verbale
5
. Nous
en
retiendrons
plu-
sieurs faits marquants
qui mettent en
perspective les choix
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
i
q
u
e
s
a
c
t
u
el
s
.
La sélection
du «
complément d
’
o
b
j
e
t
direct
»
La
sélection
de
l
’
e
x
pr
e
ss
i
o
n
«
complément d
’
o
b
j
e
t
direct »
s
’
e
s
t
faite en
plusieurs étapes
qui jalonnent
l
’
él
a
b
o
r
a
t
i
o
n
de la
première
nomenclature
grammaticale officielle, résultant
du travail entre 1905 et 19106 d
’
un
e
commission
de
quinze membres (majoritairement des professeurs
de lycée)
nommée par le ministre. Celle-ci prône l
’
e
mp
l
o
i
du
complément
d
’
o
b
je
t
d
a
n
s
1.
Les projets
de
programmes applicables
à la rentrée 2016
sont disponibles sur
le
s
i
t
e
<www.education.gouv.fr>.
2.
Arrêté
du 25
juillet 2010.
Il
s
’
ag
i
t
de la première «
nomenclature grammaticale
»
officielle.
Elle parait dans
la
revue
L
’
E
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
ec
o
n
d
air
e
en aout 1910 (n° 14, p. 232).
L
’
a
r
t
i
cle
de
J.
Vergnaud
(1980) reproduit
intégralement
le texte.
3.
Circulaire
n°75-250 du 22
juillet
1975 pour
l
’
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
secondaire. Nous citons
le
Bulletin officiel
n° 30 du 31
juillet
1975,
ainsi
que le
complément
qui
parait dans
le
B
u
ll
e
t
in
officiel
n° 47 du 25
décembre
1975.
4.
La première
édition date de juin 1997,
nous utilisons celle
de 1998 du Centre national
de documentation pédagogique.
5.
Nous
ne
citons
q
u
’
un
e
partie des travaux sur les terminologies grammaticales
o
ff
i
c
i
elle
s
.
6.
La première nomenclature grammaticale officielle
s
’
éla
b
o
r
e
dans
un
contexte
particulier
de
crise
de
l
’
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
de la
grammaire (Savatovsky
2000).

ses deux rapports préliminaires
7
.
Pourtant, le
conseil supérieur
8
ne retient
pas
l
’
e
x
p
r
e
ss
io
n9 et opte pour
l
’
o
pp
o
s
it
io
n
complément direct/indirect
d
a
n
s
la
nomenclature publiée
en 1910.
L’«
objet »
est réintroduit
par la circulaire
ministérielle
du 21
mars
1911
mais
de
façon facultative
10
(Fournier
2000 :
12). Quel(s) sens
ont
ces hésitations autour
du
complément
d
’
o
b
je
t
?
Q
u
’
e
s
t
-
ce
qui
explique
la
sélection
de
l
’
e
x
p
r
e
ss
i
o
n
complément
d
’
o
b
je
t
direct,
d
a
n
s
l
’
h
i
s
t
o
i
r
e
longue
du
métalangage grammatical
?
11
La réponse nécessite
de
s
e
reporter
aux
deux
rapports intermédiaires précédant
la
version finale
de la
nomenclature officielle
et
aux articles publiés dans
la
revue
L
’
E
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
e
c
o
n
d
ai
r
e
12 .
Les arguments avancés
en
faveur
du
complément d
’
o
b
j
e
t
s
o
n
t
au nombre de deux.
Le choix de
l
’
o
b
j
e
t
contre
le
complément
i
n
d
i
r
ec
t
Dans
le premier rapport, le complément d
’
o
b
j
e
t
est
clairement
c
h
o
i
s
i
par
opposition
au complément indirect. La
conservation
ou non d
u
«
complément indirect
»,
largement répandu, fait
l
’
o
b
j
e
t
d
’
un
vif débat
dans les colonnes
de
L
’
E
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
ec
o
n
d
ai
r
e
, A. Hamel étant
«
Pour
le complément indirect
»
(1907) et C. Maquet
«
Contre le complément
indirect
»
(1907)
13
. Le débat repose essentiellement sur le traitement de
deux
cas
de
figure problématiques
: le
second complément (indirect) des
v
e
r
b
e
s
7. Le premier rapport,
rédigé
par C. Maquet,
est
rendu le 15
février
1907 et publié d
a
n
s
la
revue
L
’
E
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
e
c
o
n
d
ai
r
e
en
février
1908 en
deux parties, mais
il
est renvoyé
pour
simplification.
Le
second
rapport,
rédigé
en
sus avec
F. Brunot,
est
publié
dans
la même
revue
le 15
mars
1909.
8.
Après réunion
d
’
u
n
e
commission contenant des représentants de
l
’
en
s
eig
n
emen
t
primaire
et
secondaire, des spécialistes
et
des
non
spécialistes,
et
des a
dm
i
n
i
s
t
r
a
t
e
u
r
s
.
9.
La première nomenclature grammaticale est extrêmement succincte (deux pages).
Il
s
’
ag
i
t
de la liste des termes exigés dans les examens de l
’
en
s
eig
n
emen
t
primaire
et
secondaire
à partir
de
1911. Elle
a
comme
but
d
’
u
n
i
f
ier
et de
simplifier les diverses terminologies g
r
a
mm
a
t
i
cal
es
utilisées
par
les enseignants
et
constitue
en
cela le premier acte «
par
lequel
l
’
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n tente
de
réguler
le
métalangage disciplinaire
en le bornant à une
liste close » (Fournier
1998 : 40),
même
si
la
volonté officielle
d
’
u
n
i
f
o
rm
i
s
a
t
i
o
n
a été
exprimée
bien avant
(Vergnaud
1980 :
18).
10. Ce qui
prime ce sont les appellations
de
forme
et non de
s
e
n
s
.
On
parle
donc
d
a
v
a
n
t
age
de
complément direct
d
’
o
b
j
e
t.
Les grammaires scolaires
qui
suivent semblent privilégier
le
s
désignations formelles, sans
omettre
nécessairement
l
’
o
b
j
e
t
(Fournier 2000 : 355), et le
syntagme complément
d
’
o
b
j
e
t
direct (utilisé
par C. Maquet, F. Brunot et L. Sudre) ne
s
e
lexicalise
que progressivement dans la métalangue
d
’
en
s
eig
n
emen
t
(vers 1920 pour A.
Chervel
(2008 : 228),
voir sa « généalogie
du COD
» dans
2012, p. 332).
11.
S’il
est vrai
que la
commission présidée
par C. Maquet
s
’
é
t
ai
t
fixée
comme
règles
de
proscrire les innovations
et de ne
choisir
que
des termes déjà employés (Maquet 1908a
: 58),
l
’
o
n
sait aussi
que
l’« objet »
n
’
es
t
pas
un
terme
qui
domine dans le réseau terminologique
de
la
complémentation
à la fin du 19ème
s
i
ècle
.
12. Sur la
première nomenclature,
on
consultera
P.
Boutan (1997),
J.
Vergnaud
(1980) et
A. Elalouf
(à
paraitre) (sur
le
complément
indirect également).
13.
Ces
deux
positions sont représentatives
de ce que
l
’
o
n
observe dans les
g
r
a
mm
ai
r
e
s
de la même
période
(pour
des études
de
corpus ciblées, avant
1910 :
A. Elalouf,
à paraitre,
P.
Lauwers
2004, et
après
1910 : J.-M. Fournier 2000).

t
r
iv
ale
n
t
s
14 ,
comme dans (1) on doit le
s
i
l
e
n
c
e
aux m
o
r
t
s
ou
(2)
j
’
é
c
r
i
s
une
l
e
tt
r
e
à un ami, et le
complément
indirect
obligatoire des verbes
de
l
o
ca
l
i
s
a
t
i
o
n
comme
dans
(3)
je
v
ai
s
à la
campagne. A.
Hamel
analyse
aux
m
o
rt
s
ou à la
campagne
comme des compléments indirects
15
(1907a
: 303,
1907b
:
368
)
16 ,
distincts
du
groupe t
o
u
s
les
j
o
u
r
s
,
circonstanciel
à
ses yeux (1907b
:
ibid.).
De
la même façon, dans (3) ou dans (4) je donne
un
s
o
u
à un
pauvre, il y a pour
lui
un
objet direct
et un
objet indirect, les deux
étant
nécessaires
au
verbe
(1908
: 99).
Raison
pour
laquelle
il
s
’
o
pp
o
s
e
à la
disparition des
c
o
mp
lé
m
e
n
t
s
direct et indirect, au profit de la
seule opposition
o
b
j
e
t
/
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
i
el
s
(1907a : 303). C. Maquet, auteur du premier rapport,
décide
en
effet
de
renoncer au «
complément indirect
»
17
au motif
q
u
’
il
désigne des réalités
trop
diverses,
notamment le
complément indirect
de
seconde place désignant
le
bénéficiaire
d
’
u
n
verbe trivalent (un pauvre dans 4) («
complément
acce
ss
oir
e
du
verbe »,
donc traité comme un
«
complément
circonstanciel »
par
C
.
Maquet) et le
complément indirect d
’
u
n
verbe divalent
indirect
dans
(5) il
s
’
e
s
t
emparé de
la
ville («
complément intimement lié
au
verbe »
et équivalent
pour lui à un
complément
d
’
o
b
j
e
t
direct comme
dans
(6) il a
p
r
i
s
la
v
i
ll
e
)
(Maquet 1908b : 77). Le complément indirect lui semble pour
cela « obscur »
et la
catégorie « artificielle »
(
I
b
i
d
.
)
18 . Ce qui
compte
c
’
e
s
t
«
le complément
marquant
l
’
o
b
j
e
t
», « quelle
que
soit sa forme grammaticale »
19
(
I
b
i
d
.
)
20 . Le
premier rapport
évacue
donc
l
’
o
pp
o
s
i
t
i
o
n
complément
direct/indirect au
profit de
l’«
objet
»
21 ,
suivant
la
volonté
de C. Maquet qui
souhaite
que le
terme
de
«
complément
d
’
o
b
je
t
,
ou
simplement, objet, passe dans
l
’
u
s
age
et
devienne plus
tard
exclusivement employé » (Ibid.).
Il
conserve
n
éa
n
m
o
i
n
s
la
«
double dénomination
»
de
«
complément
d
’
o
b
j
e
t
ou direct
»
à titre de
«
transition
»,
en
reconnaissant
que le
«
terme
direct
n
’
a
plus guère
de
s
e
n
s
du moment q
u
’
i
l
ne
s
’
o
pp
o
s
e
plus
à indirect
»
(Ibid.). Le
«
complément
14.
Nous utilisons,
pour
les verbes,
la
terminologie
de L.
Tesnière
(1959).
15.
L
’
é
q
u
i
v
a
le
n
ce
avec l
’
a
cc
u
s
a
t
i
f
latin lui fournit un argument
dans ce
s
e
n
s
.
16. Et non
comme complément circonstanciel, comme
le lui
reproche
C. Maquet (1907 :
336).
17.
Il se réfère à L. Sudre
et P.
Lafargue
qui n
’
u
t
i
l
i
s
en
t
plus le complément indirect
(Marquet
1907 : 336).
18. C. Maquet
se situe dans
le prolongement de L. Sudre qui dénonce la
«
théorie
embrouillée
»
du
complément indirect,
donnant
notamment comme
exemples
de
la
d
i
v
er
s
i
t
é
de
ses réalisations obéir
à la
loi, donner
un
vêtement
à un
pauvre, jouir
d
’
u
n
e
c
h
o
s
e
,
ê
tr
e
r
éc
o
m
p
e
n
s
é
d
’
u
n
e
chose
(et
d
’
a
u
t
r
es
accompagnés des prépositions pour,
s
u
r,
contre, par)
(Sudre
1906 : 118). L.
Sudre préconise ainsi
l
’
a
b
a
nd
o
n de la
distinction
« artificielle »
complément
direct/indirect
s
’
a
ppu
y
a
n
t
sur
la forme, pour
se
concentrer
sur les « rapports » e
x
pr
i
m
é
s
(Ibid.).
19.
L
’
o
pp
o
s
i
t
i
o
n de
forme via
la
préposition
n
’
e
s
t
q
u
’
«
apparente »
pour lui,
elle
n
’
a
pas
de
« valeur logique », ainsi les verbes
n
u
ir
e
à
q
u
e
l
q
u
’
u
n,
obéir
à
q
u
e
l
q
u
’
u
n
ont
des «
c
o
mp
l
émen
t
s
directs prépositionnels
»
(Maquet 1908b : 77).
20. Deux
autres critères sont aussi mentionnés
:
l
’
o
pp
o
s
i
t
i
o
n
au
sujet
(1907 : 336), et le
retournement au
passif
(1908 : 77),
critiqué
par
A.
Hamel
parce
q
u
’
i
l
n
’
e
s
t
pas applicable
à
tous les compléments prépositionnels
(Hamel 1908 : 99).
21. C. Maquet accepte cependant qu
’
o
n
l
’
a
pp
elle
«
complément direct
»,
par habitude
(1907 : 336).

d
’
o
b
j
e
t
ou direct
»,
s
’
o
pp
o
s
e
ainsi
au
«
complément circonstanciel
»,
et
les
«
compléments
d
’
o
b
j
e
t
ou
direct », sont divisés
entre
«
compléments
avec
préposition
ou
sans
»
.
Le second rapport, rédigé avec F. Brunot, confirme l
’
im
p
o
r
t
a
n
ce
accordée
à
l
’
o
b
je
t
et renvoie définitivement
les
qualifications morphologiques au
s
ec
o
n
d
p
l
a
n
22 , on parle
ainsi
de
«
complément d
’
o
b
j
e
t
direct
» (sans
pr
é
p
o
s
i
t
i
o
n
)
ou
«
indirect
»
(avec
préposition),
et de
«
complément
circonstanciel »
:
d
’
a
tt
r
i
b
u
t
i
o
n
, de
temps,
de lieu, de
manière,
de
cause,
de but, d
’
a
ge
n
t
ou
du
passif
(Brunot et Maquet 1909 : 120). Cette
focalisation sur
l’ «
objet »,
au détriment
des compléments
direct et indirect,
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
par la volonté
de mettre au
centre
de
l
’
a
n
a
l
ys
e
,
la
transitivité
v
e
rb
a
le
23 .
Le choix de
l
’
o
b
j
e
t
en
relation avec
le
verbe
t
r
a
n
s
i
t
i
f
L
’
u
t
il
is
a
t
io
n du
terme même
d
’
o
bj
e
t
est source
de
malentendus. A.
Hamel
critique
son
emploi en
expliquant q
u
’
i
l
ne
désigne pas
une entité de type
objet
dans «
je
respecte
mon
père »
ni
dans
(1), (Hamel 1907a : 303) ;
il parait donc inadéquat pour
l
’
a
n
a
ly
s
e
de
nombreuses constructions.
O
r,
dans les
deux
rapports
précédant la
première nomenclature
grammaticale
officielle,
le terme d
’
o
bj
e
t
est
à entendre comme
objet dans
la relation
transitive,
et il
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
par la
thématisation
de la
transitivité verbale.
En
effet,
C.
Maquet se débarrasse des trois classes anciennes
de
verbes « actifs »,
« passifs », « neutres
»
24 ,
héritées
du latin et
critiquées depuis longtemps
par
les grammairiens
du
français (Colombat
2006 ;
Bouard
2011 ; Piron 2012),
et
distingue les « verbes
d
’
é
t
a
t
» des « verbes
d
’
ac
t
io
n
»
et,
parmi ces
d
e
r
n
ie
r
s
,
les verbes intransitifs «
qui peuvent
s
’
e
mp
l
o
ye
r
sans complément, sans
que
l
’
ac
t
i
o
n
passe sur
un objet
»,
et
les verbes transitifs «
qui
s
’
e
mp
l
o
i
e
n
t
avec
un complément,
c
’
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
exprimant une action qui
passe
directement
sur
un objet
», sachant q
u
’
i
l
s
’
a
g
i
t
là
d’« emplois »
et non de
« classes »
de
verbes figées
25
(Maquet 1908a : 61). Le
«
complément d
’
o
b
j
e
t
»
équivaut
22.
Les deux auteurs reconnaissent néanmoins
qu
’
i
l
est difficile
de
savoir si
un complément
indirect
est
complément d
’
o
b
j
e
t
ou complément
circonstanciel dans
il
v
i
s
e
à la
tête
par
exemple,
et
ils
ne tranchent
pas
(Brunot et Maquet 1909 : 120).
23. L.
Sudre centre encore plus sa typologie sur
le
verbe
pu
i
s
qu
’
i
l
invite premièrement
à ne
retenir
q
u
’
un
terme
pour
les compléments
« propres »
d
’
un
verbe transitif
:
le «
complément
verbal »,
défini comme
«
tout mot
désignant
l
’
o
b
j
e
t
d
’
u
n
verbe transitif, q
u
’
i
l
soit
ou
n
o
n
précédé d
’
u
n
e
préposition
»,
et
deuxièmement
à
classer les autres, dits «
impropres
»,
parmi
les compléments
« circonstanciels »
ou
« adverbiaux »
pour
lesquels «
la
préposition
a une
valeur réelle »
car
« elle
marque une
idée
d
’
a
tt
r
i
bu
t
i
o
n
, de direction, de
cause,
etc., comme
dans donner
un
vêtement
à un
pauvre,
l
u
tt
e
r
contre
q
u
e
l
q
u
’
un
»
(1906 : 119-120).
24. On peut
regarder aussi
F. Brunot à ce
sujet
(1909 : 13-25 et 121) et L.
Sudre
(1906 :
114-115).
25. Il
précise ainsi
que
les verbes transitifs peuvent
être
«
employés absolument
»
et devenir
intransitifs
comme
dans je mange
du pain /
je mange, je
b
o
i
s
du vin /
je
b
o
i
s
, et que
c
e
r
t
ai
n
s
intransitifs
peuvent
devenir transitifs
comme
dans
c
o
u
rir
le cerf.
Voir
aussi
F. Brunot et
C
.
Maquet (1909 : 122) ou
encore
L. Sudre (1907 : 106), à qui C. Maquet reprend
s
o
u
v
e
n
t
des
e
x
e
mp
le
s
.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%