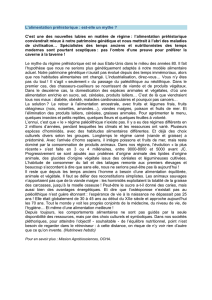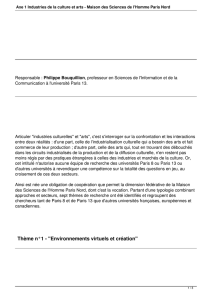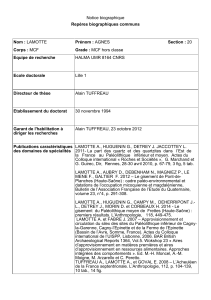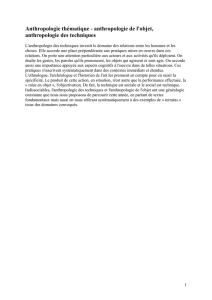Paléolithique supérieur et Mésolithique en Méditerranée : cadre

Article original
Paléolithique supérieur et Mésolithique
en Méditerranée : cadre culturel
The Upper Paleolithic and the Mesolithic around
the Mediterranean: cultural framework
Janusz K. Kozlowski
Institut d’Archéologie, Université Jagiellonski, Ul Golebia 11, 31007 Cracovie, Pologne
Disponible sur internet le 10 octobre 2005
Résumé
L’apparition du Paléolithique supérieur autour de la Méditerranée était l’effet du développement
local, surtout dans le Nord-Est de l’Afrique et au Proche-Orient, et des migrations à partir de cette
zone vers l’Europe sud-orientale et centrale. Le Paléolithique supérieur initial apparaît au Proche-
Orient pendant la première moitié de l’Interpléniglaciaire comme effet d’une évolution culturelle des
groupes d’Homo sapiens, dont la technologie était fondée sur le concept Levallois qui a évolué vers
les technologies laminaires leptolithiques. Cette évolution est surtout visible dans la zone syropales-
tinienne où certaines industries de « transition », comme l’Emirien et l’Ahmarien, se sont répandues
vers le sud-est européen et vers le bassin du moyen Danube. Le phénomène de cette diffusion pour-
rait être identifié avec la migration des premiers Hommes modernes. L’évolution ultérieure, pendant
le Paléolithique supérieur ancien correspondant à la deuxième moitié de l’Interpléniglaciaire, en
particulier l’origine de l’Aurignacien, a été fondée sur le fond culturel local. Pendant toute la période
de l’Interpléniglaciaire, l’Europe reste séparée de l’Afrique qui a continué les traditions locales du
Paléolithique moyen (Middle Stone Age) ou bien a connu les cultures « de transition » spécifiques du
littoral méditerranéen (Dabbien ancien) et de la basse vallée du Nil. Le maximum du Pléniglaciaire
supérieur et la régression marine ont facilité les relations possibles entre le Maghreb et la Péninsule
Ibérique dans les deux sens à travers le détroit de Gibraltar (Atérien/Solutréen, Gravettien/
Ibéromaurusien), bien que ces liens soient encore hypothétiques et demandent des preuves, surtout
chronostratigraphiques. En même temps des liens existent entre le sud-est européen et l’Anatolie
occidentale ; la frontière entre la zone culturelle européenne et celle du Proche-Orient était marquée
par la chaîne de Taurus. Pendant le Tardiglaciaire et le début de l’Holocène, les liens transméditerra-
Adresse e-mail : [email protected] (J.K. Kozlowski).
L’anthropologie 109 (2005) 520–540
http://france.elsevier.com/direct/ANTHRO/
0003-5521/$ - see front matter © 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.anthro.2005.06.013

néens ont été coupés par la transgression marine et ce n’est qu’avec l’apparition de la navigation que
ces liens réapparaissent d’abord dans le Paléolithique final du bassin égéen, et seulement au début du
Néolithique autour de la Méditerranée septentrionale et occidentale.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
The origin of the Upper Palaeolithic around the Mediterranean was the result of the local evolu-
tion, particularly in the Near East and in the Lower Nile basin, and of the migration from this zone to
South-Eastern and Central Europe. The Initial Upper Palaeolithic in the Near East belt was the effect
of local evolution from the industries based on Levallois concept to the industries which developed
leptolithic blade technologies. This evolution is well registered in multi-layer sites in the Syro-
Palestinian belt (Emirian/Ahmarian), which was the starting point of the diffusion of these “transi-
tional” industries in South-Eastern and Central Europe. This diffusion could be identified with the
migration of first anatomically Modern Humans. The Early Upper Palaeolithic in Europe — dated to
the second half of the Interpleniglacial — was, at least partially, based on these “transitional” indus-
tries and manifested by the appearance of the Aurignacian, contrasted with local cultures such as the
Uluzzian in Mediterranean Europe. During whole the Interpleniglacial Europe was separated from
Northern Africa dominated by local evolution of Middle Palaeolithic (Middle Stone Age) cultures
(mostly expressed by the Aterian), and by specific “transitional” industries on the southern Mediter-
ranean coast (Early Dabbian) and in the Lower Nile basin. The Last Glacial Maximum and the cor-
responding sea level recession opened new possibilities of contacts between the Maghreb and the
Iberian Peninsula in both directions (Aterian-Solutrean and Gravettian-Early Iberomaurusian), which
are still difficult to be proved before new chronostratigraphic correlations are made.At the same time
we register links between south-eastern Europe and western Anatolia; the real border between Near
Eastern and European Mediterranean cultural zones was marked, in the Late Glacial, by the Taurus
chain. During the Late Glacial the cultural separation between Europe and Africa was particularly
marked. Only in the Aegean basin the first sea navigation facilitated contacts which become wides-
pread as late as in the Early Holocene with neolithization trough maritime contacts.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Paléolithique supérieur ; Mésolithique ; Interpléniglaciaire ; Pléniglaciaire supérieur ; Tardiglaciaire
Keywords: Upper Palaeolithic; Mesolithic; Interpleniglacial; LGM; Late Glacial
1. Introduction
Autour de 40 000 ans B.P., un contraste existe entre l’Afrique du Nord et le Proche-
Orient, peuplés depuis plus de 120 000 ans par les Hommes modernes, et l’Europe où les
populations néandertaliennes ont existé depuis au moins 160 000 ans. Du point de vue
culturel au Maghreb et dans le bassin du Nil inférieur, le Paléolithique moyen (ou MSA)
était donc l’œuvre exclusivement des Hommes modernes, en revanche sur le littoral syro-
palestinien et en Anatolie les cultures de cette période ont été dues aussi bien aux Néander-
taliens qu’aux Hommes modernes. Par contre en Méditerranée septentrionale, comme dans
toute l’Europe, les sites du Paléolithique moyen, appartenant aux différents faciès mousté-
riens, ont fourni exclusivement des restes néandertaliens, en revanche au début du Paléoli-
thique supérieur les deux populations, néandertaliennes et modernes ont coexisté.
521J.K. Kozlowski / L’anthropologie 109 (2005) 520–540

Il est intéressant de noter que les Hommes modernes en Afrique du Nord et au Levant,
qui ont été les auteurs des industries levallois-moustériennes, moustériennes et atériennes,
n’ont pas produit des manifestations artistiques qui sont attribuées en Europe aux Hommes
modernes et fréquemment considérées comme des éléments de « l’explosion créative »
(Pfeiffer, 1982) ou « révolution leptolithique » (Bar-Yosef, 1992, 1997, 2003).
Les éléments de la « révolution leptolithique » dans le domaine symbolique apparais-
sent au Proche-Orient seulement dans les cultures « de transition » et dans l’Aurignacien
(Bar-Yosef, 1997), donc – comme en Europe – dans les entités attribuées au Paléolithique
supérieur.
2. Le Paléolithique supérieur initial de la première partie de l’Interpléniglaciaire
(50 000/48 000–38 000 ans B.P.) - Carte 1, Fig. 1
La période entre 48 000–38 000 ans B.P. est cruciale pour le passage entre le Paléolithi-
que moyen et supérieur. Nous observons, le plus tôt au Proche-Orient, une transition tech-
nologique et stylistique dans le domaine des outillages lithiques entre le Paléolithique moyen
et le Paléolithique supérieur. Elle est marquée par une longue évolution à partir de l’Emi-
rien, issue du Levallois-Moustérien levantin, autour de 48 000–46 000 ans B.P., vers l’Ahma-
rien qui a persisté sur le littoral syropalestinien et au Néguev jusqu’à 20 000 ans, représen-
tant la plus importante entité culturelle au Proche-Orient, avant l’Épipaléolithique
postpléniglaciaire (Bar-Yosef et Belfer-Cohen, 1977, 1996 ;Marks, 1976, 1983 ;Goring-
Moris et Belfer-Cohen, 2003). Les industries de l’Emirien/Ahmarien, caractérisées par une
transition technologique des méthodes Levallois vers les techniques laminaires leptolithi-
ques dans le contexte typologique leptolithique, ont été diffusées vers l’Anatolie (grotte
d’Ucagizli [39/38 Kyr B.P.] et Kanal-Kuhn et al., 1999 ;Kuhn, 2003), les Balkans (par ex.
la couche VI de la grotte Temnata, en Bulgarie, secteur TD-II [50–45 Kyr], suivi du Bacho-
kirien de la couche 4 [43–36 Kyr] – Drobniewicz et al., 2000 ;Kozlowski, 2004), et en
Europe centrale (Bohunicien connu surtout en Moravie [42–38 Kyr B.P.] – Svoboda, 2003,
et éventuellement le Kréméniecien enVolhynie [30 Kyr B.P.?] – Stepanchuk, Cohen, 2000–
2001). Tenant compte de certains décalages chronologiques entre les différentes entités
culturelles de ce complexe, il ne s’agit probablement pas d’une seule diffusion, mais de
plusieurs vagues dans la période comprise entre 48 000 et 38 000 ans B.P.
Malheureusement nous ne connaissons pas avec certitude le type anthropologique res-
ponsable de ce complexe culturel, mais il est possible qu’il s’agisse des premiers Hommes
modernes aussi bien au Proche-Orient (voir les restes d’Egberta dans l’Ahmarien de Ksar
Akil) qu’en Europe (Bacho Kiro, couche 11 dans le Bachokirien).
Notons que dans ces entités apparaissent les premiers objets symboliques, comme la
plaquette avec incisions rythmiques de la grotte Temnata couche VI (Crémades, 2000), les
dents percées de la couche 11 de Bacho Kiro (Marshack, 1976) et les nombreuses coquilles
percées connues dans la grotte Ucagizli (Kuhn, 2003 ;Stiner, 2003).
Dans le même laps de temps, aux Balkans du Sud, en Italie et en France apparaissent les
autres « cultures de transition » issues du Moustérien local, notamment l’Uluzzien et le
Chatelperronien, étant probablement l’œuvre des néandertaliens (Hublin, 2000 ;Palma di
Cesnola et Messeri, 1967). Les datations radiométriques indiquent que ces « cultures de
522 J.K. Kozlowski / L’anthropologie 109 (2005) 520–540

Carte 1
.
Paléolithique supérieur initial de la première partie de l’Interpléniglaciaire (50 000/48 000–38 000 ans B.P.).
Map 1. Initial Upper Palaeolitic: first half of the Interpleniglacial (50.000/48.000 years B.P.).
523J.K. Kozlowski / L’anthropologie 109 (2005) 520–540

transition », caractérisées par les armatures laminaires à dos convexe, abattues par une
retouche abrupte, ont été plus récentes que les entités développées sur le fond technologi-
que levalloisien. Pour le Chatelperronien, nous avons les datations C14 comprises entre
38 000 et 33 000 ans B.P., et les datations TL moyen du Moustier qui sont de l’ordre de
42,6 Kyr (Mellars, 1999), ce qui correspond bien à la calibration des dates C14. Pour l’Uluz-
zien, la plus ancienne date AMS est celle de la couche V de la grotte n
o
1 à Klisoura en
Argolide (Grèce) et elle est datée de 40 400 ans B.P. (Koumouzelis et al., 2001).
La « leptolithisation » de la Méditerranée septentrionale et de toute l’Europe a été ache-
vée entre 38/36 et 28 Kyr B.P. par l’apparition de l’Aurignacien, civilisation qui présente
tous les traits typiques du Paléolithique supérieur, aussi bien dans les domaines technolo-
giques, économiques que symboliques. L’origine de cette culture était généralement attri-
buée à une migration des premiers Hommes de Cro-Magnon du Proche-Orient vers l’Europe
(Mellars, 1989 ;Kozlowski, 1993). Dans cette hypothèse classique, deux voies de migra-
tion de l’Aurignacien à partir du sud-est européen ont été envisagées : d’une part par la
Méditerranée septentrionale et d’autre part par le Bassin Danubien.
Dans le cas où si nous attribuons aux Hommes modernes les industries laminaires de la
période comprise entre 48 000 et 38 000 ans B.P., qui dérivent de bases technologiques
levalloisiennes et dont la diffusion prédate l’Aurignacien en Europe balkanique et danu-
bienne, il est probable que l’Aurignacien pourrait émerger de ces industries aux Balkans, et
peut-être dans d’autres centres régionaux (moyen Danube). L’exemple d’une telle évolu-
Fig. 1
.
Tableau stratigraphique du Paléolithique supérieur initial.
Fig. 1. Stratigraphic table of the Initial Upper Palaeolithic.
524 J.K. Kozlowski / L’anthropologie 109 (2005) 520–540
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%