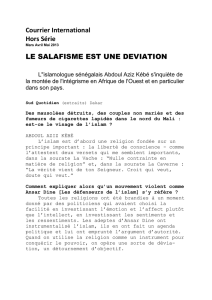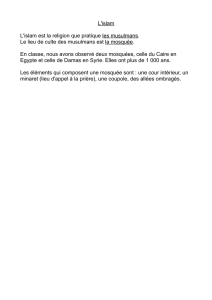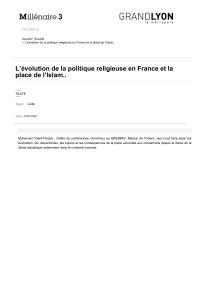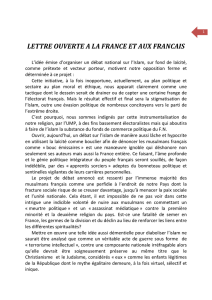Salafisme, islamisme, soufisme

Les religions et le monde moderne
dossier
62 / mars 2013 / n°429
Entretien avec Amel Boubekeur1
Visiting Fellow - Brookings Doha Center
« L’islam politique
s’est quelque peu
“indépendantisé” de
l’islamisme en tant que
tel pour être récupéré
par une pléthore
d’acteurs différents. »
« Il y a un déficit
d’identification à la culture
politique, au pouvoir et à
ses institutions nationales,
ce qui fait qu’il y a un
réinvestissement de
l’espace public qui peut
donner l’impression d’une
forte islamisation. »
« On retrouve dans
le soufisme le même
phénomène de
réislamisation volontaire
que l’on a pu observer au
sein d’autres mouvements
d’inspiration islamiste. »
Vous travaillez sur la question du
salafisme depuis plusieurs années,
bien avant que l’usage de ce terme
ne devienne si courant en Occident.
Pouvez-vous nous faire un rapide état
des lieux du salafisme d’aujourd’hui et
de ses différentes mouvances: quiétiste,
djihadiste, etc. ?
Il y a véritablement un avant et un après
« révolutions arabes » en ce qui concerne
le salafisme. La chute des tyrans a créé
un vide ouvrant la voie à de nouvelles
formes d’islam oppositionnel. Avec l’arrivée
au pouvoir de partis islamistes et leurs
victoires électorales notamment en Tunisie,
au Maroc et en Égypte, on assiste à une
repolitisation du salafisme, qui remplit
désormais le rôle oppositionnel que jouait
jusque-là l’islam politique. C’est la première
évolution importante : la repolitisation du
salafisme dans un contexte post-autoritaire.
Il faut rappeler que le salafisme, dans
l’ensemble du monde arabe et sans doute
au-delà, est très lié aux conditions de
sécuritisation de la société. Mes entretiens
avec des salafistes, dans la banlieue de
Radès, en Tunisie, en 2007 et 2008 m’ont
conduit à m’apercevoir qu’ils étaient très
souvent indicateurs de la police… Il y avait
donc une sorte d’accord tacite entre les
gouvernements autoritaires et les salafistes :
on les laissait faire ce qu’ils voulaient, (se
regrouper sur une base idéologique, investir
des réseaux de solidarité économique…)
du moment qu’ils ne se mêlaient pas de
politique. Avec la chute des régimes, il y a de
formidables opportunités pour les salafistes
d’investir l’espace public et d’occuper de
nouvelles formes d’espaces oppositionnels
qu’ils n’étaient pas parvenus jusque-là
à investir, puisqu’ils se rattachaient à la
position du salafisme wahhabite saoudien
selon lequel il ne fallait pas remettre en
cause le tyran tant qu’il est musulman.
Il faut également mentionner la politique
de « pardon » des États autoritaires depuis
Salafisme,
islamisme, soufisme
une dizaine d’années : un certain nombre
de djihadistes ont été graciés et libérés de
prison et ont essayé de réinvestir l’espace
public et de jouer un rôle de contestation.
Au Maroc, en contrepartie du pardon
et de la grâce, il leur fallait reconnaître
le roi comme Amir Al Mou’minine (le
commandeur des croyants). On est donc
dans une reconnaissance d’une autorité
politique à soubassement religieux. Ils ont
été contraints de le faire car cela était la
condition pour retrouver la liberté. Mais on
se rend compte que très profondément, dans
les milieux salafistes, il y a une contestation,
non pas uniquement de l’autorité religieuse
du roi, mais aussi de son autorité politique.
En règle générale, le salafisme est beaucoup
plus anti-politique qu’a-politique. Il ne
reconnaît pas les institutions politiques
modernes, les partis, les élections…
Les salafistes au Maghreb pourraient-ils
être tentés de suivre la voie électorale,
comme l’a fait le parti Al Nour en Égypte ?
En Algérie, un parti salafiste vient de se
voir refuser sa légalisation. Cela tient à
la position des services qui cherchent à
jauger le potentiel des salafistes au sein
de la société civile. Le lieu du pouvoir en
Algérie, en tout état de cause, ne se situe
pas au niveau des partis politiques. Ce n’est
pas en créant des partis politiques que l’on
va changer la donne.
En revanche, j’ai vu cela en Tunisie, aussi
bien juste avant la révolution qu’après,
au moment de l’affaire du campus de La
Manouba. Les salafistes se positionnaient de
façon très pragmatique par rapport au parti
Ennahda. Jusqu’au 14 janvier 2011, date
de la chute de Ben Ali, la majorité continuait
de suivre l’opinion d’un certain nombre de
sheikhs saoudiens, comme le sheikh Saleh
Al Fawzan, pour lesquels la révolution en
cours n’était pas une révolution musulmane.
Un slogan d’Al Fawzan disait même : « Le
printemps arabe est le printemps des
1 - Publication récente : Whatever Happened to the Islamists?: Salafis, Heavy
Metal Muslims, and the Lure of Consumerist Islam, sous la direction d’Amel
Boubekeur et Olivier Roy, Columbia University Press, 2012

dossier
63
/ mars 2013 / n°429
kuffars » (mécréants). Après la révolution,
un certain nombre de salafistes sont sortis
de prison, et le salafisme est devenu la
nouvelle incarnation politique contestataire
de l’islam politique dans la rue. Une bonne
moitié d’entre eux est donc allée voter aux
élections pour choisir les membres de
l’Assemblée constituante en octobre 2011.
Ils ont voté pour Ennahda dans l’espoir de
pouvoir peser comme un lobby pour obtenir
la reconnaissance du rôle de l’islam dans
la constitution, sur la possibilité de porter
le niqab à la fac, et sur d’autres sujets,
sur les questions morales. Mais ils étaient
en même temps critiques quant au projet
politique d’Ennahda, qui leur semblait
devoir forcément conduire au pluralisme,
puisqu’il faudrait gouverner en partenariat
avec des acteurs qu’ils considèrent, dans
leur esprit, comme non musulmans.
Un parti politique salafiste a été légalisé
en Tunisie, mais en réalité, on se rend
compte que son jeu consiste surtout à
peser comme un lobby sur Ennahda,
puisqu’Ennahda apparaît comme une
tête de pont de la possible politisation du
salafisme. Ils préfèrent donc servir de lobby
ou d’antichambre d’Ennahda plutôt que de
véritable force politique, à ce stade.
Ont-ils un programme économique ?
Non. En Tunisie, il s’agit d’être en com-
pétition avec des institutions d’État qui
ne fonctionnent pas. Ce qu’on a vu dans
un certain nombre de régions défavori-
sées, ce sont des groupes de jeunes
salafistes qui organisent des souks po-
pulaires subventionnés, qui font de la
redistribution, des systèmes de cantine, etc.
Il s’agit vraiment de gagner la sympathie
des populations locales, alors que les
institutions ne fonctionnent plus ou ont
été accaparées par les réseaux clientélistes
d’Ennahda qui ont un peu mis de côté le
reste de la population. Donc, il y a une
brèche dans laquelle ils s’engouffrent, mais
n’ont pas de programme économique au
sens classique.
Peut-on évaluer le poids respectif au
Maghreb des salafistes djihadistes et des
salafistes quiétistes ?
Les situations nationales varient. Après les
attentats de 2003 et de 2007, le Maroc a
enfermé un certain nombre de salafistes,
dans une sorte de politique de prévention
violente. On voulait leur envoyer des
signaux les incitant à se tenir à carreau.
Cela a eu l’effet pervers de les conduire à
la radicalisation, au contact de salafistes
djihadistes en prison. Certains sont alors
passés du quiétisme au djihadisme. En
Algérie, il y avait dans les années 1990 le
parti politique du Fis (Front islamique du
salut), dans lequel il y avait une répartition
des rôles entre les élites qui exerçaient une
fonction tribunitienne et la base qui avait
une fonction de maintien de l’ordre. Avec
l’effondrement du parti, lorsque le cadre a
disparu, le quiétisme a parfois évolué en
djihadisme.
En Tunisie, j’ai surtout observé chez les
salafistes tunisiens le sentiment qu’ils
avaient raté le coche de la première
révolution et qu’il leur fallait refaire,
réinventer la révolution, qui serait islamique
cette fois. D’ailleurs leur chef de file, Abou
Ayad, a fait une déclaration incitant les
salafistes tunisiens qui se battent en Syrie à
revenir en Tunisie, et demandant aux autres
de ne pas y aller, car, a-t-il dit, la Tunisie
pourrait devenir « une terre de djihad. » Cela
est lié au fait que pour être légitime auprès
de leur public et de leur environnement, il
leur faut réaliser leur propre révolution, une
révolution islamiste et djihadiste.
Vous avez récemment co-dirigé un ouvrage
important sur les métamorphoses de
l’islamisme, évoquant notamment la façon
dont les vieux préceptes ont été secoués
par l’avènement de la modernité, de
la mondialisation et du consumérisme.
Comment définiriez-vous les rapports
entre islamisme et modernité : l’un est-il
soluble dans l’autre ?
L’idée était d’observer l’évolution de l’islam
politique et des mouvements islamistes
depuis une ou deux dizaines d’années.
L’islam politique s’est quelque peu
« indépendantisé » de l’islamisme en tant
que tel pour être récupéré par une pléthore
d’acteurs différents. Le livre s’appellent
« que sont devenus les islamistes ? », mais
il aurait peut-être été plus judicieux de
l’appeler « qu’est devenu l’islam politique ? »
Car les mouvements islamistes ayant échoué
à tenir leurs promesses idéologiques, c’est-
à-dire l’établissement d’un État islamique,
le processus d’islamisation s’est beaucoup
individualisé et a échappé au contrôle
des partis. L’islamisation de la société
a progressé mais non pas à travers les
partis. L’islam politique est donc aujourd’hui
récupéré par des acteurs qui n’ont pas
été socialisés dans les partis islamistes
traditionnels, mais qui sont venus à l’islam
à travers les chaînes satellitaires, à travers
la finance islamique ou à travers une
volonté de mobilité sociale… Nous avons
donc voulu dans ce livre montrer cette
évolution de l’islam politique. Nous avons
dégagé quelques constantes comme le
refus des hiérarchies, l’individualisation de
l’usage de l’islam politique, l’utilisation de
nouveaux supports pour la promotion de
leurs idées tels que la culture, l’économie,
la compétitivité et autres.
Comment voyez-vous l’interaction entre
islam et modernité ?
J’avais écrit un article intitulé : « L’islam
est-il soluble dans le Mecca-Cola ? » Pour
un certain nombre de jeunes musulmans
en Europe et en Amérique du Nord, investir
une consommation islamique était un projet
politique en tant que tel, mais qui échappait
aux codes traditionnels de l’islamisme.
Je pense que l’islamisme a réagi à la
modernité, notamment à l’époque de la
Sahwa. L’enjeu était d’acquérir une certaine
technicité, de combler un retard. Mais on
est aujourd’hui bien loin de ces débats.
La question est aujourd’hui de savoir s’il
y a aujourd’hui une modernité interne
à l’islamisme lui-même en ce sens où,
comme toute théologie, il s’est renouvelé et
s’est adapté à son environnement. Tout un
courant cherche à développer une sorte de
modernité non-occidentale, et par ailleurs,
beaucoup dans le monde arabe et en Iran
se sont servis de l’islamisme pour parvenir
à une réinterprétation de la modernité, dans
le sens d’une réappropriation individuelle
de la modernité.
Plusieurs ouvrages à caractère polémique
ont été publiés ces deux dernières années
au sujet de l’islam en Europe. Comment
voyez-vous ce débat ? Quel bilan peut-on
faire de l’intégration des musulmans
européens ? Pourquoi certains auteurs
américains sont-ils autant persuadés que
l’islamisation de l’Europe est inéluctable ?
Le débat aux États-Unis est assez particulier,
lié aux conditions de compétition internes
entre les intellectuels. Il y a différentes
franges chez les intellectuels, les milieux

Les religions et le monde moderne
dossier
64 / mars 2013 / n°429
néoconservateurs qui soutiennent Israël,
des milieux plus sensibles à la question
palestinienne, des milieux qui soutiennent la
politique extérieure des États-Unis, d’autres
qui la critiquent… La question de l’islam en
Europe arrive donc là-bas un peu comme
un cheveu sur la soupe et cette islamisation
supposée de l’Europe permet parfois à
certains d’illustrer des choses n’ayant pas
grand-chose à voir avec l’islam en Europe
en tant que tel, comme le succès ou l’échec
de telle politique américaine. Il y aussi
un argument commercial évident, et il y
a une confusion. Ce qu’on prend parfois
pour une islamisation, aux États-Unis,
mais aussi en Europe, correspond souvent
plutôt en fait à une visibilité accrue de
l’islam et de ses pratiques. Cette visibilité
accrue est un fait. Cela est dû à plusieurs
facteurs : l’enracinement d’une population
musulmane en Europe, la majorité des
musulmans européens sont aujourd’hui nés
en Europe suite au phénomène migratoire,
et également la reconfiguration de l’espace
public lui-même, par rapport au rôle des
minorités dans cet espace public, les
institutions jouant beaucoup moins le rôle
de lieu où le pouvoir et les citoyens peuvent
se retrouver, la rue, la télévision, Internet,
prennent le relais et donne l’impression
d’une islamisation massive. Le problème
est plus celui d’une déconnexion entre les
institutions et les citoyens musulmans en
Europe. Il y a un déficit d’identification à
la culture politique, au pouvoir et à ses
institutions nationales, ce qui fait qu’il y
a un réinvestissement de l’espace public
qui peut donner l’impression d’une forte
islamisation.
L’une des questions les plus fréquemment
soulevées est-celle de la situation des
femmes musulmanes en Europe. Vous
venez ave rédigé un rapport à ce sujet,
pour l’Open Society Institute. Quel bilan
peut-on en faire ?
Le rapport porte sur plusieurs pays
européens, l’Allemagne, les Pays Bas, la
France, la Belgique, la Grande-Bretagne…
Il s’agissait de mettre en avant les formes
multiples de discrimination, qui appellent
des solutions politiques spécifiques. Très
concrètement, les discriminations ne
viennent pas uniquement du fait que l’on est
femme, mais femme musulmane, et parfois
noires et souvent avec un background
social défavorisé. Tous ces facteurs de
discrimination doivent être pris en compte
pour y répondre sur le plan politique. En
Europe, on a l’habitude de répondre à la
question des discriminations sur le plan
de l’antiracisme. La question religieuse
est plus difficile à appréhender. Et en ce
qui concerne les migrants, on réfléchit
également sur le plan institutionnel et
sur le plan des droits humains. Lorsqu’il
s’agit des femmes musulmanes viennent
s’entrechoquer un certain nombre d’enjeux,
il y a les migrantes et celles qui sont nées
en Europe, celles qui portent le voile et
celles qui ne portent pas, etc.
Y-a-t-il une spécificité française parmi les
pays que vous avez étudié ?
Oui, c’est que les institutions (l’école,
l’hôpital, les lieux où s’exerce l’autorité de
l’État…) sont apparues comme étant les
premières productrices de discrimination.
Les médias jouent également un rôle
important, en écho à ces discriminations.
Une autre spécificité française est la faible
réponse apportée par la communauté
musulmane et la fragmentation de cette
communauté dans les réponses à apporter
aux discriminations. C’est dû à la difficulté
des musulmans de France à se positionner
en tant que musulmans dans l’action
publique. En Angleterre, en Belgique,
au Pays-Bas et en Allemagne, il y a des
initiatives de la société civile qui se font
en solidarité avec les non musulmans,
pour prévenir les discriminations contre les
femmes musulmanes, comme partie d’un
tout. En France, c’est beaucoup plus difficile
et on se rend compte que les musulmans
ont du mal à se positionner. Le débat
fonctionne souvent de façon binaire : pour
ou contre le voile etc., et on ne parvient
plus à s’abstraire de cette vision binaire
pour agir en tant que citoyens vis-à-vis
des institutions, pour être proactifs et non
pas uniquement réactifs face aux diverses
polémiques.
Diriez-vous, comme certains, que la
conception française de la laïcité accentue
le risque de discriminations ?
Je ne le pense pas, parce que d’un point de
vue juridique, les choses sont relativement
simples. En 2009, lorsque le président
Sarkozy a lancé le débat et que la polémique
sur le niqab commençait à enfler, on se
posait la question des termes du débat, la
question de savoir si la question du niqab
devait être traitée sous l’angle sécuritaire,
sous l’angle de l’atteinte morale au droit
des femmes ou sous l’angle de l’aspect
indivisible de la République et des citoyens.
Le problème n’est pas lié à la conception
française de la laïcité mais plutôt à certains
usages de la laïcité, très récents d’ailleurs,
qui amènent par exemple à refuser à une
femme voilée de passer son permis de
conduire ou à l’obliger à enlever son voile
avant de consulter un médecin etc. Ce sont
des usages et des interprétations récents
et aléatoires, en raison de l’absence d’une
parole d’État sur ces questions. L’État a
du mal à articuler une politique claire sur
ce que peut être la visibilité des femmes
musulmanes. Ces sujets sont souvent le
prétexte à des campagnes, à des querelles
politiciennes et à des débats philosophiques.
On passe donc souvent à côté de la question
des discriminations. Il faudrait revenir aux
fondamentaux, au-delà de ce que peut-être
la position de chacun.
Quel avenir pour le soufisme ? Peut-on
assister à un renouveau politique soufiste ?
Dans quelle mesure peut-il concurrencer
les autres mouvances islamistes ?
Mes recherches au Maghreb et en Europe
m’ont amené à rencontrer un certain nombre
de personnes qui étaient passées par des
mouvements islamistes inspirés par les
Frères musulmans ou par le Tabligh, qui en
avaient été déçus, et qui par conséquent ont
cherché à intégrer des groupes qui pouvaient
leur offrir une identification à l’islam, mais
à un autre niveau, un niveau individuel
même s’il y a aussi un groupe qui permet de
créer une solidarité entre ses membres. Le
soufisme remplit parfaitement cette fonction
et l’on observe donc un réinvestissement du
soufisme, qui est beaucoup plus identitaire
qu’il ne l’avait été jusqu’à présent. Il ne
s’agit pas d’une vérité des pratiques soufies.
On retrouve dans le soufisme le même
phénomène de réislamisation volontaire
que l’on a pu observer au sein d’autres
mouvements d’inspiration islamiste. D’un
côté, ils considèrent que le soufisme fait
partie de leur identité traditionnelle, et
de l’autre côté, beaucoup de ceux qui
investissent aujourd’hui le soufisme y
recherchent un projet de qualification, un
« empowerment », une façon d’être actif

dossier
65
/ mars 2013 / n°429
et de pouvoir peser. Cela est assez visible
au Maghreb avec des mouvements divers
et des Zawiyas. On se rend compte que le
réinvestissement des canaux politiques s’est
fait à la faveur du désenchantement et de
la désillusion vis-à-vis de l’islam politique.
L’intérêt du soufisme vient du fait que ces
mouvements vont politiser et motiver leurs
membres sans être en compétition avec les
structures de l’État. C’est beaucoup moins
coûteux. Et beaucoup moins dangereux. Les
Zawiyas sont très connectées à l’État de
façon clientéliste, en tout cas pour le Maroc
et l’Algérie, les liens sont importants. Même
sur le plan transnational, un phénomène
important est le fait que tous les projets
de société, les discours, tous les débats
culturels, sont investis par le soufisme, des
réseaux sont tissés avec d’autres pays, le
soufisme cherche à avoir son mot à dire,
mais tout cela se fait sans compétition
avec l’État. C’est je pense la raison de leur
succès.
Leur poids dans les sociétés est-il croissant ?
Ils accueillent de plus en plus de membres
tout simplement parce qu’ils ne sont pas
aussi contraignants dans leur politique
vis-à-vis des adhésions que ne peuvent
l’être des partis traditionnels. On peut venir,
repartir, s’y associer pour certaines activités.
Il y a donc une capacité du soufisme à ne
pas trop contraindre les gens quelles que
soient leurs affiliations. On peut rejeter
l’État dans lequel on vit ou l’accepter, tout
en étant membre d’un mouvement soufi.
On se retrouve sur les points communs et
on profite ainsi du réseau de solidarité qu’il
peut offrir.
Je suppose que cela commence à irriter
les mouvements salafistes.
Oui, c’est le grand couple binaire, salafisme
vs soufisme. Parce qu’en fait, cela peut
sembler très choquant de dire cela mais le
principe est parfois le même : l’idée d’avoir
une stratégie parasite et non compétitive
avec l’État. C’est-à-dire qu’on ne va pas
créer ses propres structures mais l’on va
parasiter les structures préexistantes pour
pouvoir en tirer profit et exister sur le mode
de la légitimité religieuse. D’où la haine
viscérale qui peut exister entre ces deux
mouvances. ■
Propos recueillis par Karim Émile Bitar
Cyrano de Bergerac 1999
Directeur de la rédaction
1
/
4
100%