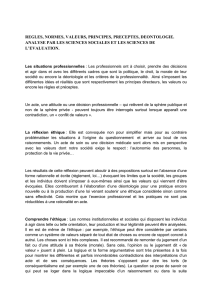À bas la morale, vive l`éthique

Siècle 21 N° 11, automne 2007
À bas la morale, vive l’éthique !
Jérôme Vérain
« Étrangement, le mot “éthique” est aujourd’hui bien accepté dans le discours, alors que le terme “morale”
est rejeté au nom d’une connotation vaguement religieuse ou bien-pensante.1»
On ne peut que souscrire à cette remarque d’Albert Jacquard, formulée il y a dix ans : plus que jamais, toute référence à la
« morale » déclenche sarcasmes et quolibets à l’adresse de l’imprudent qui l’a risquée ; on l’accuse immédiatement de vouloir
rétablir la blouse grise, l’ardoise et les coups de règle sur les doigts, bref d’endosser l’uniforme poussiéreux des hussards noirs de
la République. Bon pour le musée, tout cela ! En revanche la bioéthique, la consommation éthique, les comités d’éthique,
l’éthique environnementale, l’éthique des affaires et même la netiquette 2sont du dernier chic. À bas la morale, donc, et vive
l’éthique.
L’auteur a-t-il raison, pour autant, de considérer les deux mots comme quasi synonymes ? Est-ce un simple effet de mode,
une coquetterie lexicale, qui fait préférer, désormais, le vocable grec au terme latin ? À moins que l’époque ne succombe, une fois
de plus, aux délices du franglais, avec un calque sournois sur l’anglo-saxon ethics…
Si l’on en croit Paul Ricœur, l’éthique est pourtant de portée bien plus vaste que la morale : la première renvoie à un « ques-
tionnement », à une « intention », à l’affirmation par l’individu de sa liberté fondamentale, à « l’affirmation joyeuse du pouvoir-
être, de l’effort pour être, du conatus au sens de Spinoza […] 3» Elle renvoie aussi à l’acceptation de l’autre : « Toute l’éthique naît
[…] de ce redoublement de la tâche […] : faire advenir la liberté de l’autre comme semblable à la mienne. » La morale, avec ses
normes et ses interdits, n’apparaît que de façon seconde, parce que le commerce des consciences, pour libre et intime qu’il soit,
s’inscrit fatalement dans une tradition culturelle et sociale : « L’éducation consiste […] à inscrire le projet de liberté de chacun
dans [une] histoire commune des valeurs. » Si la morale finit donc par imposer la « sévérité » de ses impératifs et de sa loi, elle ne
doit pas faire oublier le « jugement moral privé » : la « tension » entre règle objective et liberté individuelle doit subsister. Ricœur
s’élève contre « toute prétention à faire de la législation la première démarche éthique » et reproche à Kant 4d’avoir « érigé en
fondement ce qui n’est qu’un critère ». Plus question, donc, de conformer notre conduite à des absolus préétablis : la conscience
de chacun est le guide essentiel pour départager le bien du mal.
À ce compte, la langue de bois contemporaine nous aurait réservé, pour une fois, une heureuse trouvaille : remplacer l’alié-
nation de la règle subie par l’affirmation de la liberté et de la responsabilité personnelles, voilà qui est tout profit. Finis, la crainte
et le tremblement 5, l’éthique nous rend la dignité et la joie de vivre que la vieille morale nous avait ôtées. Elle nous fait accéder,
de fait, à cette « immoralité supérieure » dont rêvait Gide : « L’homme sage vit sans morale, selon sa sagesse. 6» En ces temps de
mondialisation triomphante, on comprend que l’abandon des grands absolus au profit d’idéaux moins exigeants, plus relatifs et
susceptibles de révisions périodiques, soit salué comme une délivrance : « L’établissement d’une morale universelle est sans doute
impossible, et d’ailleurs non souhaitable », dit Albert Jacquard 7, pour qui un simple « noyau commun » de grands principes est
suffisant.
Ce n’est donc pas – ou pas seulement – par snobisme linguistique qu’un mot chasse l’autre : nous congédions la morale,
vieillarde ridée et revêche qui ne songeait qu’à brider nos désirs, et faisons bon accueil à l’éthique, pin up aussi séduisante que
compréhensive. La sorcière peut bien emporter avec elle ses balais de crin, ses idéaux rigides et ses essences platoniciennes : dans
la maison décorée de neuf, l’équité remplace la justice, la culture remplace le savoir, les civilités tiennent lieu d’amour du prochain.
21

Certains philosophes contemporains s’emploient avec enthousiasme à légitimer ce divorce libérateur. André Comte-Sponville,
par exemple, reprend le schéma de Paul Ricœur, non pour « reconstruire tous les intermédiaires entre la liberté, qui est le point
de départ, et la loi, qui est le point d’arrivée8», mais pour opposer radicalement les deux ordres. À ses yeux, la morale est affaire
de devoir, donc de volonté (le pôle “je” de Ricœur). L’éthique est définie, au contraire, comme souci de l’autre (le pôle “tu” de
Ricœur), affaire d’amour et de sentiments. 9On serait tenté de préciser : de bons sentiments, tant le partage des rôles fait la part
belle à la seconde composante, parée de toutes les générosités, en réservant à la première le lot ingrat de la sévérité. Sévérité laissée,
d’ailleurs, au bon vouloir de l’individu : elle ne procède plus d’un impératif imposé de l’extérieur, mais d’une sorte d’exigence
privée. Cette mise en quarantaine laisse opportunément les deux autres ordres imaginés par le philosophe, celui de l’économique
et celui du politique, faire leurs petites affaires sans souci des principes gênants : on se gardera bien, dit-il, de compter « sur les
Restos du cœur pour faire reculer la misère, […] sur l’humanitaire pour tenir lieu de politique étrangère, sur l’antiracisme pour
tenir lieu de politique de l’immigration ». On ne saurait régler plus commodément l’épineux problème de la valeur et de la règle,
dont « l’étrange quasi-objectivité […] a toujours été la croix des philosophes 10 ».
Ces arrangements avec l’absolu appellent pourtant quelques commentaires. On remarque d’abord que l’éthique ainsi définie,
à la différence de la morale, est centrée sur l’acte, et non sur la personne. On pouvait stigmatiser un individu de “morale douteuse”,
mais on dira difficilement de quelqu’un qu’il est “peu recommandable du point de vue éthique”. Prendre la place du handicapé
sur le parking, refuser de trier ses ordures ménagères ou diffuser des publicités dans un news group suscitera la réprobation, mais
une réprobation sans suite : l’acte seul est condamné, sans que l’individu soit véritablement atteint. Il y aura peut-être mise à
l’amende, mais pas de procès, et encore moins de casier judiciaire. En un sens, on revient ainsi au pragmatisme d’Aristote qui,
dans son Éthique à Nicomaque, définit la vertu comme action (praxis) : bonne quand elle atteint sa fin, mauvaise dans le cas
contraire. On ne naît pas “vertueux”, on le devient à force de pratiquer la vertu, par une sorte d’imprégnation, de conditionne-
ment ; la morale est réduite à un savoir-vivre, une hygiène de l’action, une sorte de méthode Coué : comme la santé, elle consiste
simplement à prendre de bonnes habitudes. C’est probablement cette assimilation ancienne de la morale à une “éthique”, epistêmê
êthikê, une science du “bon comportement” (êthos), qui put rendre les deux termes synonymes. On remarque au passage que
l’éthique moderne s’intéresse de préférence non pas, comme chez Aristote, aux actes graves et importants, mais aux petits actes ;
non pas aux grandes vertus – le courage, la justice, la tempérance, l’amitié, etc. – mais aux petites ; ne pas laisser couler l’eau en
se lavant les dents, utiliser des ampoules basse tension ou ramasser les crottes de son chien fait de vous un sauveur de la planète,
changer son pot d’échappement un “conducteur citoyen”, éteindre son portable au cinéma un spectateur responsable, acheter le
café des petits producteurs un défenseur du tiers-monde, et porter un préservatif un amant modèle. Cette idéologie du “bon
geste” se décline facilement dans tous les aspects de la vie quotidienne, fournissant à chacun des satisfactions “éthiques” à bon
marché.
Par ailleurs, la définition aristotélicienne pose problème par sa simplicité même : la question de la légitimité des moyens
utilisés ne se pose pas, puisque tous ceux qui atteignent leur fin sont réputés bons. L’Antiquité peut encore croire à l’innocence
de techniques udimentaires. Mais le développement exponentiel des moyens mis à notre disposition, dans tous les domaines,
pose justement, et à chaque instant, cette question. Qu’il s’agisse de médecine, de transports, d’agriculture,
d’échanges économiques, d’armement, d’énergie, d’électronique, la complexité des technologies et des enjeux ne semble plus
permettre à un individu isolé de se prononcer sur le bien-fondé du clonage, du nucléaire, de l’euthanasie, de l’avortement, de
l’utilisation des cellules souches, des OGM, du contrôle des naissances ou des fichiers informatiques. Le jugement “moral” per-
sonnel est donc abandonné au profit d’une “éthique” déléguée à des comités de spécialistes, dont les “avis” varieront en fonction
des pays et seront constamment susceptibles de révision. Les “codes” et les “chartes” laborieusement élaborés seront, par définition,
relatifs et provisoires, et ne s’appliqueront qu’à un secteur donné : sport, journalisme, biologie, travail social, sexualité, business,
publicité, etc. Cet éclatement et cette quasi-professionnalisation de l’éthique, désormais assimilée à une déontologie, est un autre
héritage d’Aristote, qui ne concevait la pratique de la vertu qu’en situation.
Il est un dernier point, peut-être le plus inquiétant, par lequel la substitution de “l’éthique” à la “morale” traduit, non un
simple changement de vocabulaire, mais une mutation décisive des valeurs. La seconde s’est longtemps définie comme la recherche
du “bien”, même si la nature de celui-ci n’était évidemment pas facile à déterminer, et sujette à d’infinies discussions. La première,
au contraire, s’interroge presque toujours sur un “mal” qu’il s’agit d’éviter : catastrophes climatiques, dangers sanitaires, brutalités
économiques, crises sociales, etc. Ainsi s’explique sans doute que les prescriptions de l’éthique soient, le plus souvent, négatives :
ne pas utiliser sa voiture en ville, ne pas laisser chiens et chats se reproduire, ne pas jeter les piles usagées, etc. Le principe de base
consiste à “ne pas toucher”, à respecter : la planète, l’environnement, le patrimoine, la vie… Cette logique restrictive finit d’ailleurs
par se retourner contre elle-même, car l’éthique, qui prétend éviter le mal au lieu de prôner le bien, ne vise réellement, la plupart

du temps, qu’à limiter les excès et les dérives du premier. La grande surface peut étrangler ses fournisseurs, l’entreprise peut
inonder les boîtes à lettres et les télécopieurs de publicités sauvages, le médecin peut refuser les allocataires de la CMU, l’agriculteur
peut gorger la terre de produits dangereux, le chasseur peut transformer la forêt en stand de tir, à condition de le faire, comme le
buveur d’alcool, “avec modération”, c’est-à-dire dans le cadre des codes de conduite produits par les commissions ad hoc. L’éthique
réduite au rang de garde-fou devient ainsi, dans bien des cas, un excellent moyen d’autoriser un maximum d’abus, grâce à la
caution du petit nombre qu’elle interdit.
Alain Badiou suggère que cette façon de mettre le Mal au premier plan du questionnement éthique, loin d’être fortuite, a
été théorisée et légitimée par certains courants philosophiques à la fin du siècle dernier : les “nouveaux philosophes”, en particulier,
ont imposé l’idée que « toute tentative de rassembler les hommes autour d’une idée positive du Bien […] est en réalité la véritable
source du mal. […] Tout projet de révolution, qualifié d’“utopique”, tourne, nous dit-on, au cauchemar totalitaire. » 11 La dé-
marche qui consiste à renoncer aux grands idéaux, supposés illusoires et dangereux, au profit d’un humble questionnement sans
cesse recommencé, séduit évidemment par ses apparences de prudence et de modestie. Mais elle a comme conséquence inaperçue,
dit Badiou, de donner de l’Homme une définition « négative et victimaire » : au lieu d’envisager, comme le faisait la morale, un
« sujet humain universel », « l’éthique subordonne l’identification de ce sujet à l’universelle reconnaissance du mal qui lui est
fait ». Or ce statut de victime a l’inconvénient de fixer les rôles : à la différence de l’action morale, qui suppose la réciprocité
(« traite l’autre comme tu veux qu’il te traite »), l’éthique institue sans le dire une inégalité intangible et définitive entre le “bien-
faiteur” et le “bénéficiaire” de la “bonne action”. L’exemple de l’humanitaire lui semble particulièrement probant à cet égard :
« Qui ne sent que cette éthique penchée sur la misère du monde cache, derrière son Homme-victime, l’Homme-bon, l’Homme-
blanc ? »
Tout se passe, au total, comme si les vieilles valeurs que l’on avait cru mettre à la porte avec la morale étaient revenues par
la multitude de fenêtres ouvertes par l’éthique. Au lieu de grands principes validés par la tradition, nous acceptons simplement,
sans vraiment réfléchir à leur légitimité, les grandes “causes” dont le marketing et les médias, véritables fabricateurs du consensus
moderne, nous inculquent inlassablement le culte révérenciel et collectif. Du produit “biologique” à la voiture “propre”, du
commerce “équitable” aux emballages “recyclables”, du shampoing “naturel” aux lessives “respectueuses de l’environnement”,
les bulles conceptuelles qui nous tiennent lieu d’idéaux marquent en tout cas un avantage décisif de l’éthique sur la morale : elle
fait vendre.
Notes
1) Albert Jacquard, Petite philosophie à l’usage des non-philosophes, article « Éthique », Calmann-Lévy, 1997.
2) Curieux mot-valise franco-anglais, de network et étiquette, qui désigne l’ensemble des règles de civilité à respecter à l’occasion des envois de mails, des par-
ticipations aux chats, news groups et autres forums.
3) Article « Éthique » de l’Encyclopædia Universalis, 1985. Voir, du même auteur : Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, et Éthique et responsabilité, La Ba-
connière, 1995.
4) « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être érigée en loi morale universelle »,
disait l’auteur de la Critique de la raison pratique (1788).
5) Titre, on le sait, d’un ouvrage de Kierkegaard (1843), qui évoque le déchirement d’Abraham, partagé entre l’impératif moral de sa foi (respecter l’ordre
de Jahvé) et son éthique paternelle (ne pas tuer son fils).
6) Journal 1889-1939, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1951.
7) Op. cit.
8) Paul Ricœur, op. cit.
9) André Comte-Sponville, Le capitalisme est-il moral ?, Albin Michel, 2004.
10) Paul Ricœur, op. cit.
11) Alain Badiou, L’Éthique, essai sur la conscience du mal, Hatier, 1993
Inédit. DR.
1
/
3
100%