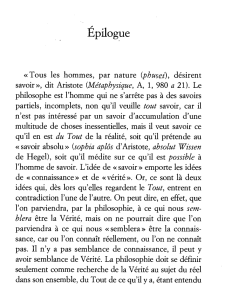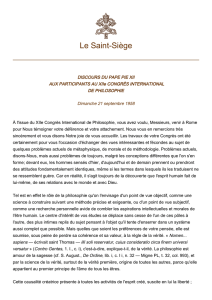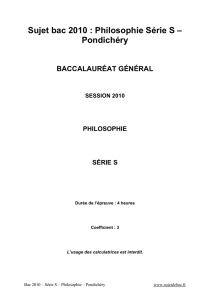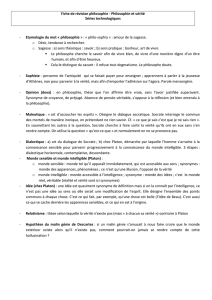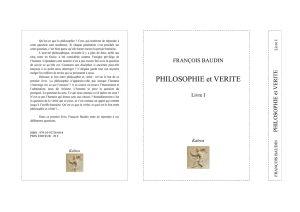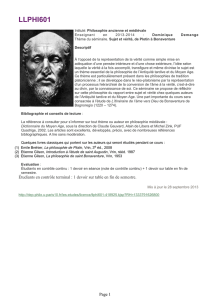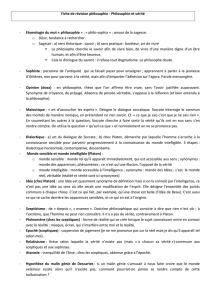Confession d`un philosophe, Réponses à Comte

XIX. Métaphysique de la Nature et sagesse tragique
Qu'on ne puisse pas voir le Tout, ce n'est pas moi qui le contesterai! C'est évidemment impossible,
puisqu'on ne peut rien voir que d'un certain point de vue, toujours partiel, subjectif, relatif, limité ...
Mais qu'on ne puisse le voir tout entier, cela n'empêche pas qu'on soit dedans! Aucune clairière
n'est «le tout de la forêt» ; mais elle n'en fait pas moins partie ... La sagesse, de mon point de vue,
n'est pas la possession de la vérité (comment pourrait-on posséder ce qui nous contient ?), mais
une certaine façon de l'habiter, de la vivre, et même de la chercher (toute quête de la vérité fait
partie de ce qu'elle cherche: ma quête de la vérité est une partie de la vérité). Et une vraie joie,
même portant sur le Tout (joie d'être au monde, et que le monde soit), ne suppose nullement que
tout, dans le monde, soit joyeux ou réjouissant ... Mais laissons mon point de vue. Ce que j'ai du
mal à penser, dans le vôtre, c'est la conjonction du scepticisme et de ce que j'appellerais volontiers,
faute d'un meilleur mot, votre théoricisme, à savoir l'idée que la philosophie est, et n'est que, « la
recherche de la vérité au sujet du Tout de la réalité ». Non que cette définition me dérange
particulièrement (quoiqu'elle me paraisse quelque peu unilatérale: j'y verrais une définition
possible de la métaphysique, mais la métaphysique n'est pas le tout de la philosophie .. .), mais en
ceci que j'ai du mal à comprendre comment on peut consacrer sa vie à cette recherche de la vérité,
y voir l'essence même de la philosophie, etc., quand on pense par ailleurs que la vérité est
définitivement hors d'atteinte, qu'on ne pourra jamais la posséder, ni même, peut-étre bien s'en
approcher (Puisqu'on ne pourrait savoir qu'on s'est approché de la vérité qu'à la condition de la
connaître). Cela ne voue-t-il pas la philosophie à l'échec? Ou plutôt, et pire (car l'échec fait partie
de la condition humaine), cela ne réduit-il pas la philosophie à une espèce de peau de chagrin
théorique, qui n'échappe au délire spéculatif comme on voit chez les auteurs de système, que pour
tomber dans la tautologie? Sur l'univers des physiciens, on sait beaucoup de choses, et de plus en
plus. Mais vous me direz que ce n'est pas le Tout ... Soit. Mais sur le Tout lui-même, que pouvons-
nous savoir, sinon qu'il est, qu'il est infini (quoique cela même, malgré Lucrèce, me paraisse
douteux) et qu'il change? Est-il bien raisonnable d'avoir consacré tant de milliers de livres, depuis
vingt-cinq siècles, à ces quelques lapalissades d'ailleurs incertaines?
La philosophie, comme métaphysique (qui est la partie inamovible de la philosophie), est recherche
de la vérité au sujet du Tout de la réalité. Ces deux notions, «Tout » et «réalité », sont
essentiellement problématiques. Considérons d'abord le mot «Tout », ensuite le mot « réalité ».
Je puis parler de « ce qu'il y a » , ces maisons, ces collines, ces fleurs ... Mais qu'en est-il de « tout
ce qu'il y a » ? Pour mon ami Pierre, qui est chrétien, « tout ce qu'il y a » comprend Dieu et le
monde. Mais Nietzsche dit: «Il n'y a pas de Dieu; il est aussi bien réfuté qu'une chose peut l'être »
(Œuvres philosophiques, t. X, Gallimard, 1982, p. 96). Le Tout comprend-il Dieu et le monde? ou
seulement le monde? ou seulement la Nature? La question est-elle même décidable? Il fut un temps
où l'on « prouvait » l'existence de Dieu : il y avait la « preuve » ontologique, la « preuve »
cosmologique, la « preuve » physico-théologique. Mais pourquoi plusieurs preuves? N'est-ce pas
qu'aucune de ces « preuves » n'était probante? Car une seule vraie preuve eût rendu les autres
inutiles. Vous-même les énumérez dans vos Présentations de la philosophie, pour conclure que ces
«preuves» ne prouvent pas. L'existence de Dieu est-elle pour autant «réfutée» ? Nietzsche le dit, et
c'est aussi ce que j'ai cru. J'ai invoqué le «mal absolu» à l'encontre de la Bonté divine. Mais il est
toujours possible de contourner un argument; les «avocats de Dieu» - le mot est de Leibniz - n'ont
pas manqué de le faire. Après avoir dit que Dieu est «réfuté », Nietzsche ajoute: «Il faut se réfugier
dans l'incompréhensible pour maintenir la thèse de son existence.» Il montre le moyen de se tirer
d'embarras: l'incompréhensible, le suprarationnel, le mystère. De là Pascal: «Athéisme marque de
force d'esprit, mais jusqu'à un certain degré seulement» (fr. 225 Br.) ; « La dernière démarche de la
raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent» (fr. 267 Br.). Ainsi la
- 1 -

question de savoir ce qu'il en est du Tout est indécidable. Je tiens les dogmes et les promesses de la
religion pour illusoires; mais ce n'est là que ma conviction et, si l'on veut, «ma» vérité. Quant à «la»
Vérité, elle est bien «définitivement hors d'atteinte », car il ne saurait y avoir de réfutation du
monothéisme qui fasse l'accord des esprits. À mes yeux, le Tout de ce qu'il y a est la Nature; mais il
n'y a pas non plus de démonstration du naturalisme qui s'impose à tous les esprits. Il n'y a pas de
preuve irréfragable en métaphysique. Aussi toute métaphysique est-elle particulière: il y a des
métaphysiques. Tel est le pluralisme philosophique, lequel ne serait pas possible sans un
scepticisme de fond, qui n'est lui-même que la reconnaissance par l'homme de l'essentielle
ignorance liée à sa condition. Que de «la » Vérité on ne puisse, selon ma façon de voir, même pas
«s'approcher», ou du moins savoir si l'on s'en approche ou non, vous avez raison de le dire; et aussi
de dire que la philosophie est, de ce fait, vouée à l'échec: eu égard à l'idéal d'un savoir absolu, la
philosophie est vouée à l'échec par sa nature même. Les questions métaphysiques sont indécidables
- telle la question de savoir ce qu'il en est, métaphysiquement, du sens de l'homme. Au mieux,
chacun aura-t-il «sa» vérité.
Si la notion de «Tout » est problématique, la notion de «réalité» ne l'est pas moins. D'abord, faut-il
dire «être» ou «réalité» ? Platon parle de ce qui est όυτως όυ (Phèdre, 249c), «véritablement étant»
; mais Robin traduit «réellement réel». Heidegger renouvelle, dans Sein und Zeit la «question de
l'être ». L'influence de ce livre est perceptible dans l'admirable Philosophie de l'histoire de la
philosophie, que Gueroult a écrit à partir de 1933 (et qui n'a pas été publié de son vivant) ; mais au
mot «être », il préfère le mot «réalité ». Avec raison si «être» a une extension plus restreinte, comme
lorsque Nietzsche écrit qu'«il faut nier l'être» (o. c., p. 166). Il nie 1'« être», il ne nie pas le
«devenir» : l'être et le devenir sont «réels ». S'il n'y avait là que des significations allant de soi, on
pourrait rêver d'une vérité une et la même pour tous. Mais il n'en va pas ainsi. Pour Descartes, le
sens du mot «être» est suffisamment clair. De même pour Canguilhem: «Je ne pose pas la question
de l'être, puisque je suis: je suis, donc il y a de l'être; il n'y a pas de question» (Cahiers de
philosophie,janv. 1967, p. 54). Mais Montaigne se demande si n'être qu'un bref instant dans la durée
infinie, c'est vraiment être. Toutefois, vous-même diriez - je songe à L'Être-temps, p. 10: être, si
brièvement que ce soit, c'est être encore; l'être est «un moment du devenir» (p. 152). De mon côté,
je parle, dans L'Aléatoire, d'une «réification préphilosophique des événements en «êtres» (p. 150) et
d'une réduction philosophique des «êtres» en événements. «Êtres» ou événements ? N'y aurait-il,
entre les philosophes, que des différences de terminologie ? Ne feraient-ils qu'exprimer, par des
mots différents, une même vérité? J'incline plutôt à distinguer, avec Gueroult, ce qu'il nomme le
«réel commun» des «réels» philosophiques, lesquels sont divers: chaque philosophie se fonde sur
une décision touchant ce qui est réel - ce qui mérite d'être dit «réel» - et ce qui ne l'est pas. En vertu
de quoi, Aristote nie la réalité des atomes de Démocrite, Epicure nie presque tout ce qui est réel
pour Aristote, et les idées n'ont pas pour lui la réalité que leur accorde Platon; Descartes ne
reconnaît d'autre réalité dans les corps que celle de l'étendue et du mouvement, etc. Pour certains
philosophes, les idées sont des substances, pour d'autres ce ne sont que des concepts, d'autres les
réduisent à des noms. Pour certains, la réalité - ou du moins la «vraie» réalité - se donne aux sens;
pour d'autres, à l'intelligence; pour d'autres, à une intuition sui generis. Bref, au sujet de la «réalité»
comme du «Tout », la philosophie hésite. Dans les sciences, on parle d'« expérience cruciale»
permettant de trancher entre les hypothèses; il n'y a pas d'expérience cruciale en philosophie.
«Platon n'a jamais pu réfuter Protagoras» , disait Jules Vuillemin. Les philosophies authentiques
sont mutuellement irréfutables. La quête de la Vérité avec un grand V, c'est-à-dire d'une Vérité qui
puisse achever la philosophie, avait peut-être un sens à l'époque des systèmes: aujourd'hui, ce serait
une quête désespérée - mais ce n'est la quête de personne. Il est acquis que la philosophie ne
pourrait qu'échouer nécessairement à vouloir être une science. Est-ce là la fin de la philosophie? Au
contraire: ç'en est le commencement.
D'abord, toute philosophie authentique a un sens de vérité. J'avoue que ce qui m'intéresse n'a jamais
été autre chose que de dire et d'écrire ce qui me semble vrai. Vrai pour moi ? Nullement ; vrai, tout
- 2 -

court. Mais parce que mon ami Pierre pense que Dieu aussi existe, de sorte que la Nature n'est
qu'une partie de l'Ensemble des choses, j'ajoute, pour faire une place à son discours - le croyant
faux, certes, mais irréfutable -, que ce que je dis est vrai «pour moi». Vous parlez de mon
«scepticisme ». Ici, je puis redire ce que j'ai écrit dans Présence de la Nature: «De ce qui est pour
moi la vérité, je ne puis faire la preuve de manière à convaincre autrui. C'est pourquoi, je me dis
"sceptique", mais c'est un scepticisme à l'intention d'autrui. Il ne signifie pas que j'aie le moindre
doute quant au bien-fondé de ma position métaphysique, mais seulement que, de ce qui est pour
moi la vérité, je renonce à faire la preuve pour les autres, et cela non par incapacité de trouver une
telle preuve, mais parce que, par principe, dans le domaine de la métaphysique - dont l'objet est la
totalité des choses en tant que Totalité -, il ne saurait y avoir de preuves. En d'autres termes, je ne
doute pas en fait: mais j'admets qu'en droit, le doute est permis et le sera toujours» (p. 87). Je
philosophe, comme il convient, sur le fond de mes propres évidences, qui ne sont pas des évidences
naïves, des évidences de début, mais des évidences méritées, des évidences advenues. Et mes
convictions ne sont pas des opinions, variables au gré des événements, des hasards psychologiques
et des influences, mais des Gesinnungen, mot de Hegel, que Éric Weil traduit par «convictions
vécues ». Je ne nie pas que les convictions de mon ami Pierre, homme de foi chrétienne, ne soient
aussi des convictions vécues. La Vérité qui nous mettrait d'accord, ni lui ni moi ne la connaîtrons
jamais: «lapalissade», si vous voulez, mais nullement «incertaine ». Mais ma conviction n'en est pas
moins ce qu'elle est et, avec elle, le sentiment très fort de vivre pour et dans la vérité. Tout cela peut
sembler paradoxal. Mais c'est ainsi que sont les choses aujourd'hui. D'une part, la Vérité qui nous
éclairerait, nous les hommes, de façon définitive sur ce que nous sommes et sur ce que cela signifie
pour nous être au monde, cette Vérité est certes, en principe, hors d'atteinte; mais pratiquement - par
cette pratique qu'est la philosophie -, je l'atteins néanmoins: car, à mes yeux, le naturalisme est le
vrai. Je «l'atteins» : je pense l'atteindre - illusion peut-être! Ce «peut-être» constitue l'élément
tragique de la condition du philosophe. Mais je dois dire qu'il ne pèse guère: il a le poids d'un fétu -
puisque, je le répète, pour moi, le naturalisme est le vrai. Si je parle de je ne sais quelle « Vérité
hors d'atteinte », ce n'est que par respect pour mon ami Pierre, pour qu'il puisse croire être dans le
vrai une telle croyance correspondant, chez lui, à un besoin et étant nécessaire à son équilibre. Bref,
si je déclare la Vérité «hors d'atteinte», c'est par égard pour mes semblables. Je ne suis pas comme
Nietzsche qui, en voulant substituer l'annonce et le prêche du retour éternel aux prêches d'espérance
- religieux ou non -, entendait séparer les «forts» et les «faibles », ceux-ci ne pouvant supporter de
revivre éternellement et identiquement la même vie, avec les mêmes échecs, les mêmes malheurs.
Si mes semblables prennent pour vérité ce qui n'est qu'illusion, pourquoi pas s'ils trouvent dans leur
foi un soutien de leur tranquillité et de leur bonheur ? Pour moi, je préfère la vérité au bonheur;
pour les autres, je préfère le bonheur à la vérité.
Vous définissez la philosophie, «une pratique théorique qui a le tout pour objet, la raison pour
moyen et la sagesse pour but» (art. «Philosophie» de votre Dictionnaire). J'admets cette définition,
excepté que je remplace le mot «sagesse» par le mot «vérité». Cependant, définir la philosophie,
selon l'étymologie, comme «amour de la sagesse », n'est nullement obsolète. Vous êtes ici en la
compagnie de Nietzsche. Voici ce qu'il écrit en 1864: «La philosophie amour de la sagesse; s'élever
jusqu'à la conception du sage qui, étant l'homme le plus heureux, le plus puissant, justifie tout le
devenir et en veut le retour; non pas l'amour des hommes, ni des dieux, ni de la vérité, mais l'amour
d'un état, d'un sentiment de perfection spirituelle et corporelle à la fois; l'affirmation, l'approbation
qui naît du sentiment débordant de la puissance créatrice. La suprême distinction» (o. c., p. 150;
mais je cite la traduction de G. Bianquis). «Ni de la vérité» : voilà les mots qui me séparent, ici, de
Nietzsche. Il a en vue un certain état de sagesse vécu par l'être humain. Je ne nie pas l'intérêt de cet
état: non pour moi, cependant, car le premier souci du philosophe ne doit pas être lui-même - et ses
«états». Jadis, dans l'Orientation philosophique, j'étais porté à voir, avec Kant, dans la question
«Qu'est-ce que l'homme? », la question ultime de la philosophie. Dès lors, la question «Comment
vivre en sagesse? » me paraissait fondamentale. Comme vous connaissez bien mes écrits, et
- 3 -

notamment ce livre, Orientation philosophique, que vous avez préfacé, mes réponses d'aujourd'hui -
de ce mois d'avril 2002 - vous paraissent, n'est-ce pas, quelque peu surprenantes et même
déconcertantes? J'ai évolué, il me semble. Mais quant à cette «évolution », c'est un problème que je
laisse à Pilar Sanchez Orozco, dont c'est le sujet de thèse. Je ne suis pas historien, surtout pas
historien de moi-même. Que voulez-vous, je vis aujourd'hui, non hier. Et je philosophe aujourd'hui.
Or, il se trouve que j'éprouve beaucoup moins que dans ma jeunesse d'intérêt pour l'homme - qui
m'a, au xxe siècle, énormément déçu, et qui me paraît bien peu de chose dans l'immense Nature - et
fort peu d'intérêt pour moi-même (je me croirais ridicule de tenir un journal intime). Vous le savez:
avec Socrate, la philosophie change de cap: elle se détourne des études sur la Nature pour regarder
vers l'homme et les choses humaines - les vertus morales, la politique; l'éthique prend le pas sur la
métaphysique. En remontant aux philosophes d'avant Socrate, j'ai pour ce qui me concerne - remis
au premier plan la préoccupation de la totalité des choses et de la Nature comme totalité.
Je mets au premier plan la vérité, et «le vrai est le Tout», dit Hegel; une philosophie est une «vision
unique et globale du Tout», dit Bergson (Œuvres, P.U.F., p. 657). Mon intérêt de philosophe est
celui-ci: rechercher la vérité; ou, pour m'exprimer plus naïvement: chercher à comprendre. Que le
Tout soit infini, cela vous semble «douteux». Certes, cela est douteux si la notion de «Tout» reste
problématique; mais si le Tout est égalé à la Nature, que son infinité soit encore douteuse, telle est
bien votre pensée, que vous exprimez en prenant vos distances à l'égard soit de Lucrèce, soit de
Pascal et de sa «sphère infinie» (art. «Infini» de votre Dictionnaire). Alors, je cherche à comprendre
et ne comprends pas: comment, si la Nature est le Tout, pourrait-elle être finie puisqu'il n'y aurait
rien pour la limiter? Mais je ne veux pas inverser les rôles et devenir questionneur ... Que la Nature
doive être dite «infinie», comme l'admettent les naturalistes et matérialistes grecs aussi bien que
modernes, cela me semble juste. Qu'en est-il maintenant de cette infinité? La Nature est infinie dès
lors qu'enveloppant tout ce qu'il y a, il n'y a rien de surnaturel pour la limiter. Elle est infinie sous
l'aspect de l'étendue sans limites (je parle de l'étendue naturelle, non de l'espace construit, qui est
infini ou non, selon les géométries), infinie également sous l'aspect du temps sans commencement
ni fin, infinie aussi sous l'aspect du nombre; et puis infinie en diversité, infinie en complexité
(Poincaré parle d'un «écheveau inextricable »), infinie en fécondité. La Nature - j'entends la phusis
grecque - est une force créatrice de formes, qui, après toutes ses créations, est toujours autant
capable de nouvelle créations. Certes, qui dit «infini» dit «incompréhensible», si comprendre, c'est -
dit Descartes - «embrasser par la pensée» ; mais, ajoute-t-il, nous «entendons» (intelligimus) ce fait
même que nous ne comprenions pas l'infini, de sorte que disant «infini », nous savons ce que nous
voulons dire (cf. Réponses aux premières objections, AT, IX, 89). Comprendre que l'infini est tel
que nous ne pouvons le comprendre, c'est, d'une certaine façon, le comprendre. Bref, disant que la
Nature est infinie, j'ai le sentiment de comprendre (au sens d'« entendre ») ; disant qu'elle est
«finie», je ne l'ai pas.
Je veux expliquer maintenant le passage de la philosophie à la sagesse. La recherche philosophique
m'a conduit à ce qui me semble vrai (je précise «me semble », disais-je, uniquement parce que la
vérité que j'ai atteinte - et qui est bien pour moi «la» vérité - est incapable de réaliser l'accord des
esprits). La Nature est le Tout. L'homme est, comme tous les vivants, voué à une mort «naturelle»
qui est non -vie. N'est-ce pas alors une vision désespérante, accablante, que celle que nous
représente Roger-Pol Droit dans ce passage de son livre 101 Expériences de philosophie
quotidienne: «Considérez que l'humanité est un hasard, un ratage, un accident biologique. Elle s'est
développée sans ordre, sur un caillou perdu, dans un coin infinitésimal. Elle disparaîtra un jour à
jamais, sans que nul en ait mémoire, sans que personne s'en soucie. Au cours des dizaines de
milliers d'années où elle aura survécu, cette curieuse espèce aura interminablement stagné. Puis elle
se sera multipliée inconsidérément en saccageant son lieu de vie. Elle aura aussi accumulé, avant de
disparaître, une quantité de souffrances inimaginables et inutiles, des massacres et des famines, des
servitudes et des oppressions. Observez lucidement cette espèce absurde et violente. Regardez en
face son absence de justification, son existence éphémère et insensée. Exercez-vous à endurer cette
- 4 -

idée que l'humanité n'a fondamentalement ni raison d'être ni avenir» (pp. 187-188). Je ne
m'exprimerais pas tout à fait comme Roger-Pol - qui, d'ailleurs, reconnaît que, sur un fond de non-
sens et d'horreur, se détachent des dons sans pareils; j'aurais quelques réserves au sujet de ce que
certaines de ses formules impliquent. Reste que dans la conception naturaliste, l'homme n'est qu'un
mode passager de la grande Nature, qui une fois aura ouvert cette parenthèse qu'est l'homme, puis
l'aura refermée.
Dans ces conditions, le problème de la sagesse, c'est-à-dire de la meilleure façon de vivre, se pose
tout autrement que pour mon ami Pierre, qui croit, lui, en l'immortalité des âmes. Comment vivre,
sachant que je mourrai et qu'il ne restera aucune trace de moi au bout d'un certain temps? Je puis me
contenter de vivre heureux, prenant plaisir à ce que m'offre la vie: je réduirais la sagesse à n'être que
l'art du bonheur. Que ce soit là un choix possible, voire raisonnable pour certaines natures
d'hommes, j'en conviens. Mais ce n'est pas le mien. Le grand bonheur est toujours extraordinaire et
impréparé; on ne peut ni le choisir ni l'organiser. Quant au petit bonheur courant, je n'y vois
qu'ennui et promesse d'ennui. J'ai choisi ce qui seul s'accordait à ma nature et à l'ardeur que j'ai: ce
que j'appelle une sagesse «tragique» - donner le plus de valeur possible à ce qui va périr. Cette
sagesse est celle, au fond, de tous ceux qui s'appliquent à réaliser quelque chose d'aussi parfait que
possible, quoique sans durée. Je ne la crois pas d'un ordre plus élevé que celle de ma femme qui,
dans sa cuisine, comme une fée, faisait des tartes merveilleuses - dont il allait ne rien rester. J'ai
parlé de deux sagesses: la sagesse «d'avant» (et de « pendant»), qui est une condition de la saine
démarche du philosophe, la sagesse «d'après », médiatisée par la pratique théorique, qui en est le
résultat, sans en avoir été le but. Quelle doit être ma vie, étant donné ce qu'est ma philosophie? Telle
est la question qui se pose au philosophe, qui se pose à moi. La sagesse d'avant est «tragique », car
je veux la vérité, dût-il m'en coûter le bonheur. La sagesse d'après est «tragique », car je choisis le
meilleur et le plus difficile sous l'horizon de la mort. Ce choix est-il une conséquence nécessaire du
naturalisme? Nullement. Le naturalisme ne nécessite rien. La sagesse est libre. Elle implique un
saut hors de la philosophie, qui ne peut être accompli que dans et par la liberté.
- 5 -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%