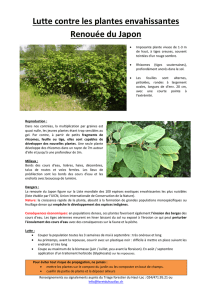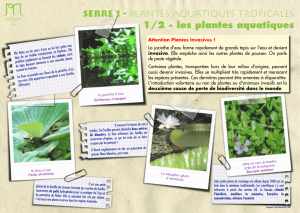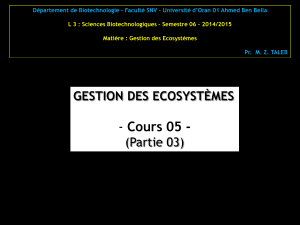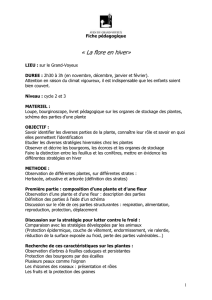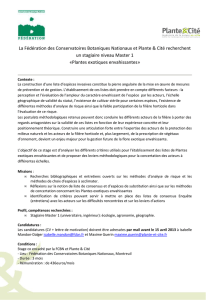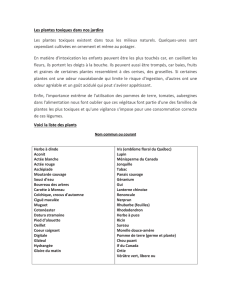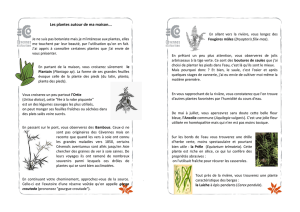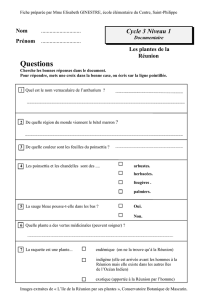PLANTES INVASIVES INVASIVES INVASIVES ET

PLANTES
PLANTES PLANTES
PLANTES INVASIVES
INVASIVESINVASIVES
INVASIVES
ET
ETET
ET
DIVERSIFICATION
DIVERSIFICATIONDIVERSIFICATION
DIVERSIFICATION
HORTICOLE
HORTICOLEHORTICOLE
HORTICOLE
EXIGENCES
EXIGENCES EXIGENCES
EXIGENCES ÉCONOMIQUES
ÉCONOMIQUESÉCONOMIQUES
ÉCONOMIQUES
ET
ETET
ET
ÉCOLOGIQUES
ÉCOLOGIQUESÉCOLOGIQUES
ÉCOLOGIQUES
Cécile Bresh (INRA URIH880 Sophia Antipolis)
Cécile Bresh (INRA URIH880 Sophia Antipolis)Cécile Bresh (INRA URIH880 Sophia Antipolis)
Cécile Bresh (INRA URIH880 Sophia Antipolis)
Isabelle Mandon
Isabelle MandonIsabelle Mandon
Isabelle Mandon-
--
-Dalger (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Dalger (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Dalger (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Dalger (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles)
Porquerolles)Porquerolles)
Porquerolles)
Onesto J.P. (INRA URIH880 Sophia Antipolis)
Onesto J.P. (INRA URIH880 Sophia Antipolis)Onesto J.P. (INRA URIH880 Sophia Antipolis)
Onesto J.P. (INRA URIH880 Sophia Antipolis)
Introduction
IntroductionIntroduction
Introduction
La France est, selon la littérature, le pays européen
possédant le plus d'espèces naturalisées : soit 440 espè-
ces [12] (ou selon des données plus récentes 479 espèces
[13]), ce qui représente 9.4 % de la flore du territoire
[12].
Les motivations relatives à l'échange de plantes ont
évolué au fil des siècles répondant au départ à des be-
soins essentiellement alimentaires ou médicaux puis liés
à l'horticulture ornementale à partir des XVIIIème et
XIXème siècles. Ce dernier domaine d'activité constitue
aujourd'hui une des filières majeures d'introduction de
plantes potentiellement envahissantes.
En France, le Conservatoire Botanique National Médi-
terranéen de Porquerolles (CBNMP) estime que 75 %
des espèces invasives ont été introduites à des fins de
culture [4].
Par l'ampleur de leur dissémination, les plantes enva-
hissantes peuvent modifier profondément des écosystè-
mes et représenter un impact économique non négligea-
ble [2].
La diversification horticole est un élément essentiel à
la dynamique du marché de l'horticulture et également
une source d'introduction de nouveautés végétales dont
l'impact écologique à venir est souvent difficile à éva-
luer.
De plus, les qualités attendues d'un végétal, pour le
milieu horticole, sont très apparentées aux caractéristi-
ques de certaines plantes invasives (croissance rapide,
maturité précoce, production élevée de semences, pro-
pagation végétative...). Même s'il n'existe pas de profil
unique d'une plante envahissante, l'expression d'un ou
de plusieurs de ces critères peut être indicateur d'un
potentiel invasif.
La prévention est reconnue comme la politique la plus
efficace afin de limiter l'introduction et la commerciali-
sation de plantes envahissantes tout en tenant compte
des contraintes économiques.
Contexte
ContexteContexte
Contexte
Impact des plantes envahissantes
Impact des plantes envahissantesImpact des plantes envahissantes
Impact des plantes envahissantes
L'impact environnemental des plantes envahissantes
est visible dans la modification profonde du fonctionne-
ment des écosystèmes (au niveau des cycles biogéochi-
miques ou hydrobiologiques, de l'inammabilité), la mo-
dification de la composition floristique d'une commu-
nauté végétale, les modifications génétiques
(introgression, hybridation), ou l'introduction de nou-
velles maladies. A l'impact écologique s'ajoutent les
pertes économiques liées aux plantes envahissantes :
aux Etats-Unis, le coût du contrôle seul de l'arbuste
australien Melaleuca quinquenervia est de 3 à 6 millions
de dollars par an [6].
Une introduction n'équivaut pas forcément à une inva-
Une introduction n'équivaut pas forcément à une inva-Une introduction n'équivaut pas forcément à une inva-
Une introduction n'équivaut pas forcément à une inva-
sion
sionsion
sion
Une plante envahissante est une plante exotique na-
turalisée produisant une descendance fertile, souvent
en très grande quantité et à des distances importantes
des pieds parents [8]. A cette approche, sont parfois
intégrées les notions d'impacts économique et environ-
nemental mentionnant l'installation dans les milieux
naturels et semi-naturels et des perturbations sur la
composition et la structure de ces écosystèmes [3].
Sur la proportion d'espèces introduites, un faible
pourcentage s'avère envahissant. Sur dix espèces im-
portées, une seule s'avère introduite. Sur dix espèces
introduites, une seule se naturalise après avoir surmon-
té les barrières géographiques, environnementales loca-
les et celles de la reproduction. Et une seule des dix
espèces naturalisées devient une espèce invasive [14].
Similitudes entre une plante de jardin idéale et une
Similitudes entre une plante de jardin idéale et une Similitudes entre une plante de jardin idéale et une
Similitudes entre une plante de jardin idéale et une
plante invasive
plante invasiveplante invasive
plante invasive
Aucune espèce ne possède tous les traits d'une espèce
invasive et tous ces traits ne sont pas indispensables
pour qu'une espèce s'avère invasive [9]. Toutefois, la
comparaison des traits de plantes envahissantes et de
plantes de jardin idéales montre des similitudes (cf. ta-
bleau 1).
Ces traits concernent essentiellement la vigueur et
les capacités de multiplication (en dehors des critères
esthétiques). Même s'il n'existe pas de profil caractéris-
tique unique d'une plante envahissante, l'expression
d'un ou de plusieurs de ces critères peut être significa-
tif d'un potentiel invasif.

Tableau 1 : Parallèle entre les traits d'une plante de jar-
din idéale et ceux d'une plante envahissante
Méthode
MéthodeMéthode
Méthode
Afin de limiter l'introduction et la commercialisation
des plantes envahissantes, la prévention est reconnue
comme la politique la plus efficace (Global Invasive Spe-
cies Database) (www.issg.org/database/welcome/
aboutGISD.asp). La prévision du potentiel invasif d'une
espèce végétale ainsi que les actions d'information/
sensibilisation des acteurs de la filière horticole sont
deux solutions possibles.
Prévoir le risque lié à l'introduction d'une plante exoti-
Prévoir le risque lié à l'introduction d'une plante exoti-Prévoir le risque lié à l'introduction d'une plante exoti-
Prévoir le risque lié à l'introduction d'une plante exoti-
que
queque
que
Placés plutôt en amont du processus de diversifica-
tion, les modèles de prévision du risque d'invasion
WRA (Weed Risk Assessment) et ARP (Analyse de Ris-
que Phytosanitaire) permettent d'évaluer le risque d'in-
vasion lié à l'introduction d'une espèce exotique. Ils sui-
vent tous deux une méthodologie transparente et une
démarche scientifique avec un système de pondération
des questions.
L'ARP permet, d'une part de déterminer si un orga-
nisme doit être réglementé et, d'autre part, d'évaluer
l'intensité des mesures phytosanitaires à prendre.
Le WRA évalue le potentiel invasif des espèces végé-
tales. Les critères utilisés concernent le plus fréquem-
ment l'observation de la biologie et de la physiologie de
l'espèce, de l'aire d'introduction et des interactions en-
tre la plante et l'aire considérée. Les objectifs d'un mo-
dèle de type WRA sont de trier sans erreur les espèces
invasives, les espèces non invasives et de s'assurer que la
proportion de taxons nécessitant une deuxième évalua-
tion soit réduite au minimum [5].
Informer et impliquer la filière horticole
Informer et impliquer la filière horticoleInformer et impliquer la filière horticole
Informer et impliquer la filière horticole
Choisissant d'agir avec les acteurs de la diversifica-
tion horticole, le CBNMP implique activement l'en-
semble de la filière horticole en matière de lutte pré-
ventive. L'idée du programme
Plantes envahissantes
dans la région méditerranéenne
développé depuis 2001
est de travailler en partenariat avec les acteurs de l'hor-
ticulture et du paysage, ces derniers participant sans le
savoir forcément à la dissémination d'espèces envahis-
santes. Un comité de pilotage a été créé avec toutes les
branches de la filière horticole : horticulteurs, pépinié-
ristes, représentants de fédérations, paysagistes, orga-
nismes publics, parapublics et scientifiques. Les princi-
paux axes d'action sont d'éviter l'introduction et la
commercialisation d'espèces invasives.
Solutions et discussion
Solutions et discussionSolutions et discussion
Solutions et discussion
Promesses et limites des outils de prévision du risque
Promesses et limites des outils de prévision du risque Promesses et limites des outils de prévision du risque
Promesses et limites des outils de prévision du risque
lié à l'introduction
lié à l'introductionlié à l'introduction
lié à l'introduction
L'ARP est un outil plus généraliste que le WRA.
Destinée initialement à évaluer le risque lié à l'intro-
duction des organismes nuisibles aux plantes, l'ARP a
récemment été modifié pour évaluer également le ris-
que lié à l'introduction de plantes. Elle se différencie
du WRA par le fait qu'elle n'est pas conçue unique-
ment pour les espèces végétales et qu'elle est à la base
d'accords réglementaires et de prises de mesures phy-
tosanitaires. C'est également un outil plus lourd à utili-
sé que le WRA en terme de temps.
Le WRA est spécifiquement adapté à l'évaluation du
risque d'introduction de plantes et plus particulière-
ment des espèces ornementales. Décliné en plusieurs
modèles, il est un outil relativement rapide et facile
d'utilisation. L'évaluation d'une espèce végétale sur un
WRA est réalisée en une ou deux journées.
La bibliographie traite régulièrement de la notion
d'incertitude liée à l'utilisation de modèles prédictifs en
raison de l'insuffisance d'informations sur une espèce.
Cette incertitude est prise en compte dans la pondéra-
tion des questions du modèle australien notamment.
Les aspects liés à la difficulté de prévoir de manière
précise l'avenir de chaque introduction dans un envi-
ronnement complexe (10] et la subjectivité de l'évalua-
teur sont également cités.
Les modèles australien [5] et nord-américain [7] sont
les plus utilisés comme référence scientifique. Ils don-
nent des résultats très prometteurs lorsqu'ils sont
adaptés à d'autres régions du monde. Enfin, ils permet-
tent une meilleure compréhension des mécanismes des
invasions biologiques.
Plante de jardin idéale
Plante envahissante
Multiplication aisée
Germination importante
Multiplication végétative
Etablissement rapide
Colonisation rapide
Acclimatation aisée
Aire d'acclimatation similaire
à la zone climatique d'origine
Faibles besoins hydriques
Photosynthèse de type C4 ou
CAM
Obtention rapide d'un plant commer-
cialisable
Croissance rapide
Maturité précoce
Période juvénile courte
Floraison abondante, de longue
durée, continue ou
fréquente
Production importante de
semences
Intervalles courts entre les
productions de graines
Tolérance aux prédateurs et maladies
Peu de prédateurs naturels sur
le lieu d'introduction
Hybridation facile
Hybridation entre espèces
Réussite commerciale
Etendue des plantations
WWW.SNHF.ORG
WWW.SNHF.ORGWWW.SNHF.ORG
WWW.SNHF.ORG

Utilité de ces outils : la recommandation d'espèces de
Utilité de ces outils : la recommandation d'espèces de Utilité de ces outils : la recommandation d'espèces de
Utilité de ces outils : la recommandation d'espèces de
substitution
substitutionsubstitution
substitution
A la suite des premières réunions du groupe de travail,
un document de sensibilisation fut édité en 2003 [1]
(www.ame-lr.org/plantes-envahissantes). En 2004, un
nouveau projet fut mis en place, toujours avec les pro-
fessionnels de l'horticulture et du paysage, mettant en
avant les plantes de substitution.
Le concept de plantes de substitution ou alternatives a
été développé dans plusieurs pays (Canada, Afrique du
Sud, Nouvelle Zélande, Etats-Unis). Que ce soit en
Afrique du Sud, en Nouvelle Zélande où un guide est
proposé pour remplacer les pestes les plus communes
dans les plantations [11], ou encore aux Etats-Unis où un
plan national a été mis en place assorti d'initiatives ré-
gionales, les plantes de substitution sont un concept
utilisé et reconnu [2].
Le CBNMP a intégré les remarques formulées par le
groupe de travail afin d'adopter une définition des
espè-
ces de substitution
. Ces remarques sont les suivantes :
(i) Les plantes présentées doivent avoir une attitude
similaire à la plante envahissante considérée, c'est-à-dire
une dimension, une forme, une couleur, un feuillage,
une oraison, une fonction concordant le plus possible à
celle-ci. (ii) Elles doivent répondre à la nécessité d'éviter
d'introduire de nouvelles espèces, et de préférer la flore
indigène ou des espèces introduites depuis suffisamment
longtemps pour être maîtrisées. Est alors considérée
comme
espèce de substitution, la plante qui ressemble
morphologiquement à la plante envahissante, qui croît à
peu près dans les mêmes conditions agronomiques et
que l'on peut utiliser pour les mêmes fins. Ces plantes
de substitution sont indigènes ou exotiques non enva-
hissantes. Elles sont dans la mesure du possible déjà
commercialisées ou alors leur cycle de production est
connu
. Les plantes sauvages autochtones sont une alter-
native particulièrement intéressante car elles sont les
mieux adaptées au climat méditerranéen.
La biologie et l'écologie des espèces recommandées
font l'objet de recherches bibliographiques afin de s'as-
surer qu'il ne s'agit pas d'espèces envahissantes ailleurs
dans le monde.
Pour l'instant, il s'agit d'un s
creening-system
qui
consiste à vérifier que ces plantes ne possèdent pas de
caractéristiques évidentes d'invasives. Néanmoins, il
apparaît qu'un WRA serait utile pour identifier les es-
pèces potentiellement invasives absentes du territoire,
et pour justifier la recommandation d'espèces de substi-
tution. Des plantes de substitution ont été proposées
pour une quarantaine de plantes invasives en Méditerra-
née et confirmées par les professionnels de l'horti-
culture et du paysage afin qu'elles soient en accord avec
la réalité du marché horticole.
Conclusion
ConclusionConclusion
Conclusion
Les consommateurs manifestent une double attente
pour des produits végétaux respectueux des règles éthi-
ques et écologiques. En parallèle, les pourvoyeurs de
plantes innovantes émettent la demande d'outils per-
mettant d'identifier les espèces envahissantes.
L'application des modèles de type WRA est une al-
ternative intéressante : elle permet d'éviter des espèces
qui ont suscité des dégâts importants sous des climats
similaires et de recommander à l'inverse des espèces
qui ont moins de risque de devenir envahissantes.
La proposition d'espèces de substitution permet éga-
lement d'aborder le concept des plantes envahissantes
d'origine horticole, de façon positive et donc plus se-
reine, en évitant de diaboliser les personnes impliquées.
Elle permet de définir de façon claire l'emploi des plan-
tes incriminées, et de trouver des solutions pouvant
être équivalentes sur le plan esthétique, mais d'un plus
grand intérêt sur le plan de la conservation des milieux
[4].
Bibliographie
BibliographieBibliographie
Bibliographie
[1] AME and ARE.
Plantes envahissantes de la région
méditerranéenne
. Agence Méditerranéenne de l'Envi-
ronnement - Région Languedoc-Roussillon, Agence
Régionale pour l'Environnement Provence-Alpes-Côte
d'Azur, 2003.
[2] S. Brunel, editor.
Invasive plants in Mediterranean
type regions of the world
- Mèze (France), 25-27 mai.
Council of Europe publishing, 2005.
[3] Q. C. B. Cronck and J. L. Fuller.
Plant invaders :
the threats to natural ecosystems.
Springer, 1995.
[4] I. Mandon-Dalger, F. Brot, and N. Borel. Impliquer
la filière horticole dans la lutte contre les espèces enva-
hissantes. In MNHM, editor,
Espèces exotiques enva-
hissantes : une menace majeure pour la biodiversité -
13e forum des gestionnaires
- Paris -16 mars 2007, 2007.
[5] P. C. Pheloung, P. A. Williams, and S. R. Halloy. A
weed risk assessment model for use as a biosecurity
tool evaluating plant introductions.
Journal of Envi-
ronmental Management
, 57 :239{247, 1999.
[6] D. Pimentel, L. Lach, R. Zuniga, and D. Morrison.
Environmental and economic costs associated with
non-indigenous species in the united states. Technical
report, College of Agriculture and Life Sciences, Cor-
nell University, Ithaca, NY, 1999.
[7] S. H. Reichard and C. W. Hamilton. Predicting
invasions of woody plants introduced into north ameri-
ca.
Conservation Biology
, 11(1) :193{203, February 1997.
[8] D. M. Richardson, P. Pysek, M. Rejmanek, M. G.
Barber, F. D. Panetta, F. Dane, and C. West. Naturali-
zation and invasion of alien plants : concepts and defi-
nitions
. Diversity
and distributions
, 6 :93{107, 2000.

[9] J. Roy. In search of the characteristics of plant inva-
ders. In A. J. Castri (Di) and M. Debussche, editors,
Biological invasions in Europe and the Mediterranean
Basin
, pages 335-352. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, 1990.
[10] J. L. Ruesink, I. M. Parker, M. J. Groom, and P.
M. Kareiva. Reducing the risks of non-indigenous spe-
cies introductions.
BioScience
, 45(7), 1995. 59.
[11] L. Vervoort and S. Trueman. Friendly alternati-
ves : Plants to use in place of common plant pests,
1998.
[12] P. M. Vitousek, C. M. Dantonio, and L. L. Loope.
Biological invasions as global environmental change.
American Scientist
, 84 :468{478, 1996.
[13] E. F. Weber. The alien flora of europe : a taxono-
WWW.SNHF.ORG
WWW.SNHF.ORGWWW.SNHF.ORG
WWW.SNHF.ORG
mic and biogeographic review.
Journal
of Vegetation Science
, 8 :565-572, 1997.
[14] M. Williamson.
Biological invasions
. Chapman
& Hall, Londres, 1996.
Impatiens glandulifera
Lythrum salicaria (répertoriée envahissante aux
U.S.A.)
Robinia pseudoacacia
Source : Gérer la biodiversité végétale au jardin.
10
e
colloque scientifique de la SNHF. 30 mai 2008
1
/
4
100%