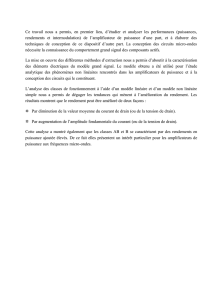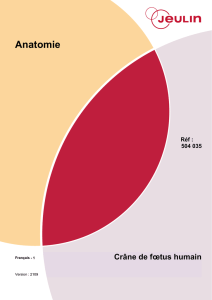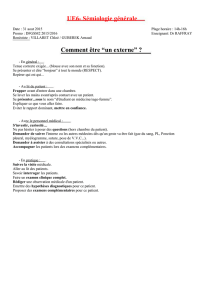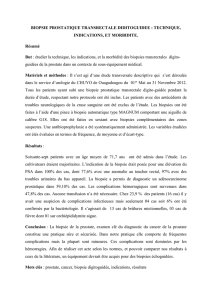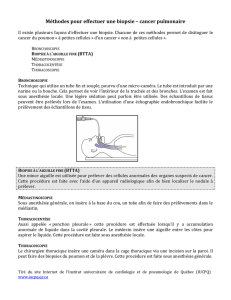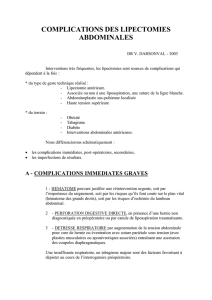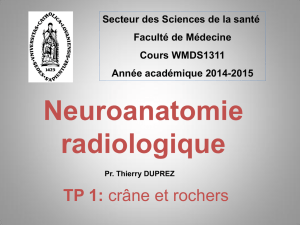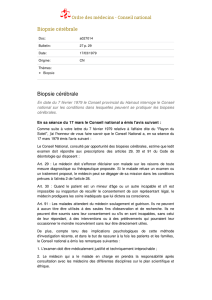s. etchepareborde

1
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
PROGRAMME GÉNÉRAL CHIRURGIE
pour le drainage abdominal. Ces systèmes ont
peu à peu rendu obsolète le drainage abdomi-
nal ouvert.
Les récipients de collectes sont divers en
termes de taille et de design et fonctionne-
ment tous par dépression mécanique. Ils sont
à usage unique mais un système de vidange
permet d’évacuer le liquide collecté et de res-
taurer la dépression pour un même patient.
• Drain de Penrose et mèches : drains passifs
– non utilisé pour le drainage abdominal en
médecine vétérinaire.
• Drain de Redon : le drain est tubulaire et
multiperforé. Il est en caoutchouc ou plus
souvent en silicone. Il peut arriver monté sur
une aiguille de gros diamètre favorisant son
implantation.
• Drain de Jackson Pratt : le drain est plat et
multifenestré. Il est en caoutchouc ou plus
souvent en silicone.
• Drain de Blake : le drain est plat ou circulaire.
Il comporte une tubulaire centrale d’aspiration
et une tubulaire externe avec de multiples
prises d’air. Sa conception est particulière-
ment adaptée au drainage abdominal, limitant
grandement le risque d’occlusion par aspira-
tion des organes abdominaux.
Pour tous ces systèmes l’aspiration n’est pas
réglable et diminue au fur et à mesure que
le récipient de collecte se remplit. Il convient
alors de surveiller régulièrement la production
et de refaire le vide dès que la pression devient
insuffisante.
• Vacuum-assisted closure (VAC) : ce sys-
tème est beaucoup plus onéreux mais il per-
met le maintien constant de la dépression
désirée. Il ne correspond pas vraiment à l’idée
que l’on se fait d’un drain abdominal et se rap-
proche plus d’une gestion de type « drainage
abdominal ouvert » actif et en circuit fermé.
Deux études sur 6 (Buote N., JAAHA, 2012)
et 8 cas (Cioffi K. et al., JVECC, 2012) ont été
rapportées récemment chez le chien et le chat
avec des succès de 50% et 37,5% seulement.
Quand utiliser un drain abdominal ?
Le drainage abdominal peut avoir un rôle
thérapeutique ou bien un rôle prophylac-
tique. Ainsi, il est fortement recommandé par
exemple de mettre en place un drain abdomi-
nal aspiratif lors de gestion d’une péritonite
septique. Il est néanmoins capital de traiter
la source infectieuse dans un premier temps.
Une étude de 2001 (Mueller et al., JAVMA)
ainsi qu’une plus récente (Adams et al, Vet
Surg, 2014) rapportent l’emploi de drainage
abdominal dans cette situation avec des taux
de survie de 70% et 85% respectivement. Il
est également possible dans cette situation de
les utiliser pour la réalisation de lavages abdo-
minaux.
Dans le cadre prophylactique, la mise en place
d’un drain abdominal est un bon moyen de
surveiller l’apparition d’une éventuelle déhis-
cence après une entérotomie/entérectomie
ou autre chirurgie ayant pour complication
potentielle l’apparition d’une péritonite. En
effet, la présence d’un drain abdominal per-
mettra aussi rapidement que possible d’iden-
tifier une production de liquide anormale à la
fois en terme de quantité mais aussi de qualité
macroscopique et microscopique sans avoir
besoin de recourir à une ponction échoguidée
par exemple.
L’inconvénient principal du drain abdominal
est sa gestion postopératoire qui implique une
hospitalisation prolongée. Les complications
associées aux drains aspiratifs restent, dans la
grand majorité des cas, mineures : retrait pré-
maturé, fracture du drain, obstruction (cail-
lot sanguin, omentum, dépôt de fibrine…) et
infection locale sur le site d’entrée. Des com-
plications associées à l’affection traitée sont
également rapportées telles qu’une anémie
ou une hypoprotéinémie par exemple.
Quels sont les drains disponibles ?
Deux types principaux de drains existent : les
drains actifs et les drains passifs. En médecine
vétérinaire, seuls les drains actifs et donc en
système fermé ont été décrits et sont utilisés
Comment poser un drain abdominal ?
Technique chirurgicale
Le drain abdominal doit être posé chirurgi-
calement. Cela est renforcé par le fait qu’une
cœliotomie est dans la grande majorité des
cas nécessaire dans le traitement de la cause
primaire de la péritonite, qu’elle soit infec-
tieuse, chimique ou urinaire.
La mise en place du drain abdominal peut
se faire à gauche ou à droite, dans la partie
craniale, moyenne ou caudale de l’abdomen
mais doit toujours être décalée de quelques
centimètres de la ligne blanche. Le drain ne
doit jamais être mis en place via une plaie de
laparotomie.
Alors que la paroi abdominale est maintenue
par une pince atraumatique, un clamp hémos-
tatique est utilisé, mords fermés, depuis la face
péritonéale de la paroi abdominale pour faire
un point de pression et représenter le futur
point de sortie cutané du drain. Une incision
punctiforme cutanée, sous cutanée et muscu-
laire est alors réalisée à l’aide d’une lame de 11
(technique de ponction). L’extrémité du clamp
est alors extériorisée. La réalisation d’un tun-
nel sous cutané n’est pas indispensable pour
une bonne étanchéité mais peut être réalisée
pour plus de sécurité. Dans ce cas, la ponction
de la paroi musculaire et des tissus cutanés/
sous cutanés doit être refaite en 2 temps.
Un second clamp hémostatique remplace
le premier en empruntant le chemin inverse
depuis la peau vers la cavité abdominale. Cela
permet un passage du drain depuis l’intérieur
vers l’extérieur et limite l’agrandissement
accidentel du trajet par le passage de la par-
tie abdominale du drain, souvent plus large
(cas des drains de Blake ou de Jackson Pratt
notamment). L’extrémité « externe » du drain
est alors tenue par le clamp hémostatique et
extériorisée, laissant l’extrémité drainante
dans la cavité abdominale, à l’endroit voulu.
Dans la plupart des cas un drainage général
de la cavité abdominale est nécessaire et le
drain est alors laissé ventralement en position
médiane.
Savoir-Faire du GEC
Savoir poser un drain abdominal – Savoir quel drain utiliser
Alexandre CARON
DV, MRCVS, Dip. ECVS
Centre hospitalier vétérinaire Atlantia - 22 rue René Viviani - 44200 NANTES

2
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
Une omentectomie ou une omentopexie peut
être réalisée afin de limiter le risque d’occlu-
sion du drain. La seconde est toujours préfé-
rée afin de préserver l’omentum, source non
négligeable de vascularisation et d’absorption
dans la cavité péritonéale. Cette procédure
n’est cependant pas requise lors d’emploi de
drains abdominaux adaptés de type Blake ou
Jackson Pratt (cf. ci-dessus), spécialement
conçus pour limiter le risque d’adhérence
organique.
Le drain peut enfin être fixé à la peau par une
suture en bourse (pas trop serrée !) puis un
nœud en lacet chinois sur quelques centi-
mètres. Le système collecteur peut alors être
mis en place et la dépression enclenchée. En
cas de fuite, il faut immédiatement traiter le
problème : au niveau du système ou du trajet
musculaire-sous cutané – cutané.
Quand le retirer ?
Aucune valeur chiffrée n’est utilisée dans
la décision de retrait du drain. Trois critères
doivent alors être réunis : une amélioration
clinique significative du patient (et éventuel-
lement échographique), une diminution pro-
gressive de la production de fluide par le drain
et une absence de polynucléaires neutrophiles
et de bactéries lors d’examen cytologique du
liquide recueilli.
Pour le retrait, la suture maintenant le drain en
place est sectionné puis le retrait est simple-
ment effectué par traction délicate. La plaie
n’est pas suturée et cicatrisera par seconde
intention.
Déclaration publique d’intérêts sous la
responsabilité du ou des auteurs :
•Aucun conflit d'intérêt

3
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
PROGRAMME GÉNÉRAL CHIRURGIE
jours. Cela signifie que durant les premières
semaines après l’incision, la résistance de la
paroi abdominale est liée à la résistance du
fil utilisé. Le catgut perd 100 % de sa résis-
tance en 2 à 3 semaines ; le polyglecapron 25
(monocryl®, surgicryl monofast®) perd 80%
de sa résistance sur cette même période et
l’acide polyglycolique (safil®, surgicryl pga ®,
dexon®) et le polyglactin 910 (Vicryl®, Novo-
syn®, polysorb®) perdent eux 50 % de leur
résistance. Cette rapide perte de résistance
est donc un facteur limitant à l’utilisation de
ces fils pour la suture de la paroi abdominale.
Le polyglyconate (Monosyn®, Maxon®), le
glycomer 631 (Byosin®) et le polydioxanone
(PDS®) perdent respectivement 30 %, 25 %
et 15% de leur résistance initiale durant les 2
à 3 premières semaines et gardent encore plus
de 50% de leur résistance à 5 et 6 semaines.
On privilégiera donc un fil monofilament à
résorption lente (3).
Dans certaines situations très rares, le monofi-
lament à résorption lente devra être remplacé
par un monofilament non résorbable : concrè-
tement, lorsqu’une cicatrisation prolongée est
attendue (infection de la paroi abdominale et
hypoprotéinémie principalement).
Quelle aiguille utiliser ?
Le seul avantage des aiguilles à chas et donc
des bobines de fils est le coût plus faible. Au
delà du fait que le fil des bobines, s’il n’est pas
stocké de manière convenable, peut s’altérer
avant même son utilisation, les aiguilles à
chas sont plus traumatiques que les fils mon-
tés. Le diamètre de l’aiguille est beaucoup plus
important que le fil et par définition, le fil est
doublé au niveau du chas créant donc une
brèche dans le tissu deux fois plus grande que
nécessaire. Se pose aussi le problème de la
stérilité de l’aiguille ainsi que son émoussage
avec le temps.
Deux critères sont à prendre en compte : la
taille et la forme (ronde ou triangulaire). La
taille de l’aiguille ainsi que son ouverture sont
souvent inhérentes à la suture choisie et à la
taille de la suture. La courbure de l’aiguille est
indiquée par la proportion d’un cercle qu’elle
représente (3/8, ½, 5/8). La taille de l’aiguille
En médecine humaine, la complication de her-
nie incisionnelle est décrite jusque dans 11%
des cas (1). Cette complication, même chez
l’homme, n’est donc pas rare et nous devons
assumer le fait que, parfois, il nous arrive aussi
d’avoir des déhiscences de plaie. Si ces déhis-
cences peuvent être le fait d’un animal qui
s’est arraché ses sutures, dans les cas les plus
fréquents cela est dû à une erreur technique
durant la suture de la paroi abdominale.
Les questions soulevées lors de fermeture de
la paroi abdominale sont diverses :
Quel fil utiliser ? / Quelle taille de fil utiliser?
/ Quel type de suture ? / Quels nœuds ? /
Quelles structures incorporer dans ses su-
tures ? / Comment suturer ?
Quel fil utiliser ?
Un petit aparté sur l’utilisation du polyglactin
910 (fil à résorption rapide tressé). Il est en-
core communément répandu d’utiliser ce type
de fil pour la fermeture abdominale : pour des
raisons de coût et de sécurité du nœud. Les
fils tressés sont traumatiques pour les tissus
et forment des interstices nombreux dans les-
quels peuvent se loger des bactéries. L’argu-
ment du coût n’est donc pas valable car ces
fils seront associés à un nombre plus grand
de complications, dont la reprise est rarement
facturée au propriétaire ; donc in fine une perte
d’argent outrepassant largement le faible gain
économisé par le prix seul de la suture. L’argu-
ment de la sécurité du nœud peut être valable
pour une ligature mais ne tient pas pour une
suture. Tout chirurgien se doit de savoir réali-
ser correctement un nœud afin qu’il ne glisse
pas (exemple : privilégier un nœud carré plu-
tôt qu’un nœud de vache (granny knot)).
De même, l’utilisation du Catgut n’est plus
recommandée. Ce matériau entraine une ré-
action inflammatoire importante et sa résorp-
tion est rapide et imprédictible (2). Ce type de
fil se vend en bobine et implique donc l’utilisa-
tion d’une aiguille à chas, traumatique pour les
tissus (Cf ci-dessous).
Pour la suture de la ligne blanche on utilise
donc un fil monofilament.
La résistance d’un fascia après incision est de
20% de sa résistance initiale au bout de 20
indiquée sur la boite correspond à la longueur
de l’arc décrit par l’aiguille, de sa pointe à la
jonction avec le fil. Lorsqu’il est possible de
choisir, c’est plus une question de choix per-
sonnel en fonction du confort d’utilisation. La
forme de l’aiguille est en revanche de toute
importance. L’aiguille ronde est peu trauma-
tique et ne déchire pas les tissus. Elle est donc
l’aiguille de choix pour tous les viscères. En
revanche, dès que le tissu à suturer devient
plus riche en collagène (tendon, ligne blanche,
peau), il peut être difficile de passer à travers
avec une aiguille ronde et on préfèrera alors
une aiguille triangulaire. Les aiguilles trian-
gulaires les plus utilisées sont dites « reverse
cutting ». La différence entre les aiguilles
triangulaires « cutting » et « reverse cutting
» tient à l’orientation du triangle formé par
la section de l’aiguille. Pour ces dernières, la
base du triangle est orientée vers l’intérieur de
la courbure de l’aiguille. De ce fait, le danger
de couper à travers les tissus avec l’aiguille
est nettement diminué et le trou formé par
l’aiguille forme une large portion de tissu sur
laquelle vient s’appuyer la suture.
Quelle taille de fil utiliser ?
Dans une étude humaine récente, 88 % des
hernies incisionnelles présentaient des su-
tures intactes qui étaient passées à travers
les tissus pris dans la suture. Le facteur le plus
important est donc la nature et la quantité des
tissus pris dans la suture (Cf ci-dessous) plu-
tôt que son diamètre qui n’est que rarement le
facteur limitant. Il n’existe pas d’étude scien-
tifique précisant la taille des fils à utiliser, les
valeurs suivantes sont donc issus de l’expé-
rience : pour un animal de moins de 5kg, un fil
de 3/0 (décimale 2) est suffisant. On utilisera
du 2/0 (décimale 3) pour des chiens entre 5
et 20kg et du 9 (décimale 4) pour des chiens
d’un gabarit supérieur.
L’inconvénient d’un fil trop fin est unique et
concerne bien sûr une résistance trop faible.
D’un autre côté, les inconvénients d’utiliser un
fil trop gros sont multiples : il tient moins bien
le nœud, le volume du nœud ainsi que de la
quantité de « corps étranger » laissé in situ est
bien plus importante et les dégâts tissulaires
sont proportionnels à la taille du fil utilisé.
Savoir-Faire du GEC
Comment refermer une cavité abdominale
Sébastien ETCHEPAREBORDE
DV, PhD, DESV chirurgie des petits animaux, Dip. ECVS
CHV des Cordeliers - 29 avenue du Maréchal Joffre - F-77100 MEAUX

4
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
Quel type de suture utiliser ?
Encore une fois, le type de suture n’est rien en
regard des tissus pris par cette suture. Il n’y a
donc aucune différence en termes de compli-
cations, quel que soit le type de suture utilisé.
En conséquent, l’utilisation de points séparés
dans un contexte normal n’entraîne aucune
plus-value mais est associée avec un temps
chirurgical plus long que pour la réalisation
d’un surjet.
Le type de suture recommandé est donc un
surjet simple dans quasi toutes les situations
(4).
Dans le cas rare où la viabilité des tissus à
suturer est questionnable, les points séparés
sont à privilégier.
En accord avec ce qui vient d’être mentionnée,
il n’est donc nullement nécessaire de doubler
son surjet par quelques points simples le long
de l’incision. Cette pratique, non seulement
n’apporte rien, mais peut entrainer la section
du surjet par le passage de l’aiguille, respon-
sable d’une déhiscence future. Pour les prati-
ciens désireux néanmoins de réaliser un surjet
plus quelques points simples, il est recom-
mandé de réaliser les points simples AVANT
le surjet.
Quels nœuds réaliser
aux extrémités du surjet ?
Le nœud simple est la base de nombreux
nœuds en chirurgie et il est le seul à utiliser
pour toutes sutures. Pour les ligatures, cela est
légèrement différent car le premier nœud est
un nœud de chirurgien. Ce type de nœud est
réservé aux LIGATURES et n’a aucun intérêt
pour les sutures. Le nœud carré (deux nœuds
simples) tient mieux que le nœud de chirur-
gien. On veillera également à bien croiser ses
brins lors de la réalisation du nœud carré sous
peine d’obtenir un nœud de vache (granny
knot) qui tient bien moins que le nœud carré.
Pour un point simple, il est admis que trois
nœuds simples sont suffisants (5). Pour le
commencement d’un surjet un nœud simple
supplémentaire (soit quatre au total) est re-
commandé et cinq pour le terminer. En effet,
la fin du surjet se réalise entre le brin libre et
une boucle (donc trois fils) et ceci explique
que la tenue du nœud est moindre que celle
du nœud de départ et nécessite donc la réa-
lisation d’un nœud simple supplémentaire. Il
a été démontré que le fil de polydioxanone
nécessite sept nœuds simples pour une tenue
optimale. Afin d’éviter toute confusion, et
comme qui peut le plus peut le moins, il est
recommandé de faire sept nœuds au com-
mencement et à la fin du surjet.
Quels tissus incorporer dans la
suture ?
La ligne blanche est une aponévrose
(=connexion muscle-muscle, la connexion
muscle-os étant un tendon et la connexion os-
os étant un ligament) composée des fascias
de part et d’autre des muscles transverses,
oblique interne et oblique externe (de l’inté-
rieur vers l’extérieur). Les muscles droits de
l’abdomen, longitudinaux à la ligne blanche
se situent très proches de la ligne médiane et
entre ces fascias. Enfin, l’intérieur de la paroi
abdominale est tapissé par le péritoine. La dis-
position des fascias des muscles transverse,
oblique interne et oblique externe varie au fur
et à mesure que l’on progresse caudalement
le long de la ligne blanche. Crânialement, le
muscle droit de l’abdomen est entouré par le
fascia du muscle oblique interne qui se divise:
une épaisseur de fascia composée du fascia
du muscle oblique externe et de la partie su-
perficielle du fascia du muscle oblique interne
au- dessus, et le fascia du muscle transverse
et la partie profonde du fascia du muscle
oblique interne en-dessous. Caudalement à
l’ombilic, le fascia du muscle oblique interne
se joint au fascia du muscle oblique externe
pour recouvrir le muscle droit de l’abdomen
laissant seul le fascia du muscle transverse en
profondeur. Dans la partie la plus caudale de
la ligne blanche, les fascias des trois muscles
se joignent et recouvrent superficiellement le
muscle droit de l’abdomen, seulement recou-
vert du péritoine en profondeur.
L’image d’une viande qui fond dans la bouche
illustre parfaitement le fait que le muscle n’est
pas une structure résistante et qu’il n’y a donc
aucun intérêt à incorporer le muscle droit de
l’abdomen dans la suture.
La question de la suture du péritoine reste
légitime. En humaine, les raisons (non fon-
dées) avancées pour justifier la suture du pé-
ritoine incluent la restauration de l’anatomie,
la réduction des infections en rétablissant
une barrière anatomique, une diminution des
déhiscences, une réduction des hémorragies,
diminution des adhérences et perpétuation
d’une technique considérée comme un stan-
dard. Des études anciennes ont prouvé qu’il
n’y avait aucun intérêt quant à la résistance de
la fermeture d’incorporer le péritoine. Le péri-
toine a des propriétés anti-adhérence et le fait
de le suturer pourrait créer une ischémie non
seulement responsable d’une réaction inflam-
matoire mais l’empêchant également de jouer
son rôle anti-adhérence. Cela pourrait favori-
ser la formation d’adhérences dans l’abdomen
en plus du potentiel rôle joué par la suture en
tant que corps étranger. La formation d’adhé-
rence est une complication importante chez
l’homme et chez le cheval, responsable de
gêne ou de malfonction de certains organes.
Aucune étude ne reporte l’effet pathologique
d’adhérence chez le chien. Par ailleurs, les
méta-analyses les plus récentes en humaine
(2014) ne permettent pas de mettre en évi-
dence de différence de formation d’adhérence
en fonction que le péritoine soit suturé ou non
(6,7). En résumé, à ce jour, il n’y a aucune évi-
dence justifiant la suture ou non du péritoine.
En conséquence, chez le chien et le chat, il n’y
a pas d’intérêt à tenter de l’incorporer dans la
suture ni à faire l’effort de l’éviter si celui-ci est
toujours adhérent à la ligne blanche lors de la
fermeture.
C’est donc bien le fascia qui doit être incor-
poré dans la suture de la ligne blanche. Le fas-
cia superficiel au muscle droit de l’abdomen
est suffisant pour assurer une bonne résis-
tance (8). Il n’est pas nécessaire comme nous
l’avons vu au-dessus d’incorporer ce muscle.
En revanche, les études montrent clairement
que la résistance de la fermeture est double
si la suture incorpore le fascia latéralement à
la transition muscle droit-ligne blanche com-
paré à médialement à cette transition (9).
Dans le doute, on préférera incorporer un peu
de muscle droit de l’abdomen dans la suture
plutôt que vouloir l’épargner et prendre trop
peu de fascia.
Lors de l’ouverture de la paroi abdominale, il
n’est pas nécessaire de décoller le tissu sous
cutané de la ligne blanche : cela crée des
espaces morts propices à la formation de sé-
romes. De ce fait, il est parfois difficile lors de
la fermeture d’identifier la ligne blanche, mas-
quée par le tissu adipeux. Dans ce cas, il ne
faudra pas hésiter à dégager le tissu sous cu-
tané sur une largeur de quelques millimètres
pour bien identifier la ligne blanche et ne pas
incorporer uniquement du tissu sous cutané
dans la suture.
Bibliographie :
1) Mudge M, Hughes LE. Incisional hernia : a 10 years
prospective study of incidence and attitudes. Br J Surg.
1985; 72 : 70-71.
2) Alexander HC, Prudden JF. The causes of abdomi-
nal wound disruption. Surg Gynecol Obstet. 1966 ;
122: 1223-1231.
3) Ceydeli A et coll. Finding the best abdominal clo-
sure : an evidence-based review of the literature. Curr
Surg. 2005 ; 62 : 220-225.

5
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
4) Van’t Riet M et coll. Meta-analysis of techniques
for closure of midline abdominal incisions. Br J Surg.
2002; 89 : 1350-1356.
5) Rosin E, Robinson GM. Knot security of suture ma-
terials. Vet Surg. 1989 ; 18:269-273.
6) Bamigboye AA, Hofmeyr GJ. Closure versus non-
closure of the peritoneum at caesarean section : short-
and long-term outcomes (review). The cochrane col-
laboration. 2014 ; 8 :1-80.
7) Gurusamy KS et coll. Peritoneal closure versus no
peritoneal closure for patients undergoing non-obs-
tetric abdominal operations. Cochrane database syst
rev. 2013 ; Jul 4 : 7 :CD010424.
8) Rosin E, Richardson S. Effect of fascial closure tech-
nique on strength of healing abdominal incision in the
dog : a biomechanical study. Vet surg. 1987 ; 16 : 269-
272.
9) Tera H, Nberg C. Tissue strength of structures in-
volved in musculo-aponeurotic layer sutures in lapa-
rotomy incisions. Acta Chir Scand. 1976 ; 142 : 349.
Déclaration publique d’intérêts sous la
responsabilité du ou des auteurs :
•Aucun conflit d'intérêt
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%