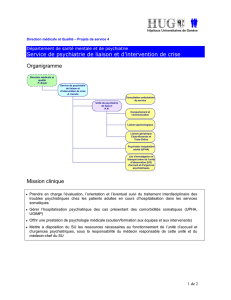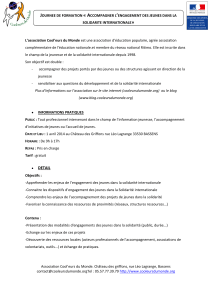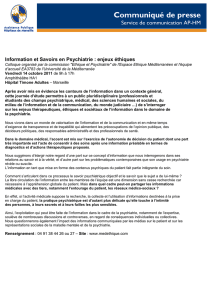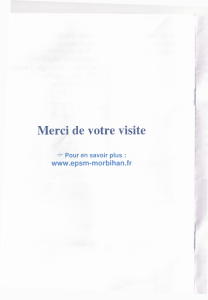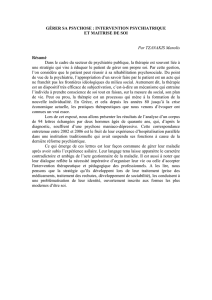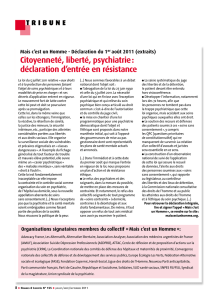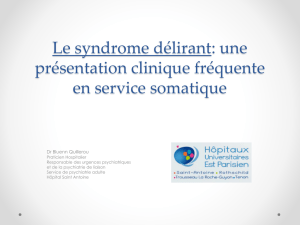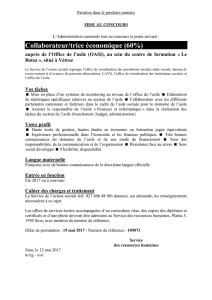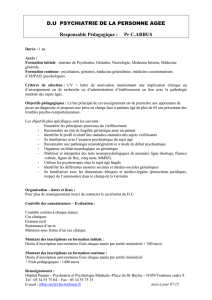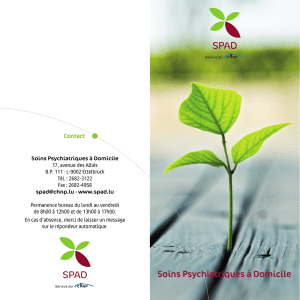De l`asile à la politique de secteur : l`évolution des institutions et des

L’Information psychiatrique 2012 ; 88 : 759–70
HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE
De l’asile à la politique de secteur : l’évolution
des institutions et des soins psychiatriques
à Bassens*
Henri Vermorel, Madeleine Vermorel
RÉSUMÉ
Écrit à l’occasion du 150eanniversaire du CHS de Bassens, cet article retrace la création de l’asile dans la suite des
idées des Lumières puis sa dégradation progressive à la fin du xixesiècle et au début du xxeavant que ne se dessine un
renouveau s’exprimant dans les réformes de 1936, bientôt emportées par la guerre qui entraîne en France la mort de dizaines
de milliers de patients. La seconde révolution psychiatrique qui s’appuie, avec la psychothérapie institutionnelle, sur un
changement des mentalités, est favorisée par l’essor économique du pays après la Libération, l’introduction des idées de
la psychanalyse et la découverte de nouveaux médicaments. La politique de secteur a connu à Bassens un développement
précoce et exemplaire. La période actuelle, marquée par des difficultés économiques, est confrontée à la crise de la société
comme à celle de la psychiatrie.
Mots clés : histoire de la psychiatrie, hôpital psychiatrique, sectorisation psychiatrique, psychothérapie institutionnelle,
centre hospitalier de Bassens
ABSTRACT
From the asylum to sector policy: the evolution of institutions and psychiatric care at Bassens Hospital. Written
on the occasion of the 150th anniversary of the Bassens Central Specialized Hospital, this article traces the creation of
the asylum based on the ideas of the Enlightenment and then its gradual decline in the late 19th and early 20th centuries.
The article continues up to the renewal of its policy mirrored in the reforms of 1936, which was soon swept away by
the war in France, resulting in the death of tens of thousands of patients. The second psychiatric revolution which was
built on institutional psychotherapy, produced a change of mentality, bolstered by the country’s economic boom after the
Liberation. This included the introduction of the ideas of psychoanalysis as well as the discovery of new drugs. During
this period, Bassens Central Specialized Hospital experienced an early and exemplary development. The current situation,
confronted by economic difficulties, is facing a society crisis as in the case of psychiatry.
Key words: history of psychiatry, psychiatric hospital, psychiatric sectorization, institutional psychotherapy, Bassens
hospital
Les Capucins, 7, rue Jules-Ferry, 73000 Chambéry
∗Une première version de ce texte a été présentée lors d’un colloque
pour le 150eanniversaire de cette institution, le 19 septembre 2008 (De
l’asile de Bassens au centre hospitalier spécialisé de la Savoie).
Tirés à part : H. Vermorel
doi:10.1684/ipe.2012.0983
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 759
Pour citer cet article : Vermorel H, Vermorel M. De l’asile à la politique de secteur : l’évolution des institutions et des soins psychiatriques à Bassens. L’Information
psychiatrique 2012 ; 88 : 759-70 doi:10.1684/ipe.2012.0983
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

H. Vermorel, M. Vermorel
RESUMEN
Del asilo a la política del sector : la evolución de las instituciones y de los cuidados psiquiátricos en Bassens. Escrito
con ocasión del 150 aniversario del CHS de Bassens, este artículo rese˜
na la creación del asilo en la estela de las ideas de
la Ilustración, luego su progresiva degradación al final del siglo XIX y a principios del XX antes de que se dise˜
nara un
renacer plasmado en las reformas de 1936, que pronto iba a llevarse la guerra de la que se deriva en Francia la muerte
de decenas de miles de pacientes. La secunda revolución psiquiátrica que se apoya, con la psicoterapia institucional, en
un cambio de mentalidades, se ve favorecida por una bonanza económica del país tras la Libération, la introducción de
las ideas del psicoanálisis y el descubrimiento de nuevos medicamentos. La política del sector ha conocido en Bassens
un desarrollo precoz y ejemplar. El periodo actual, marcado por dificultades económicas, se enfrenta con la crisis de la
sociedad como a la de la psiquiatría.
Palabras claves : historia de la psiquiatría, hospital psiquiátrico, sectorización psiquiátrica, psicoterapia institucional,
centro hospitalario de Bassens
« C’est pour les hommes chez qui réside cette sensibilité
sympathisante aux maux d’autrui que j’ai composé cet
écrit. »
(Joseph Daquin, La Philosophie de la folie, 1791.)
« Je les ai vus, grossièrement nourris, privés d’air pour
respirer, d’eau pour étancher leur soif et des choses les
plus nécessaires à la vie. Je les ai vus n’ayant que de la
paille pour se garantir de la froide humidité du pavé sur
lequel ils sont étendus. Je les ai vus livrés à de véritables
geôliers, abandonnés à leur brutale surveillance [...]Je
les ai vus dans des réduits étroits, sales, infects, sans air,
sans lumière, enchaînés dans des antres où l’on craindrait
de renfermer les bêtes féroces [...]. Voilà ce que j’ai vu
presque partout en France, voilà comme sont traités les
aliénés presque partout en Europe. »
(Jean-Étienne Dominique Esquirol, 1818.)
« La plupart de ces malades n’ont pas de famille et
souvent ne sont pas sorties de l’hôpital, parfois même du
pavillon, depuis des années, enfoncées dans un état de
passivité tel qu’elles passent leurs journées dans la salle de
séjour, leur fauteuil en face d’un poste de télévision éteint,
lui tournant le dos si on le met en marche, comme dans
l’attente d’un spectacle impossible à voir [...] l’ensemble
des personnes vivant de la vie de l’hôpital, malades ou
soignants considèrent les malades de ces deux pavillons
comme irrécupérables, étendant cette impression d’être
des sous-développés au personnel qui travaille dans ces
pavillons. C’est cette impression d’abandon moral et
matériel qu’on éprouve lorsque l’on visite ce service plus
que l’état réel des malades. »
(Madeleine Vermorel, Rapport médical, 1964.)
Préambule
À chaque époque, le destin de la psychiatrie dépend de
la société. Par exemple, le niveau d’éducation des gardiens
– qui sont devenus par la suite des infirmiers – est en relation
étroite avec le niveau d’éducation de l’ensemble de la popu-
lation : ainsi, au xixesiècle, quand la majorité du pays est
illettrée, les gardiens sont eux aussi, en majorité, illettrés.
Dans les cinquante dernières années, le niveau de recrute-
ment des infirmiers est passé du certificat d’études au brevet
élémentaire puis au bac et à un niveau d’études universi-
taires, parallèlement à l’évolution du niveau de l’instruction
dans le pays, ce qui a permis des soins plus évolués.
Les possibilités thérapeutiques à l’hôpital dépendent
aussi de l’économie. Ainsi, les réformes importantes réa-
lisées en psychiatrie après la seconde guerre mondiale ont
été grandement accompagnées par l’essor économique dans
la période dite des Trente Glorieuses, ce qui a permis
d’affecter des sommes beaucoup plus importantes à la santé,
en particulier aux hôpitaux psychiatriques qui étaient alors
très sous-développés.
Mais, surtout, l’évolution de la psychiatrie dépend étroi-
tement de la mentalité collective, tout particulièrement de
l’image que l’homme se fait de lui-même, de ses sentiments,
de son psychisme et de la représentation, en partie incons-
ciente, que la société se fait du fou. La peur de la folie a
ainsi provoqué la ségrégation du fou et son exclusion de
la société jusqu’à une période récente. En conséquence,
les possibilités d’évolution en psychiatrie résultent surtout
d’un changement des mentalités vis-à-vis de la folie.
La pensée médicale et philosophique
sur la folie
Et dans ce changement, l’évolution de la pensée philo-
sophique et médicale sur la folie joue un rôle essentiel en
contribuant à modifier le regard que la société porte sur
elle. Ainsi, ce sont des médecins du xviiiesiècle, impré-
gnés de la philosophie des Lumières comme Daquin et
Pinel, qui ont amené à penser autrement le traitement des
« insensés » de l’époque, le plus souvent enchaînés dans
des prisons ou des loges. De nos jours, ce rôle est dévolu
aux personnes ayant un intérêt pour la souffrance mentale
et plus particulièrement aux médecins, psychologues, infir-
miers et autres soignants qui approchent de près la folie.
La fac¸on dont ils comprennent le psychisme et la folie peut
760 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

De l’asile à la politique de secteur : l’évolution des institutions et des soins psychiatriques à Bassens
ouvrir des possibilités de changement dans les soins psy-
chiatriques et dans la relation au patient. La connaissance
plus approfondie de la maladie mentale diffère souvent de
l’opinion commune ; aussi, les soignants ont-ils à accom-
plir un effort permanent pour éclairer l’opinion publique
sur la maladie mentale et à mener un combat incessant pour
qu’une organisation des soins adaptés soit mise en œuvre et
que des moyens suffisants soient attribués aux institutions
psychiatriques.
La première révolution psychiatrique
Le mouvement philanthropique
Succédant à l’asile du Betton, insalubre et inadapté,
l’asile de Bassens ouvre ses portes en 1858. Pour sai-
sir la portée de cet événement, il faut remonter quelques
années en arrière car la construction des asiles s’inscrit
dans un mouvement de pensée qu’on appelé après coup
la première révolution psychiatrique. Dès 1770, se déve-
loppe en France, sous l’influence des philosophes des
Lumières1, un courant « philanthropique » basé sur la rai-
son mais aussi, à la manière de Rousseau, sur un élan
du cœur et une répugnance à voir souffrir son semblable.
Déjà en 1785, l’Instruction sur la manière de gouverner
les insensés et travailler à leur guérison dans les asiles
des inspecteurs généraux Colombier et Doublet [1] et en
1788 le Mémoire sur les hôpitaux de Paris de Tenon [2]
marquent une nouvelle fac¸on de penser la folie et de la
traiter.
Joseph Daquin (1732-1815) à Chambéry2déplore le
triste état dans lequel se trouvent les malades enchaînés
à l’Hospice des incurables dans des loges qui « font recu-
ler d’horreur l’homme de l’humanité la plus courageuse ».
Il préconise de traiter avec bienveillance ces patients trop
souvent confondus avec des coupables [3], « il ose déchaî-
ner les furieux, les entoure de propreté, de soins et d’air
pur ». Daquin pense qu’on « réussit infiniment mieux,
auprès des malades par la patience, avec beaucoup de dou-
ceur, par une prudence éclairée », et on obtient plus de
succès par ces « secours moraux » que par « ce fatras de
drogues dont on surcharge généralement les malades » [4].
À Paris, Philippe Pinel (1745-1826) [5] est nommé en
1793 à l’hospice de Bicêtre où il rencontre Jean-Baptiste
Pussin (1745-1811), « gouverneur des insensés », ancêtre
des infirmiers psychiatriques ; aidé de sa femme, Pussin
avait pu se passer des chaînes, même auprès des patients
les plus agités, en les traitant avec attention et humanité
(Didier M.) [6]. Sur ce point, Pinel s’inspire de l’expérience
1Ils ont été précédés par l’humanisme de la Renaissance, illustrée par un
médecin comme Jean Wier, qui affirmait que la folie ne relevait pas de la
démonologie mais de la médecine.
2Il avait connu Jean-Jacques Rousseau, lors de son séjour à Chambéry,
avec lequel il herborisait.
de Pussin et la poursuit. En pleine Révolution franc¸aise, à
une époque où apparaît une idée nouvelle du sujet, avec
la liberté et l’égalité de tous les citoyens, Pinel apporte
avec l’esprit philanthropique une autre fac¸on de conce-
voir la folie. Auparavant, on considérait les insensés, privés
d’humanité, comme des animaux. Pour Pinel, ce sont
des hommes, même s’ils sont temporairement privés de
raison ; ils sont momentanément aliénés – étrangers à eux-
mêmes – mais les soins peuvent les aider à recouvrer la
raison. La reconnaissance de l’aliéné comme sujet permet
l’identification de tout homme sensé à l’aliéné et donne la
possibilité d’un traitement moral et d’une communauté de
vie dans un milieu où il n’est plus isolé dans une loge [7].
Comme Daquin, Pinel préconise la construction d’asiles
spécialement destinés aux soins aux aliénés. L’ouverture de
l’asile de Bassens est donc la réalisation des vœux de ces
médecins, pionniers de nouvelles fac¸ons de penser la folie ;
mais il a fallu plus d’un demi-siècle pour en arriver là car
on ne change pas si facilement les mentalités collectives.
L’institution psychiatrique et les moyens
thérapeutiques à l’ouverture de Bassens en 1858
Du temps de Pierre-Joseph Duclos (1810-1851)
– directeur-médecin de l’asile du Betton, qui conc¸ut le
projet de Bassens – la psychiatrie est, par rapport à celle
d’aujourd’hui, bien dépourvue de moyens efficaces.
Pauvreté de la pharmacopée
Les médecins de l’époque ne croient plus aux médica-
ments comme l’ellébore, censée au Moyen Âge guérir la
folie – ou l’émétique et la saignée, qui évoquent les méde-
cins de Molière – et n’ont guère à leur disposition que
l’opium, un sédatif assez largement employé à l’époque,
faute de mieux.
L’asile comme moyen de traitement
À défaut de moyens spécifiques pour traiter la folie, on
accorde à l’asile lui-même une grande importance pour
isoler le patient, l’occuper et le soigner. « La fondation
d’un asile d’aliénés [...] doit se proposer avant tout un but
moral » (Duclos P.-J.) [8]. Pour Esquirol (1772-1840), suc-
cesseur de Pinel et inspirateur de la loi de 1838, l’asile
lui-même est un moyen de traitement : « Une maison
d’aliénés est un instrument de guérison dans les mains d’un
médecin habile ; c’est l’agent le plus puissant contre les
maladies mentales » [9]3.
Duclos (1851) [10] préconise de construire l’asile dans
une localité isolée – Bassens était alors à la campagne –
dans un endroit calme et salubre, avec « une perspective
3Cette idée sera reprise plus tard dans le mouvement de psychothéra-
pie institutionnelle dans le but de transformer la mentalité asilaire avec
d’autres moyens.
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 761
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

H. Vermorel, M. Vermorel
riante et variée », d’un abord facile, à proximité d’un centre
important ; le site est en effet dans un cadre magnifique avec
en toile de fond la montagne du Nivolet.
L’un des grands problèmes des asiles de l’époque, c’est
l’approvisionnement en eau, en un temps où la distribution
d’eau courante n’existe pas et où les besoins de la popu-
lation étaient restreints. Néanmoins, pour l’alimentation et
l’hygiène de plusieurs centaines de personnes, il en faut une
quantité importante. Aussi, son approvisionnement sera une
préoccupation constante à Bassens, d’autant plus qu’on fait
un large usage des bains et des douches, un des moyens
privilégiés de la psychiatrie d’alors4.
Duclos propose de construire des locaux adaptés pour
350 aliénés, car un plus grand nombre de patients « ralenti-
rait les soins ». C’est malheureusement ce qui va se passer
dans les années suivantes.
L’asile de Bassens sera ordonné autour d’une cour cen-
trale entourée d’arcades qui n’est pas sans rappeler le cloître
d’un monastère et suggère un retrait du monde ; car pour
Duclos, l’asile est là pour isoler le patient de la société,
l’enlever à l’influence des causes qui l’ont mis dans cet
état et à ses habitudes de désordre pour le soumettre à une
discipline d’ordre et d’autorité. À cette coupure avec le
monde, répond en dedans, outre la séparation des hommes
et des femmes5, le placement dans des pavillons distincts
des « curables », des « incurables » et des « idiots » (Ibid.),
réalisant une sorte de ségrégation interne : c’est un point
faible de ce système qui ira en s’aggravant.
Il faut à l’asile des terres cultivées car le travail est pré-
conisé comme moyen d’occupation et de traitement ; d’où
l’acquisition du domaine de Bressieux et la construction
d’une ferme ; mais c’est aussi une nécessité économique,
vu la modestie des moyens alloués à l’asile qui vit dans une
sorte d’autarcie économique : l’hôpital cultive ses légumes,
moud son grain, presse le vin de ses vignes – il paraît que
c’était un bon cru!–etpossède des bovins et des chevaux
jusqu’aux années 1960.
Parmi les autres thérapeutiques, on préconise les activi-
tés artistiques comme le théâtre ou la musique ; Bassens, au
xixesiècle, a une fanfare avec les malades et le personnel.
Le traitement moral
L’asile comme moyen de traitement se complète du
« traitement moral » (ce qui signifie psychique à l’époque)
sorte d’ébauche des psychothérapies futures. On accorde à
la personne, fût-elle « aliénée », une attention particulière.
On cherche à établir avec le patient une relation avec les
moyens de l’époque, le langage de la bienveillance et de
4Les Arabes, qui avaient organisé au Moyen Âge les premiers établisse-
ments psychiatriques, faisaient un large usage de bains. Aujourd’hui, on
les emploie dans les stations thermales spécialisées comme Divonne.
5Séparation en accord avec la culture de l’époque, dans des bâtiments
placés de fac¸on symétrique à cet axe central, marqué par la chapelle, dans
une Savoie profondément catholique.
la raison. Il faut, écrit Esquirol, y mettre de l’intelligence
et du cœur ; on cherche à réprimer la fougue du maniaque,
rassurer ceux qui sont effrayés, encourager les déprimés. La
maladie provenant d’un dérèglement des passions, on peut
provoquer une « secousse morale » pour contrecarrer les
passions déchaînées. Le traitement moral vise à imposer au
malade l’autorité rationnelle, « au besoin par le moyen de
la terreur », ce qui paraît plus discutable [11]. Le traitement
devient alors un affrontement entre deux volontés ; par-
tant de bonnes intentions, il va dégénérer dans les années
suivantes en devenant moralisateur et en engendrant une
véritable oppression du malade.
La loi de 1838
Peu après l’ouverture de Bassens, la Savoie devient
franc¸aise en 1860 et la loi de 1838 y est appliquée. C’est une
loi de progrès : loi d’assistance, prévoyant le financement de
l’hospitalisation, y compris pour les indigents, nombreux
à l’époque ; loi de protection de la personne du malade
et des biens ; c’est aussi une loi de sécurité envisageant
la privation de liberté pour les malades pouvant troubler
l’ordre public ou être dangereux pour eux-mêmes (elle
est soigneusement réglementée pour éviter les abus car
les législateurs avaient à l’esprit l’arbitraire des lettres de
cachet de l’Ancien Régime). Mais elle ne mentionne pas
les soins qui étaient l’objectif essentiel des médecins qui
avaient proposé la création des asiles, c’est de mauvais
augure pour l’avenir.
L’asile de Bassens à la fin du xIxe
siècle et au début du xxesiècle.
Décadence et tentatives de renouveau
Aggravation des conditions d’hospitalisation
Bassens avait été ouvert sous les auspices d’idées géné-
reuses qui vont se heurter à des dures réalités. Tout d’abord,
l’augmentation rapide du nombre de malades : 280 en 1861,
596 en 1882 pour atteindre et dépasser par la suite 1 000 lits,
alors que la capacité de départ était de 400. Cela crée
une situation qui devient rapidement désastreuse, d’autant
plus que le nombre des soignants est tout à fait insuffi-
sant, voire dérisoire. Un seul directeur-médecin assume à
la fois les charges administratives et médicales, pour ces
dernières assisté d’un élève-interne puis de deux. En 1906,
on nomme un directeur et il y aura ensuite un médecin-
chef pour les hommes et un médecin-chef pour les femmes,
chacun d’entre eux ayant la responsabilité de plusieurs cen-
taines de malades, situation qui ne s’améliorera que dans les
années 1960, avec la nomination d’un plus grand nombre
de médecins.
Ce sous-développement s’exprimait aussi dans le
nombre très réduit des gardiens. Le plus souvent illettrés,
ils ne rec¸oivent aucune formation et sont mal payés ; ils
762 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

De l’asile à la politique de secteur : l’évolution des institutions et des soins psychiatriques à Bassens
sont en quelque sorte internés avec les malades dans les
pavillons, devant loger avec eux 24 heures sur 24 et res-
ter célibataires ; certains brutalisent les malades et ont
des habitudes alcooliques, le Dr Coulenjon souhaitant, en
1912, que ces habitudes disparaissent « au moins chez
ceux qui suivent les cours » [12]. Le turnover est élevé,
une partie notable du personnel travaillant à titre tempo-
raire ; certains descendent de la montagne pour travailler
l’hiver à Bassens, retournant garder leurs troupeaux au
printemps.
Il y eut certainement à toutes les époques des surveillants
de qualité et des médecins compétents, mais les conditions
sont telles que la situation de l’asile se détériore ; d’autant
plus que le prix de journée est très insuffisant (il ne dépasse
guère un franc par jour6au xixesiècle). Enfin, l’époque
n’est guère favorable. Si on avait mis au début l’accent
sur l’individu et le traitement moral, la fin du siècle est
l’avènement de l’ère des masses et la société, comme les
élites, ne manifestent pas, sauf exception, un grand intérêt
pour la condition des malades mentaux, laissés à leur triste
sort d’exclusion.
Le renfermement asilaire
Tous ces facteurs conditionnent une période sombre de
la psychiatrie, particulièrement à la fin du siècle. La visite
médicale quotidienne tourne au simulacre : le surveillant-
chef rassemble les malades ayant besoin de soins ; alignés
debout, en rang, ils attendent la visite du médecin-chef qui
les passe rapidement en revue en dictant le traitement au
surveillant : aspirine, chloral, aspirine, chloral, etc. Ce der-
nier est un sédatif employé largement, faute de mieux ; il
fait partie des médicaments nouvellement découverts, avec
le gardénal, efficace chez les épileptiques ; mais ils sont
sans effet sur les psychoses.
Le traitement moral proposé par les pionniers n’est
plus qu’un souvenir mais il faut dire que la psychiatrie
de l’époque manque de bases solides pour promouvoir
une psychothérapie plus évoluée ; les théoriciens de l’asile
avaient voulu en faire un instrument de guérison mais cela
reste une utopie ; l’autorité des soignants était censée conte-
nir la folie par la raison mais, dépourvu de moyens, l’asile
sombre progressivement dans l’autoritarisme, voire la vio-
lence. Aux chaînes ont succédé les camisoles de force ; les
patients perdent toute individualité : on appelle les femmes
mariées par leur nom de jeune fille, les patients sont habillés
dans des uniformes souvent médiocres et, au repas, ils ne
disposent que d’une cuillère, les fourchettes et les cou-
teaux étant prohibés pour des raisons supposées de sécurité,
etc., toutes ces pratiques se perpétuant jusqu’aux années
1960.
Le « gâtisme », aggravé par le manque d’attention
aux personnes âgées ou démentes, se développe et amène
6C’est le prix de journée pour les « indigents ».
la création de pavillons spécialisés où ces patients res-
tent couchés en permanence, macérant souvent dans leurs
excréments. Le climat d’autoritarisme, voire de répres-
sion, ne peut contenir l’agressivité et l’agitation de certains
malades ; on crée des pavillons d’agités où ces patients
sont placés en cellule comme dans une prison, souvent
sur la paille, leur rassemblement en un même lieu ne pou-
vant qu’aggraver la situation. L’isolement avec l’extérieur
s’est aggravé, comme la ségrégation interne, avec une sorte
de hiérarchie de la folie, depuis les patients calmes et tra-
vailleurs (les « bons malades ») jusqu’aux « incurables » et
aux « agités ».
Conservatisme et immobilisme7
La psychiatrie franc¸aise s’honore d’avoir eu dans ses
rangs des médecins de qualité qui ont fait de fines des-
criptions cliniques des affections mentales auxquelles on
peut encore se référer (Falret, Chaslin, Sérieux et bien
d’autres). Mais, dans la pratique asilaire, les observations
médicales sont succinctes et les certificats administratifs
se limitent à des descriptions stéréotypées, le diagnostic
de maladie mentale devenant synonyme d’incurabilité.
L’asile, comme on l’a dit plus tard, sécrète une sorte de
maladie asilaire qui aggrave et chronicise la maladie ini-
tiale.
De l’isolement préconisé au début pour créer un meilleur
climat de soins, on est passé à un véritable enfermement.
Faute de contact avec les familles, nombre de patients
restent à l’hôpital des dizaines d’années sans sorties ni
visites. Dans leur excellent livre sur l’histoire des hôpi-
taux en Savoie, Francis Stéfanini et Georges Dubois ont
bien décrit la situation dégradée à Bassens à cette époque :
« L’asile de Bassens était resté prisonnier de ses murs,
enfermant non seulement les aliénés mais aussi les méde-
cins et le directeur, plus préoccupés de “faire tourner”
l’institution que de remettre en cause ses principes fonda-
teurs et les pratiques en résultant, à savoir l’enfermement,
la séparation des malades de leur famille et de leur milieu
professionnel et le “collectivisme thérapeutique” ». Ces
auteurs évoquent les rapports administratifs surtout cen-
trés sur l’équilibre financier et les problèmes matériels et
relèvent l’immobilisme dans les rapports médicaux qui se
préoccupent de statistiques, de classification nosologique
ou de recherche biologique et ignorent les critiques du sys-
tème asilaire [14].
Nous ajoutons que l’asile franc¸ais est plus centralisé
et autoritaire que ceux d’Allemagne ou de Grande-
Bretagne. L’asile allemand est un asile-village avec de petits
pavillons, sans aucune clôture. En Grande-Bretagne, John
Conolly (1856) [15] préconise l’open-door et arrive à se
passer de la contrainte grâce à l’éducation et au nombre
7C’est ainsi que l’historien de la psychiatrie Zilboorg a caractérisé la
psychiatrie franc¸aise au xixesiècle [13].
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦9 - NOVEMBRE 2012 763
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%