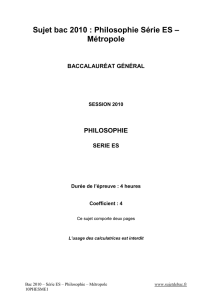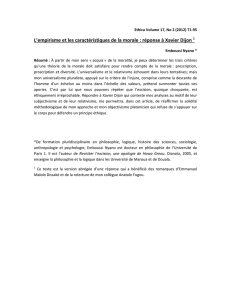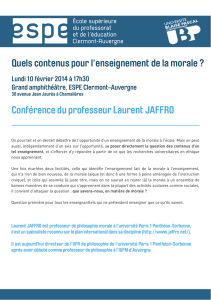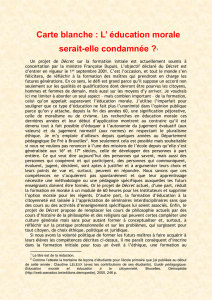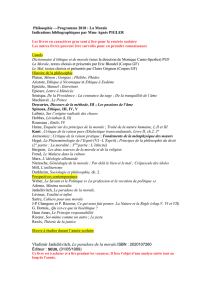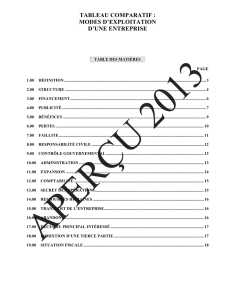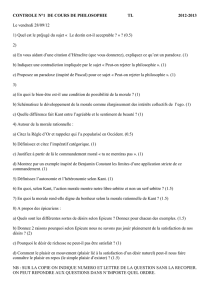LE DEVOIR D`ÊTRE LIBRE Il est possible de se demander si l

LE DEVOIR D'ÊTRE LIBRE
Il est possible de se demander si l'activité de pensée, prise au sérieux et
développée sous le nom de philosophie, ne constitue pas un luxe
extravagant, une « frivolité », sublime peut-être chez quelques-uns, qui y
vouent leurs meilleures forces, mais condamnable pour les autres, parce
qu'inutile. Or, il n'en est rien. C'est même le contraire qui est vrai, du
moins si on en croit Henry Duméry, philosophe de la religion : « Le premier
des devoirs, dit-il, est de penser. » Il a raison, non seulement à cause du
fait que c'est le seul devoir que chacun peut accomplir n'importe où et
n'importe quand, mais encore et principalement, parce que le devoir
comme tel est essentiellement une affaire de pensée.
En effet, se reconnaitre une obligation quelconque, cela implique que la
pensée s'est éveillée en nous, a travaillé, et qu'elle nous propose un acte
à faire, en disant qu'il est nécessaire qu'il soit fait. Nous sommes donc
d'emblée dans la morale. Se reconnaitre un devoir, c'est par conséquent
se sentir motivé par la pensée ou la raison, en rapport avec quelque chose
à faire ou à ne pas faire. La morale, dans son sens premier et le plus
profond, consiste à obéir à la pensée plutôt qu'à son désir, à sa peur, à sa
passion, à son instinct, à son intérêt, à la mode, à une autorité
quelconque. Autrement dit, obéir à sa pensée plutôt qu'à la nature ou à
la société. À ce niveau, le contenu du devoir est négligé, mais il est sûr
qu'il constitue une affaire de pensée, et donc qu'il va s'agir pour une
personne de se commander elle-même et non pas d'obéir.
Il n'y aura donc de morale pour un individu que si ce dernier est conscient
qu'il est un esprit lié à une chair et qu’en lui l'autorité, le commandement
appartient à l'esprit seul. C'est de cette façon que chacun fait l'expérience
de la liberté en même temps qu'il fait celle de la morale. Ces deux
expériences sont intimement liées. Se sentir une obligation revient donc
à se découvrir comme un être moral, ou à saisir, dans l'essence même de
son humanité, une exigence et une dimension éthique. Celui qui a la
capacité de penser, sera nécessairement un être moral, car la moralité
consiste à se comporter comme un être doté de pensée et ayant par le
fait même le droit et l'obligation de l'utiliser.
La pensée apparait ainsi au principe de ce qui est vraiment humain en
nous : notre liberté. Si l'être humain n'avait pas de pensée, il se situerait

entièrement dans la nature, laquelle, obéissant à des lois, ne connaitrait
pas la liberté. Cette dernière consiste non à pouvoir agir n'importe
comment, mais à pouvoir agir comme le sujet pense qu'il doit le vouloir,
et tout d'abord à penser vraiment ce qu'il pense. C'est-à-dire à soumettre
ses représentations mentales à une sorte d'examen que la raison seule
peut effectuer et qui implique impartialité, objectivité et si possible
universalité. La liberté repose sur notre autonomie comme sujet ou
personne, laquelle repose à son tour sur notre capacité à former des
concepts, des jugements, des raisonnements et ainsi à nous déterminer,
à entrer en action par nous-mêmes.
Tant que nous n'avons pas découvert cette capacité de nous représenter
le monde et nous-mêmes pour en juger, nous ne sommes pas encore une
personne au plein sens du mot, c'est-à-dire un être libre, et nous ne
pouvons pas être tenus responsables de nos actes. C'est le cas pour les
enfants ou pour certains sujets malades ou déficients mentaux. Mais dès
que nous avons fait cette découverte, nous ne pouvons plus échapper à
l'obligation de nous représenter le monde et nous-mêmes et de juger de
ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le devoir est apparu chez nous en même
temps que la liberté et le pouvoir de penser.
Mais penser à quoi ? Nous pourrions être portés à dire : penser d'abord la
pensée elle-même ! Mais cette tâche est extrêmement difficile et doit
être laissée à des spécialistes, les logiciens, ou remise à plus tard. La
meilleure réponse consiste à dire : penser à ce que je fais, à ce que
d'autres me demandent de faire, à ce que j'ai envie de faire, etc. C'est la
sphère de l'action qui s'ouvre d'abord, et donc celle de la morale. Car nous
baignons dans une morale depuis notre naissance et elle a déjà
commencé à faire problème avant même que la pensée ne se soit éveillée
en nous. Or nous découvrons aisément que pour penser notre action,
nous devons nous penser nous-mêmes, mais aussi penser la société et
plus généralement le monde dans lequel nous vivons, dans lequel notre
existence se déroule, cela afin de pouvoir y déployer convenablement
notre action.
La découverte du monde, que notre pensée nous permet de faire, n'a pas
qu'un caractère utilitaire, à savoir rendre possible une action bonne ou
juste ; elle permet aussi de découvrir la splendeur du monde. Le monde
n'est pas simplement le lieu où je dois déployer mon existence et en
quelque sorte l'outil que je dois utiliser pour me manifester comme être

humain. Il est aussi cette merveille, ce miracle permanent qui s'offre à
mon admiration et à ma curiosité. L'existence n'est pas qu'une épreuve à
supporter ou une occasion qui m'est donnée de réaliser des valeurs et de
me perfectionner comme personne, elle est aussi une joie et une fête
dont il faut savoir profiter et pour laquelle il me faut rendre grâce au Ciel.
Mais ce disant j’entrouvre la porte à un deuxième devoir, bien connu
celui-là, en Occident du moins, parce que constituant un impératif
religieux considéré comme tout à fait fondamental : Aimer Dieu de tout
son cœur et son prochain – ses congénères – comme soi-même.
Déjà, nous l'avons vu, à partir du moment où une pensée s'éveille dans
une personne, apparait le devoir de penser, mais aussi forcément les
idées de liberté, d'action, de bien et de mal, de monde et… il faut le dire
aussi maintenant, de Dieu. Au départ l'idée est confuse certes, comme
toutes les autres mentionnées ici, mais elle s'impose absolument comme
ce qui est responsable du caractère pensable ou intelligible du monde et
du sujet lui-même. S'il y a un désir de penser qui existe pour l'humain, cela
suppose que le monde dans lequel se déroule notre existence n'est pas
abandonné au hasard, qu’il est doté d'une structure pensable, intelligible,
pour ne pas dire rationnelle. En fait, ressentir le devoir de penser n'a de
sens que dans un univers où une pensée est prégnante déjà, règne ou du
moins a régné à l'origine ; un univers où une pensée se sent chez elle et
non étrangère. De ce point de vue, toute notre pensée – et pas seulement
toute la morale – est suspendue à un être pensant fondateur du réel, que
nous appelons Dieu avec la plupart des philosophes et des grandes
traditions religieuses.
La démarche que nous proposons ici ressemble beaucoup à celle de
Descartes. Comme lui nous partons du fait de notre pensée, qui est
premier et fondamental. Puis nous allons tout de suite à Dieu, dont
l'existence s'impose pour que nous puissions continuer à penser et nous
sentir le devoir de le faire. Par contre, contrairement à ce que Descartes
fit, nous ne reportons pas la morale à plus tard, comme la plus
problématique des sciences, la moins certaine de toutes. Nous
l'introduisons dès le début, comme nous y introduisons aussi la religion.
Ainsi mon premier devoir est de penser, afin de pouvoir penser mon
action et de m'accomplir comme être libre. Mais parce que je suis libre et
que je dois agir librement, mon deuxième devoir est de penser le monde
naturel et social dans lequel s'insère mon existence. Or ce ne sont pas

seulement deux objets de pensée différents qui s'offrent ainsi à moi, ce
sont aussi deux modes de pensée distincts. Le premier (penser mon
action) implique une réflexion sur moi en tant que personne humaine et
s'appelle philosophie ; le second (penser le monde) implique analyse et
expérimentation et s'appelle science. La philosophie est liée à la morale
et à la religion dès le point de départ, ou encore, elle débouche toujours
et directement sur la morale et sur la religion. Son objet est l'existence de
la personne dans un monde sensé, rationnellement connaissable et
transformable. Cependant il ne faut pas aller jusqu'à identifier le contenu
de la religion avec celui de la philosophie, car la religion serait détruite et
il en résulterait vraisemblablement une amputation de l'âme humaine ;
quant à la philosophie, elle en serait dénaturée.
Penser l'action veut dire plus précisément penser les valeurs qui président
aux actions ou les dirigent. Il faut d'abord les « percevoir » ou les atteindre
dans une intuition, ce qui n'est possible que pour une pensée qui rentre
en elle-même, revient vers l'intérieur, se libère des apparences ou des
phénomènes dans lesquels tout d'abord elle s'investit naïvement. Sans ce
renversement, cette remontée vers sa source, la pensée ne connaitrait
que des êtres mondains, elle ne connaitrait pas les valeurs, qui sont en
quelque sorte des voix ou des « appels » à faire être l'humain. En fait, sans
la découverte des valeurs et de cette requête qu'elles nous adressent,
nous ne serions pas libres, nous ne connaitrions pas le devoir, qui est
l'obligation de réaliser des valeurs – ce qui est la seule façon de donner
un sens à notre existence et de nous accomplir comme personne.
Mon premier devoir est de penser. Je peux maintenant préciser en disant
: d'abord sur le mode de la réflexion. Ensuite, mon deuxième devoir sera
de connaitre adéquatement le monde, pour pouvoir y insérer
efficacement mon action, ce qui implique la pratique ou le recours à la
science. La réflexion est vraiment mon premier devoir, celui qui me met
sur la voie de ma réalisation comme être libre, autonome, agissant non
plus en fonction de mes besoins et désirs ou des stimulations du milieu
extérieur, mais en fonction des valeurs que je ne manque pas de découvrir
dès que je renverse le mouvement de ma pensée et la fait revenir sur ses
pas, rentrer en elle-même. S'il en est ainsi, notre premier devoir à nous,
êtres humains, consiste aussi à nous détourner du monde, à dire non au
monde et à affirmer du même coup que d'autres « réalités » existent,
auxquelles nous n'avons accès que par la pensée et qui ont la priorité sur
tout ce que nous découvrons au-dehors de nous.

Or, ce mouvement de la réflexion s'arrête-t-il aux valeurs ? Le Moi qui
pense va-t-il se contenter de percevoir ces « appels », sans se demander
ce qui se tient derrière, et d'où vient que ces valeurs nous appellent,
qu'elles nous font une obligation d'agir ou de nous exprimer de telle ou
telle façon, et non pas de telle ou telle autre ? Aller plus loin que les
valeurs, chercher quelle est leur source, c'est déjà poser Dieu, l'être
absolu, le fondement, la source et de nous-mêmes et du monde.
Dès le départ, la pensée rencontre la morale, nous l'avons vu, et elle
rencontre aussi Dieu, comme fondement de l'intelligibilité du monde dans
lequel notre existence doit se déployer. Mais elle le rencontre aussi
comme fondement des valeurs en fonction desquelles nous devons agir
et nous exprimer. Cela, à moins qu'elle ne récuse l'obligation comme telle,
l'idée même d'un devoir qui serait fait aux êtres libres que nous sommes.
De fait, il arrive que chez certaines personnes, la pensée ne se mette en
branle que pour découvrir et observer ce qui est dans le monde, sans plus.
Elle se pense elle-même alors comme une pure capacité de
représentation de ce qui est. Elle ignore ou néglige l'action, cette
nécessité où nous sommes mis, en tant qu'êtres humains, d'agir, de
décider, d'intervenir activement dans la société des personnes et dans
l'univers. C'est un choix que ces personnes-là font, qui les conduit à une
existence différente, mais observée fréquemment de nos jours : une
existence qu’on pourrait qualifier d’esthétique ou de purement ludique.
Les dimensions éthique et religieuse ne sont pas directement perçues par
ces gens ou ne le sont que très vaguement.
Ici il faut se demander si l'introduction de Dieu dans la pensée est
vraiment le fait de la pensée elle-même, qui en sent le besoin, ou si elle
ne se produirait pas par hasard sous l'impulsion, pour ne pas dire
l'injonction, d'une puissance extérieure au sujet, qui s'appelle autorité
religieuse ou tradition religieuse. Dans ce cas, il deviendrait permis de dire
que Dieu n'est pas d'abord un objet de pensée, mais un objet de foi
introjeté dans le sujet. Or nous pensons que non. C'est naturellement et
spontanément que notre pensée rencontre le problème de Dieu, comme
c'est naturellement et spontanément qu'elle rencontre celui de
l'obligation morale. Car l'être qui se reconnait un devoir en même temps
qu'il se découvre pensant et libre, se reconnait aussi toujours comme
dépassé et dépendant d'une puissance pensante qui est au principe, à la
source de tous les êtres et de lui-même. De ce fait, c'est Dieu même qu'il
 6
6
1
/
6
100%