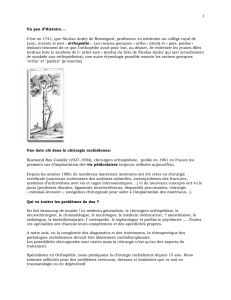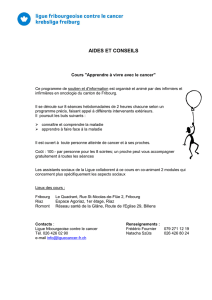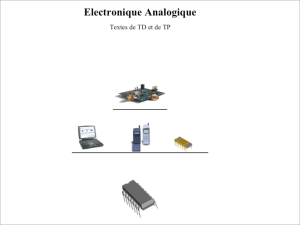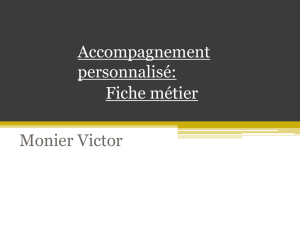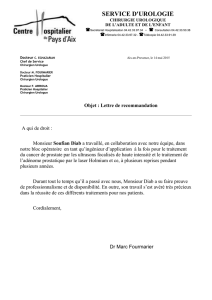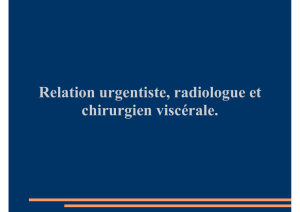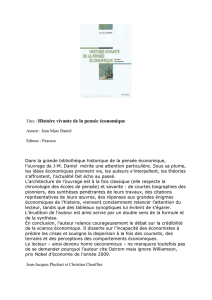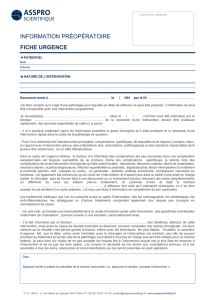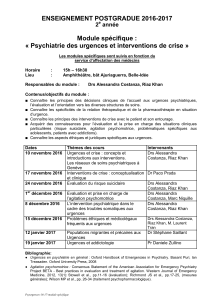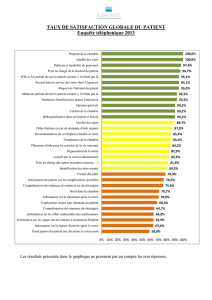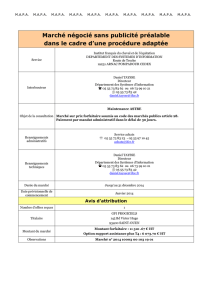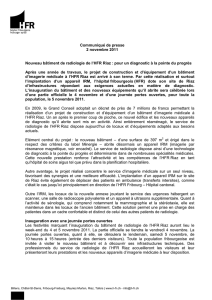Reportage Phagocytose par Fribourg impossible

7
6
La Gruyère / Jeudi 21 février 2013 / www.lagruyere.ch
La Gruyère / Jeudi 21 février 2013 / www.lagruyere.ch Reportage
En période hivernale, le docteur Daniel Monin ne cesse de courir entre
son bureau et la salle d’opération. Avant chaque intervention, passage
obligatoire par le vestiaire et lavage méticuleux des mains.
Le bloc en plein boum hivernal
A 11 h 15, après s’être lavé les
mains précautionneusement, le
chirurgien entame la désinfection
de son patient. «Nous avons mis
en place des protocoles précis de
désinfection et de mise en place
des champs opératoires stériles
pour tous les chirurgiens orthopé-
distes», explique Daniel Monin,
alors qu’il badigeonne allègre-
ment la jambe du futur opéré. «Les
risques d’erreur sont ainsi réduits
au maximum.»
Le chirurgien engage ensuite
avec les infirmières instrumen-
tistes une danse des sept voiles
pour mettre en place les champs
stériles. Un drap vert est déployé
tout autour du patient. Seule sa
cuisse reste visible. «La préven-
tion des infections est primor-
diale: d’autant plus quand on
touche aux os et que l’on utilise
des prothèses.»
Le médecin se fait alors habil-
ler de façon stérile: une robe à
longues manches et deux paires
de gants. Une étape qui nécessite
l’aide des infirmières et un tour
sur lui-même.
L’infirmière instrumentiste se
cale entre les tables supportant
les visseuses, les maillets et les
cuillères, et le patient.
«On fait le time out?» interroge
le chirurgien. Il énumère ainsi le
nom et le prénom du patient, le
type d’intervention et, surtout, le
côté où elle doit avoir lieu. Trois
oui fusent. «Bistouri.»
Le changement de la prothèse
de hanche se fera par une mé-
thode mini-invasive. «Dans le can-
ton de Fribourg, les chirurgiens
orthopédiques de Riaz ont été les
premiers à l’appliquer. Nous met-
tons environ une centaine de pro-
thèses totales de hanche par an
avec cette technique.»
Plus vite à la maison
L’intérêt de cette technique ré-
side dans le trajet emprunté par le
chirurgien jusqu’à l’os. Il découpe
la peau, protégée par de la cello-
phane imbibée de désinfectant,
brûle les petits vaisseaux et liga-
ture les plus gros. Une fois la gaine
blanche du muscle atteinte, il l’ou-
vre. Le muscle, lui, restera intact,
simplement poussé sur le côté
pour libérer l’accès à la hanche.
«Le muscle sera juste contus.
La préservation de la musculature
En pleine intervention chirurgicale, les médecins orthopédistes sont assistés d’une infirmière instrumentiste, de son aide, d’un infirmier anesthésiste, supervisé par un médecin anesthésiste. Les champs stériles verts cachent la majeure partie du patient. Seul le membre à opérer reste
à l’air libre. Le docteur Daniel Monin
(à droite)
est responsable du service d’orthopédie de l’HFR Riaz. Originaire du Jura, il a effectué sa formation aux Hôpitaux universitaires de Genève.
RIAZ.
Le docteur Daniel
Monin est chirurgien
orthopédiste. Il ouvre
la porte de sa salle
d’opération à l’HFR Riaz,
en pleine saison hiver-
nale.
TEXTE SOPHIE MURITH
PHOTOS CHLOÉ LAMBERT
Nul besoin au docteur Daniel Mo-
nin de mettre le nez dehors pour
savoir l’hiver arrivé. Dès 7 h, le
colloque met immédiatement au
parfum le chef du service d’ortho-
pédie de l’HFR Riaz. Si la litanie
des cas est égrenée durant plus
d’une demi-heure, les chaussées
sont sûrement gelées et le temps
des vacances aux sports d’hiver
est à coup sûr revenu.
Dans cette pièce assombrie du
1er étage de l’hôpital, une dizaine
de médecins écoutent un assis-
tant déchiffrer les rapports de
consultations. Les radios, IRM et
autres échographies correspon-
dantes sont projetées simultané-
ment. Les questions des chefs de
service fusent. «Il faut être très
concentré, reconnaît le spécialiste
en orthopédie. Il s’agit de s’assu-
rer, sans voir le patient, que sa
prise en charge est adéquate.»
Programme chargé
Pas de temps à perdre avec des
cas déjà exposés la veille. Le doc-
teur Daniel Monin est attendu au
bloc opératoire depuis un quart
d’heure déjà. Une assistante a
quitté la séance plus tôt pour pré-
parer le patient. Juste le temps
pour le chirurgien de prendre une
blouse blanche propre dans l’ar-
moire, de déposer ses affaires
dans son bureau.
Daniel Monin entre dans la
zone réservée au personnel et aux
futurs opérés. Passage par le ves-
tiaire: les vêtements de tous les
jours sont troqués pour une che-
mise et un pantalon bleus, des sa-
bots en plastique, une cagoule
pour recouvrir tous les cheveux et
un masque.
Au programme de la matinée:
trois opérations, deux genoux et
une hanche, sans compter les ur-
gences qui se sont ajoutées. Les in-
terventions ambulatoires sont pla-
nifiées dès 7 h 30, pour permettre
au patient de rentrer chez lui en fin
de journée. Après une première ar-
throscopie du genou, Daniel Monin
retrouve sa blouse blanche. Entre
deux opérations, il dispose de qua-
rante-cinq minutes environ. Il s’in-
quiète des nouveaux cas arrivés
aux urgences (lire ci-contre) et pro-
fite d’expédier les affaires cou-
rantes: compte rendu opératoire,
signature de différents documents,
relation avec les assurances, de
plus en plus envahissantes. «Je le
fais au fur et à mesure sinon je per-
drais le contrôle de la situation.»
Règle d’or: la désinfection
Passage par le vestiaire. Le
docteur Monin se dote d’une paire
de lunettes de protection. «Pour
éviter les projections de sang
dans les yeux.»
permet une récupération plus ra-
pide et moins douloureuse. Ainsi,
le patient pourra rentrer plus vite
à la maison et reprendre ses acti-
vités.» Une heure après son arri-
vée en chambre, l’opéré de la
hanche peut déjà bouger la jambe.
Le temps passe vite, rythmé
par les bips de contrôle des pulsa-
tions et le bruit de l’aspirateur qui
récupère le sang dans l’incision.
Le chirurgien opérateur bien-
tôt s’attaque à la scie au col du fé-
mur. Après plusieurs essais, Da-
niel Monin visse un anneau au
fond de la cavité laissée par l’an-
cienne cupule. Il y cimentera la
nouvelle en polyéthylène. La tête
de la prothèse, elle, est en céra-
mique. «En Suisse, le choix du ma-
tériel revient encore au chirur-
gien. Il prend celui qu’il estime le
meilleur en fonction du patient et
celui qu’il connaît le mieux.»
Le pied du patient est mainte-
nant tourné à 180 degrés et sa
jambe abaissée au maximum pour
pouvoir mettre au jour l’os du fé-
mur. Il s’agit de le percer. Le trou
est ensuite progressivement aug-
menté avec un burin jusqu’à ce
qu’il corresponde à la taille de la
prothèse. Après deux heures et
demie d’opération, la prothèse est
en place. Le médecin referme la
gaine contenant le muscle et
laisse son assistante suturer la
peau. Il est attendu pour une opé-
ration d’un poignet en urgence
dans la salle d’opération à côté. ■
“Le choix du matériel revient encore au
chirurgien. Il prend celui qu’il estime le meilleur
en fonction du patient et celui qu’il connaît
le mieux. ”
DrDANIEL MONIN
Phagocytose par Fribourg impossible
«La collaboration entre les sites est excellente, assure
le docteur Daniel Monin. La majeure partie des cas peut être
soignée à Riaz. Toutefois, les fractures du bassin, les
tumeurs osseuses, la chirurgie de la main et du dos
sont traitées à Fribourg. «L’activité du service d’orthopédie
de Riaz est importante. A l’heure actuelle, cette activité
ne serait pas absorbable sur le site de Fribourg. A moyen
terme, l’étude de faisabilité nous donnera davantage de pré-
cisions.»
Pour l’orthopédiste, la population du sud du canton
doit faire le choix de venir se faire soigner à Riaz si elle sou-
haite avoir une chance de conserver des soins aigus
sur ce site. «En préférant une alternative – nous ne pouvons
pas le lui reprocher, le libre choix du médecin existe heureu-
sement encore – elle doit en tirer les conséquences et les ac-
cepter.»
Le nombre de cas de traumato-orthopédie ne cesse d’aug-
menter. Près de 1300 interventions sont pratiquées chaque
année à Riaz. Les agendas des médecins cadres débordent
déjà et la polyclinique accueille environ 4000 consultations
par an, malgré le fait que les spécialistes s’efforcent de
«réadresser» le maximum de patients à leur médecin traitant.
«La policlinique permet de revoir des cas que l’on estime
devoir être traités par des orthopédistes», explique Daniel
Monin qui la supervise grâce à un colloque tous les après-
midi et avec le soutien des autres médecins cadres – les doc-
teurs De Raemy, Tschopp et Juan. Quatre internes se char-
gent de recevoir les patients. SM A 16 h 30, l’équipe d’orthopédie – médecins cadres, chefs de clinique et internes – se réunit autour des cas de la policlinique.
Dans le box des urgences, un petit dur, couché, les bras croisés der-
rière la tête et en slip bleu, répond crânement aux questions du mé-
decin sur son genou endolori. «Ce n’est jamais simple avec les en-
fants. C’est très fin, très subtil. Il faut une approche très ludique»,
explique le docteur
Daniel Monin, chef du
service d’orthopédie.
En plus des inter-
ventions chirurgicales
et des urgences, le
chef de service reçoit
plusieurs fois par se-
maine ses patients en
consultation dans son
cabinet de l’hôpital.
«C’est prenant au
niveau de la concentration et de l’émotionnel. Il faut établir le
contact, écouter et comprendre.» Une étape essentielle pour réus-
sir à connaître les attentes de chaque patient et ainsi lui proposer
le traitement le plus adapté à ses besoins. «Il est primordial que le
patient comprenne les objectifs que nous pouvons atteindre avec
l’opération proposée ainsi que les complications potentielles, sans
quoi nous nous exposons à de grosses déceptions.»
Le Jurassien Daniel Monin a choisi l’orthopédie-traumatologie à
20 ans après un accident de moto. «Une expérience de patient
utile.» Formé aux Hôpitaux universitaires de Genève, il concède
quelques différences entre les deux établissements. «Le volume de
travail est plus petit, mais on est aussi moins pour le faire.» Et les
patients? «Le Fribourgeois a plus les pieds sur terre, il n’a pas
d’attentes extravagantes. Lorsqu’on est honnête avec lui, la rela-
tion est bonne. Il ne doit pas se sentir abandonné.»
Ainsi, en fin de journée, parfois sans avoir pris le temps de man-
ger, il s’attache à rendre visite aux patients hospitalisés. «C’est im-
portant, ils nous attendent. Quand je ne passe pas parce que je suis
retenu au bloc, on me le reproche.» SM
L’objectif est d’arriver
à bien se comprendre
En un an, 15500 cas
traités aux urgences
Le service des urgences et celui d’orthopédie travaillent main
dans la main sur le site de l’HFR Riaz. Le docteur Alfredo Guidetti,
responsable des urgences, revient sur cette relation fusionnelle.
Comment s’articule la collaboration entre le service d’orthopédie et
celui des urgences?
Mon service est indépendant. Un patient vient avec des dou-
leurs. A nous d’en trouver les raisons. Parfois, nous avons besoin
de l’avis d’un spécialiste. Dans le cas d’une fracture déplacée, par
exemple, nous demanderons le soutien d’un orthopédiste. Nous
pouvons faire appel à lui quand nous le désirons.
Avec la neige et les sports d’hiver, les patients nécessitant les bons
soins d’un orthopédiste ne doivent actuellement pas manquer...
Nous vivons un vrai pic. Avec la neige, les glissades et les acci-
dents de voiture sont fréquents. Les quelques pistes de ski de la
région contribuent aussi à l’augmentation du nombre de cas. Ces
derniers jours, l’attente est en moyenne de quatre à six heures.
Chaque année, près de 15500 personnes sont prises en charge
aux urgences de Riaz et cela augmente de 10 à 20% par année.
Comment décidez-vous quel patient peut faire l’objet d’une opération
en urgence?
Nous en discutons entre médecins. A Riaz, nous avons de la
chance, tout le monde se connaît. Ce site hospitalier a une taille
parfaite pour la communication. Nous pouvons régler les choses
autour d’un café ou d’un repas plutôt que par de longs mails.
Nous nous côtoyons tous les jours.
Et pour les hospitalisations?
En général, les services d’urgence de tous les hôpitaux enregis-
trent 40 à 60% des hospitalisations. Celles-ci sont dictées par la
pathologie. Parfois, l’âge peut aussi être un argument pour ne pas
laisser une personne rentrer à la maison. Nous informons les ca-
dres du service concerné. SM
L’attirail du chirurgien orthopédiste tient de la caisse à outils. L’infirmière
instrumentiste prépare les ustensiles en fonction de l’intervention.
1
/
1
100%