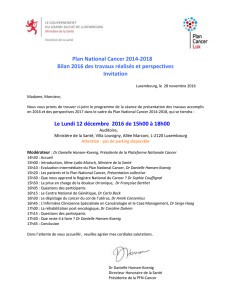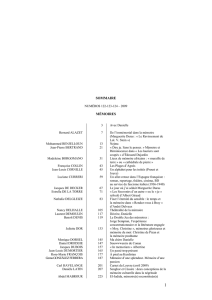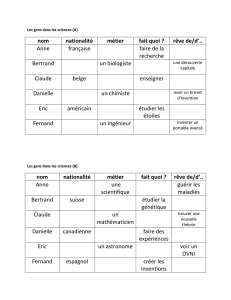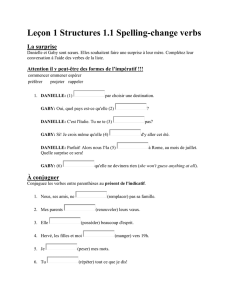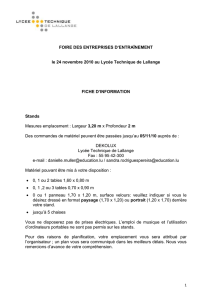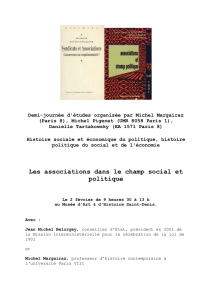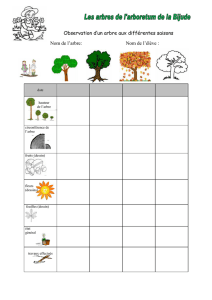Théâtre pour la main» Danielle Schirman

Un Jour, Une Oeuvre.......
«Théâtre pour la main»
Danielle Schirman
le 19 septembre 2015
cyclonelesite.com

Théâtre pour la main
La manipulation de ses languettes et tirettes
Théâtre pour la main

Le Théâtre pour la main :
la machine célibataire de Danielle Schirman
Le Théâtre pour la main
, Astronomicum
Caesareum
Les Arlequinades

Cent mille milliards de poèmes
, Andy Warhol’s Index (Book)
designers
ta-
bleaux vivants
Cent vingt journées de Sodome
haptique
ce Théâtre
La Règle du jeu
Théâtre
Théâtre pour la main
Anémic Cinéma
fait à la main
Théâtre pour la
main
Dominique Païni

Le rouge et le noir (dommage, c’est déjà pris...)
C
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%