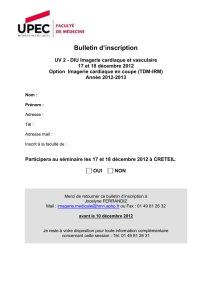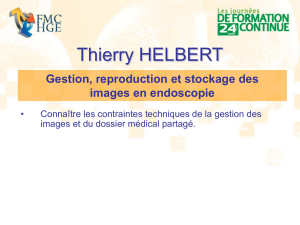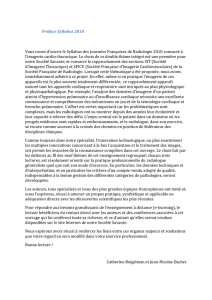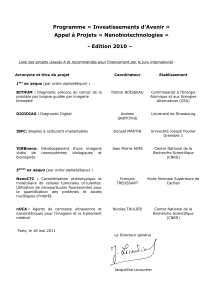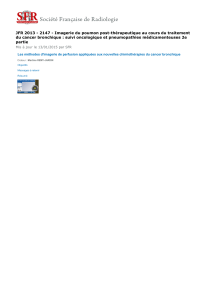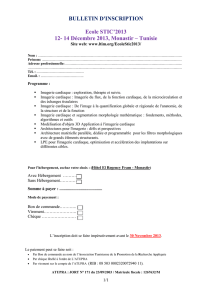Décembre 2012 - Mutualité chrétienne

Dépenses de santé
Les dépenses en soins de santé (dépenses SDS) grignotent aujourd’hui en Belgique
un peu plus de 10% du Produit intérieur brut (PIB, soit la richesse totale d’un pays
exprimée en euros). Grosso modo, les dépenses de santé atteignent 37 milliards
d’euros, pour un PIB de 370 milliards d’euros en 2011
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 >90
volume codes facturés
classe d’âge
autres
TKH BV
Rx orthopédie
Pneumo rx
IRM
mammo
Echo
ct scan
Médicaments
En 2001, la part des médica-
ments bon marché n’était
que de 12 %. La limite sym-
bolique des 50 % a pour la
première fois été atteinte
en 2011: 1 médicament sur
2 était une variante bon
marché.
12% 11% 14% 18% 27% 37% 40% 40% 43% 46% 49%
88%
77% 72% 66% 56%
50% 49% 48% 47% 44% 41%
0%
11% 14% 16% 17% 13% 12% 12% 10% 10% 10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% DDD
Année
SR
SM
SBM
Figure 1: Imagerie médicale – Volume selon le type d’examen et la classe d’âge
MC-Informations
Analyses et points de vue
Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes 250
décembre 2012
La
solidarité,
c’est bon pour la santé.
MUTUALITE
CHRETIENNE
Figure 1 : Évolution de la part de médicaments bon marché (en DDD)

2
Ces 20 dernières années, les dépenses en soins de santé ont
triplé, alors que la richesse nationale a doublé seulement. Ces
dépenses s’élèvent actuellement à environ 10 % du PIB. Selon
les prévisions, elles continueront à augmenter. Les causes
sont bien connues: vieillissement de la population entraînant
une augmentation des soins chroniques, innovation et
technologie médicale de plus en plus poussée, accroissement
des revenus des prestataires, etc. En outre, le secteur des
soins de santé est un secteur à forte densité de main d’œuvre
dans lequel il est difficile d’augmenter la productivité. L’article
relatif au financement des dépenses pour les soins de santé
en Belgique décrit les différentes sources de financement
actuelles et explore d’éventuelles marges d’augmentation.
L’auteur développe deux pistes possibles qui permettraient aux
mutualités de disposer davantage d’instruments de gestion
pour mener une politique financière plus responsable.
Outre un meilleur financement, la maîtrise des dépenses reste
essentielle. Les dépenses élevées en soins de santé peuvent
être tant la conséquence d’une sous-consommation que d’une
surconsommation. Une étude intermutualiste de l’AIM relative
à l’imagerie médicale a fait apparaître qu’il fallait absolument
diminuer le nombre d’examens avec rayons ionisants, en
particulier la répétition inutile de certains examens. La
prescription d’examens radiologiques sur la base d’indications
scientifiquement étayées ainsi qu’un registre central de
données constituent des outils importants à cet égard.
Au vu des développements actuels au sein de eHealth, il doit
être possible à terme de générer ces instruments par le biais du
dossier médical électronique du médecin. Grâce à un ‘evidence
linker’, chaque médecin prescrivant des prestations d’imagerie
médicale pourrait d’emblée etre tenu au courant des dernières
directives en matière de bonne pratique dans ce domaine.
Le radiologue peut alors envoyer, par voie électronique, les
examens réalisés pour un patient à un registre, afin que le
médecin traitant (et éventuellement le patient) puisse suivre la
dose d’irradiation subie par patient.
Bonnes nouvelles du côté des dépenses. Une étude réalisée
par la MC a fait apparaître qu’un médicament prescrit sur deux
est une variante bon marché. Ceci permet de réduire les coûts,
tant pour le patient que pour l’assurance maladie, sans perte de
qualité pour autant. Cette tendance pourrait encore s’améliorer.
Si le médecin prescrivait toujours en DCI, le patient aurait la
garantie de se voir délivrer un médicament bon marché, sans
supplément de référence. Rien que pour les patients affiliés
auprès de la MC, cela représenterait une économie de 15
millions d’euros qu’ils ne devraient plus débourser eux-mêmes.
La clé de voûte d’un support électronique digne de ce nom
serait un programme eHealth qui présenterait au médecin les
coûts d’un traitement déterminé tout en lui suggérant la solution
la plus efficiente.
Dr. Michiel Callens
Directeur de département Recherche et Développement
Editorial
2MC-Informations 250 • décembre 2012

Les dépenses en soins de santé (dépenses SDS) grignotent
aujourd’hui en Belgique un peu plus de 10% du Produit intérieur
brut (PIB, soit la richesse totale d’un pays exprimée en euros).
Grosso modo, les dépenses de santé atteignent 37 milliards
d’euros, pour un PIB de 370 milliards d’euros en 2011. La plus
grande partie de cette somme est payée par les mutualités et
l’INAMI (Institut national de l’assurance maladie et invalidité),
soit l’assurance maladie. Mais les autorités fédérales et
régionales dépensent également de l’argent pour les soins de
santé (médecine scolaire, prévention, etc.). Enfin, le patient
en paie une bonne partie de sa poche, essentiellement via les
tickets modérateurs, les suppléments, les médicaments non
remboursés, les aides techniques, les primes d’assurance,
ainsi que les frais hospitaliers. Ces 20 dernières années, les
dépenses de soins de santé ont triplé, alors que la richesse du
pays n’a fait que doubler.
Nous ne pouvons qu’estimer la croissance des dépenses SDS
au cours des 10 à 20 prochaines années. Mais nous pouvons
affirmer avec une grande probabilité qu’elle augmentera plus
vite que la croissance de la richesse du pays. C’était ainsi
dans le passé et ce le sera sans doute encore dans les 20
années qui viennent. Les économistes parlent de produits ou
services ‘supérieurs’: dans les pays riches, de telles dépensent
progressent plus vite que la richesse du pays. Le niveau soutenu
de cette croissance est imputable à des évolutions connues.
Un premier élément est le développement phénoménal des
technologies et des innovations médicales, ainsi que des
possibilités de la médecin moderne. Grâce à elles, l’espérance
de vie a considérablement augmenté ces dernières décennies.
Un deuxième élément est le vieillissement de la population. On
estime que les filles qui naissent aujourd’hui pourront vivre en
moyenne 100 ans. Le groupe des personnes âgées constituera
donc une part de plus en plus grande de la population et, vu sa
consommation de soins de santé accrue, entraînera des coûts
importants en soins de santé. Le vieillissement entraînera de
plus fortes dépenses dans le secteur des soins chroniques.
D’autres facteurs stimuleront l’inflation de nos soins de santé:
• Le fait que le domaine des soins de santé est un secteur intensif
en main-d’œuvre, avec à la clé une productivité inférieure à
celle de l’industrie, tandis que les salaires évoluent souvent
de manière identique; cette situation conduit à l’inflation du
coût des soins de santé.
• L’offre importante d’infrastructures de soins et d’appareils
médicaux
• Les soins de santé sont un bien de consommation (esthétique
avec le Botox, certitude par rapport au niveau de cholestérol
par exemple, prédictibilité, screening, etc.).
• L’individualisation croissante de notre société, avec l’espoir
que toute la vie sera de plus en plus facile …
Dans le présent article, nous allons nous focaliser moins sur
l’aspect ‘dépenses’ que sur l’origine future des moyens qui
permettront de faire face à ces dépenses. Pour maintenir la
bonne santé financière d’un système, et donc garantir son
avenir, il n’existe que deux possibilités : bien maîtriser les
dépenses et/ou veiller à disposer de suffisamment de moyens.
Dans cette partie, nous allons délaisser la question de savoir
comment mieux contrôler l’évolution des dépenses. Celle-
ci a déjà été abordée dans des articles précédents (plus de
sélectivité pour les avantages, meilleurs investissements,
incitation à l’efficacité, etc.). Nous nous concentrerons donc
sur une question: d’où doivent venir les moyens de demain:
• Les cotisations sociales doivent-elles être relevées?
• Les subventions publiques doivent augmenter?
• Faut-il privilégier d’autres sources de nancement, comme le
financement alternatif (notamment des revenus des impôts
indirect)?
• Les patients doivent-ils payer des tickets modérateurs plus
élevés?
• Doit-on plutôt opter pour le développement d’un 2ème pilier
(assurances complémentaires collectives par les employeurs)
et/ou d’un 3ème pilier (assurances complémentaires
individuelles pour les soins de santé)?
• D’autres initiatives encore?
1. D’où proviennent les moyens de la sécurité
sociale en Belgique?
Le financement de la sécurité sociale a parcouru un long
chemin depuis sa création après la Seconde guerre mondiale.
La sécurité sociale est née immédiatement après celle-ci
comme un système d’assurance pour travailleurs, en vue de
maintenir leur niveau de vie lors d’imprévus sociaux (maladie,
Jos Kesenne, Collaborateur de la Direction ANMC
Article paru dans la revue ‘Gids voor maatschappelijk gebied’.
Le financement des dépenses de santé en Belgique
Dépenses de santé
3
MC-Informations 250 • décembre 2012

chômage, pension, accident de travail, etc.). Dans les années
’60, le système a progressivement été élargi aux indépendants
et aujourd’hui, près de 99% de la population sont couverts par
le système d’assurance social.
La principale source de revenus a toujours été les cotisations
sociales des travailleurs et des employeurs. Celles-ci sont
calculées sur le salaire brut et représentent pour les employés
un peu plus du tiers du coût total du travail (= salaire brut +
cotisations employeur). Dans les moyens globaux de la sécurité
sociale, leur poids est de 60 à 70%.
La deuxième plus importante source de revenus était, jusqu’au
tournant du siècle, les subventions des autorités. Elles étaient
fixées sous forme de loi (et adaptées sous forme de règlement)
et ont varié de 1950 à 1973 entre 20 et 25 % des moyens
globaux. Dans la période succédant à la crise pétrolière (1973-
1985), les cotisations sociales ont baissé sous la pression de
la crise économique et, en compensation, les subventions
des autorités ont augmenté. Par la suite, ces dernières, par
nécessité d’assainissement des finances publiques (norme de
Maastricht), ont de nouveau perdu en importance pour revenir
à une part tout juste supérieure à 10%. Les cotisations sociales
les ont à nouveau compensées durant cette période. Mais les
subventions publiques continuent à jouer un rôle clé dans la
sécurité sociale, surtout ces dernières années.
Entre 1950 et 1995, les cotisations sociales et les subventions
publiques ont généralement représenté de 90 à 95% des moyens.
Depuis 1993, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle forme
de financement de la sécurité sociale, à savoir le financement
alternatif. Il est né sous le signe du taux de chômage structurel
élevé en Belgique dans les années ’80 et ’90. On espérait
en effet doper l’emploi en abaissant les cotisations des
employeurs. Sur cette période, les cotisations sociales ont
perdu en importance, passant de 75% à tout juste 60%. En
2011, le financement alternatif représentait 20% des moyens
de la sécurité sociale, essentiellement à partir des revenus de
la TVA. Il existe également des prélèvements plus modestes sur
les actions et d’autres produits financiers.
2. Et d’où viennent les moyens de l’assurance
maladie?
Jusqu’en 1994, les différentes branches de la sécurité sociale
disposaient d’un financement distinct, avec des pourcentages
de cotisations et de subventions différents pour chacune.
L’année 1995 a vu l’introduction d’une gestion globale des
moyens, où toutes les cotisations et subventions étaient
collectées dans un pot commun, avant d’être réparties dans les
diverses branches en fonction des besoins.
La part principale des moyens de la gestion globale de la sécurité
sociale dans l’assurance maladie (environ 75% des moyens de
cette dernière) provient à 62% des cotisations sociales, à 14%
des subventions publiques et à 18% du financement alternatif.
Si nous appliquons ces pourcentages aux 75% susmentionnés,
nous parvenons au résultat suivant : 47 % proviennent des
cotisations sociales, 11% des subventions publiques et 13 %
du financement alternatif.
Outre les cotisations sociales via la gestion globale, nous avons
également les cotisations sociales à l’assurance maladie des
pensionnés (3,55 % sur la pension légale et extra-légale ;
uniquement à partir d’un certain niveau de revenus). Elles
représentent environ 3% des moyens de l’assurance maladie.
Avec les 47 % des travailleurs salariés et indépendants,
cela signifie que 50 % des moyens de l’assurance maladie
proviennent des cotisations sociales.
Ces rapports globaux dans le financement de la sécurité
sociale et de l’assurance maladie nous donne l’image suivante
à propos de l’origine des moyens de l’assurance maladie: 50
% proviennent des cotisations sociales, 11 % des subventions
publiques et 29 % du financement alternatif. Au total, cela
représente 90% des moyens. S’y ajoutent d’autres sources de
financement (transferts de rééducation, taxe sur l’assurance
auto, assurance hospitalisation, précompte sur l’industrie
pharmaceutique, conventions internationales), qui assurent
ensemble 10% des moyens de l’assurance maladie. L’image
est ainsi complète.
Avec 40% des moyens de financement de l’assurance maladie
provenant d’impôts directs ou indirects, nous pouvons parler
sans exagérer d’une tendance à la fiscalisation du financement
de l’assurance maladie. Cette tendance ne peut pas être
qualifiée d’incongrue dans un pays où le système de protection
sociale des soins de santé progresse beaucoup plus rapidement
que la richesse du pays.
3. Comment doit évoluer à l’avenir le financement
des soins de santé ?
3.1. Augmenter les cotisations sociales ?
Alors qu’à plusieurs reprises le gouvernement a pris des
mesures pour réduire les charges patronales ONSS en vue
de réduire le coût du travail et de stimuler ainsi l’emploi, il
serait inopportun d’augmenter les cotisations pour la sécurité
sociale. Le problème de la compétitivité de nos entreprises et
l’importance du coût salarial à cet égard est bien connu. Une
récente étude du laboratoire d’idées VKW-Metena a une fois
de plus mis le doigt sur la plaie : en 2011, le coût absolu du
travail en Belgique était de 42% plus élevé que le coût moyen
de la zone euro, et de 30% supérieur à celui de l’Allemagne,
locomotive de la croissance économique en Europe. Même
si cette étude n’était que partielle, cela pose tout de même
un véritable problème. En outre, l’argument souvent invoqué
4MC-Informations 250 • décembre 2012

de notre productivité élevée a été quelque peu démenti entre
temps, puisque force est de constater que ces derniers temps,
notre productivité croît moins rapidement que dans le reste de
l’Europe. Nous n’invoquerons pas ici le coût salarial pratiqué
sur les autres continents, dans cette vague de mondialisation.
3.2. Davantage de subsides de l’État ?
Historiquement parlant, les subsides de l’État ont toujours joué
un rôle important dans le financement de la sécurité sociale et
de l’assurance maladie, en mettant des moyens à la disposition
des allocataires sociaux qui ne peuvent pas contribuer en
raison de leur niveau de revenus trop faible. Aujourd’hui, ces
moyens font partie de la gestion globale de la sécurité sociale
et les pouvoirs publics jouent en outre le rôle de clé de voute
financière au niveau de la sécurité sociale.
Les pouvoirs publics fédéraux ont certes l’intention de continuer
à jouer ce rôle, mais avec une dette publique s’élevant à 100%
du PIB, la marge de manœuvre des pouvoirs publics belges
risque de devenir très étroite. Tout dépend de la croissance
du PIB et du taux d’intérêt à long terme pratiqué au cours des
prochaines décennies. Chaque augmentation des subsides de
l’État à l’assurance maladie entrera en concurrence avec les
autres branches de la sécurité sociale et les autres dépenses
publiques fédérales (sécurité, défense, justice, etc).
3.3. Davantage de nancement alternatif ?
Alors qu’au siècle dernier, les moyens de l’assurance maladie
se composaient principalement des cotisations sociales et des
subsides de l’État, le financement alternatif, principalement les
recettes provenant de la TVA, ont pris une place de plus en
plus importante au cours du 21ème siècle. Augmenter encore
davantage ce nancement alternatif est loin d’être évident.
Augmenter les recettes provenant de la TVA signifie que les
travailleurs salariés et les allocataires sociaux doivent payer
davantage pour les produits et services qu’ils achètent.
Le pouvoir d’achat de leurs indemnités diminuera donc, ce
qui correspond à des indemnités nettes inférieures. Ceci ne
peut en aucun cas être l’objectif. Les impôts indirects sur la
consommation sont de par leur nature moins solidaires que les
cotisations sociales ou les impôts sur les revenus.
Un autre type de nancement alternatif pourrait être un impôt
environnemental, par ex. sur l’utilisation de carburants fossiles
et autres activités polluantes.
3.4. Des tickets-modérateurs plus élevés ?
Pour justifier les tickets-modérateurs, on invoque le fait qu’il faut
responsabiliser le patient en ce qui concerne la consommation
des soins de santé. Toutefois, en matière de soins de santé,
la plupart des décisions, et en particulier les plus coûteuses,
sont prises par les médecins et non par les patients. Étant
donné que dans le cadre des soins de santé en Belgique, les
patients supportent déjà autour de 25% des coûts des soins par
le biais de tickets modérateurs, de médicaments et matériel
non remboursés, etc., il ne serait pas souhaitable d’augmenter
encore les tickets-modérateurs pour le patient.
3.5. Un 2ème et 3ème pilier dans les soins de santé ?
Comme dans la plupart des pays européens, les 2ème et 3ème
piliers sont déjà une réalité en Belgique dans le secteur des
soins de santé, offrant ainsi aux assurés davantage de flexibilité
et de possibilités de choix, en sus de l’assurance maladie
obligatoire. Les assurances privées complémentaires, qu’elles
soient collectives ou individuelles, conclues dans le cadre des
2ème et 3ème piliers, sont estimées à 1,5 milliard d’euros, ce
qui correspond environ à 4% des dépenses totales des soins de
santé en Belgique.
Même si on connaît une croissance dans les 2ème et 3ème
piliers des soins de santé, il est certain qu’une extension de ces
piliers dans l’assurance maladie est moins évidente que dans le
secteur des pensions.
Dans nos pays occidentaux, on accepte généralement les
différences de revenus, même si on estime qu’elles doivent
rester raisonnables. Ainsi, les super bonus accordés aux
chefs d’entreprise licenciés ou passant d’une entreprise à
l’autre, sont toujours accueillis de façon très critique, mais
des fourchettes allant de 1 à 6 au niveau des salaires et des
rémunérations en fonction des diplômes, des compétences, des
responsabilités, de l’âge, de l’expérience, etc. sont acceptées.
Il n’est pas anormal qu’un chef d’entreprise gagne plusieurs fois
le salaire de l’employé ou de l’ouvrier le moins bien rémunéré
dans une entreprise. Ces différences se retrouvent également,
dans la même proportion, au niveau des pensions, surtout en
raison des assurances groupe et autres systèmes de pension
complémentaire. Ceci est en général accepté.
Par contre, le fait que certaines catégories de personnes,
à faible revenu, n’aient bientôt plus accès à une partie sans
cesse plus grande de la médecine moderne n’est pas du tout
accepté. Dans nos sociétés démocratiques européennes, on
n’accepte pas que la couverture sociale obligatoire en soins
de santé devienne de plus en plus incomplète, entraînant
5
MC-Informations 250 • décembre 2012
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%