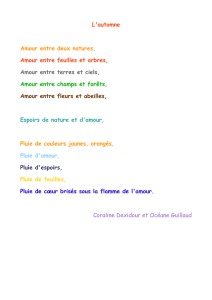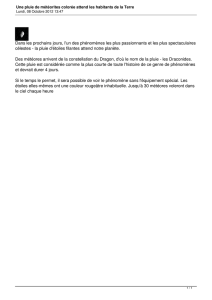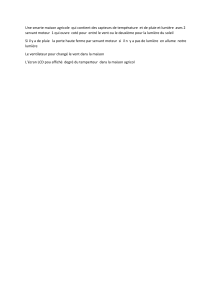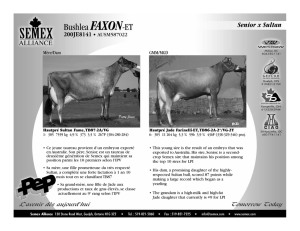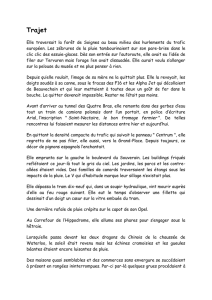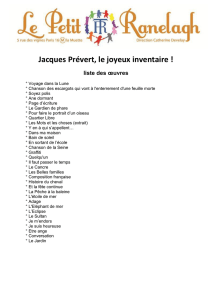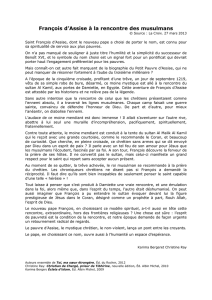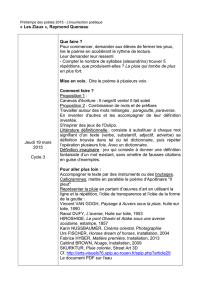Morts par asphyxie - Centre Jacques Berque

Les rites de pluie et le champ politico-religieux
au Maroc du XIXe siècle : Quand la pluie tue le sultan
Jillali El Adnani
Les Études et Éssais du Centre Jacques Berque
N° 1 - janvier 2011
Rabat (Maroc)

1
Les rites de pluie et le champ politico-religieux
au Maroc du XIXe siècle : quand la pluie tue le sultan
Jillali El Adnani
ﺺﺨﻠﻣ
ﻲﻨﻳﺪﻟا لﺎﺠﻤﻟا و ﺮﻄﻤﻟا سﻮﻘﻃ- ﺮﺸﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟا نﺮﻘﻟا بﺮﻐﻣ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا :ﻞﺘﻘﻳ ﻦﻴﺣ نﺎﻄﻠﺴﻟا ﺮﻄﻤﻟا
ﻲﻧﺎﻧﺪﻌﻟا ﻲﻟﻼﻴﺠﻟا
ا و ﺮﺤﺴﻟا لﺎﺠﻣ ﻞﻜﺷ ﺪﻘﻟ بﺮﻋ تﺎﻴﺋﺎﻨﺘﻠﻟ ﺎﻳﺪﻐﻣ اﺪﻓار ﺲﻘﻄﻟ/ﻲﺴآوﺪﺛرأ ،ﺮﺑﺮﺑ / وأ ﻲﻴﺒﻌﺷ
ﺔﻠﻴﺒﻘﻟا ﺔﻄﻠﺳ و نﺰﺨﻤﻟا ﺔﻄﻠﺳ ﻦﻴﺑ ضرﺎﻌﺘﻠﻟ . حﺮﻄﻟا اﺬه ﺔﺷﺎﺸه لوﺎﻨﺘﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬه ﻲﻨﻌﺗ
ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﻲﻔﻈﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺐﺨﻨﻟا و ءﺎﻤﻠﻌﻟا جرﺎﺧ ﻦﻣ ﺎﻓاﺮﻃأ نأ ﻒﻴآ نﺎﻴﺒﺗ ﻮه ﺎﻬﻓﺪه نأ ﺎﻤآ
نﺰﺨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺴﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ .ﺎﺣ ﻮه ﻚﻟذ ﺮﻄﻤﻟا و ءﺎﻘﺴﺘﺳﻹا ةﻼﺼﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا سﻮﻘﻄﻟا ل
ﻲﻤﺳﺮﻟا بﺎﻄﺨﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻏﺎﻴﺻ ةدﺎﻋإ و ﺎﻬﻠﻳوﺄﺗ ﻢﺗ ﻲﺘﻟا . ﻞﺒﻘﺗ ﻻ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا نأ ﻒﻴآ ىﺮﻨﺳو
ﺔﻴﺤﻀﺘﻠﻟ ﻩداﺪﻌﺘﺳا ﻦﻠﻌﻳ نﺎﻄﻠﺴﻟا نأ ﻦﻴﺣ ﻲﻓ ﻒﻄﻠﺑ ﻞﻣﺎﻌﺘﻳ ﻻ و ﻒﻴﻨﻋ و مزﺎﺣ نﺎﻄﻠﺴﺑ ﻻإ
ءﺎﻘﺴﺘﺳﻹا ةﻼﺼﻟ ﻪﺘﻳدﺄﺘﺑ ﻪﺴﻔﻨﺑ . ﻋ ﺪآﺆﻳ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﻮهو ﺖﻨﺒﺗ ﻲﺘﻟا ﺎﻓاﺮﻏﻮﻄﺳﻹا نأ ﻰﻠ
و نﺎﻄﻠﺴﻟا و ﺔﻠﻴﺒﻘﻟا ﻦﻴﺑ عاﺮﺼﻟا ﻢﻬﻓ ﻲﻓ ﺎﻧﺪﻴﻔﺗ نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻞﺘﻘﻳ يﺬﻟا ﺮﻄﻤﻟا ةرﻮﻄﺳأ
و ﺔﺿرﺎﻌﺘﻣ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ وﺪﺒﺗ ضاﺮﻏﻷ حﻼﺴﻟا ﺲﻔﻧ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗ فاﺮﻃﻷا ﻩﺬه نأ ﻰﻠﻋ لﻮﻘﻟاﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ.
Résumé
Le domaine de la magie et du mythe a souvent nourri la dualité arabe/berbère, orthodoxie/culture
populaire ou encore pouvoir mahkzen et société tribale. Cette étude traite de la fragilité de ces oppositions.
Nous avons tenté de montrer à quel point la légitimité du pouvoir politique n’est pas souvent une affaire de
savants et d’élites. Elle peut être accordée au sultan par le biais de rites populaires réinterprétés et admis dans
le discours officiel. On verra qu’il s’agit dans cet article de tribus qui réclament un pouvoir ferme face à un
sultan qui est prêt à se sacrifier pour le bien de ses sujets en accomplissant la prière de la pluie. C’est dire
combien ce mythe introduit et utilisé par l’historiographie officielle montre que les protagonistes peuvent
manier les mêmes armes pour des fins qui paraissent à la fois contradictoires et complémentaires.
Mots-clefs : Maroc, légitimité, historiographie, makhzen, tribu, confrérie, magie, rites populaires, rite de pluie
Sommaire
Les rapports entre les tribus et le makhzen d’après l’historiographie marocaine du XIXe siècle ............................3
Le Kitâb al-Ibtissâm ........................................................................................................................................3
L’œuvre d’Akansûs ou la gouvernance par le « mal » .................................................................................4
L’œuvre d’al-Nâsirî ou la gouvernance par le « bien » ................................................................................7
Rites de pluie : magie, orthodoxie et légitimation politique.........................................................................................8
La prière de la pluie : faveurs et châtiments.................................................................................................8
La pluie, la baraka et le sultan : une autre facette de la légitimation.........................................................9
Conclusion ................................................................... ................................................................................................... 11

2
Les rites de pluie et le champ politico-religieux
au Maroc du XIXe siècle : quand la pluie tue le sultan
Jillali El Adnani*
professeur d’histoire
Université Mohamed V, Rabat-Agdal
« Nous sommes, la seule tribu au monde qui descende du ciel. Le ciel
fait partie des montagnes. Chez nous la pluie ne tombe pas, elle monte »,
Ahmed Abodehman (romancier saoudien), La Ceinture, Paris, Gallimard, 2000,
141 p.
En dehors de l’intérêt accordé à la question
de la pluie et des rites qui l'accompagnent par les
ethnographes coloniaux, rares sont les recherches
qui ont traité de la problématique liée aux tensions
et aux compromis entre les tribus et le makhzen à
partir de ces mêmes rites. Pourtant l'historien
Mohammed El Bazzaz a consacré, au cours de la
dernière décennie, une étude aux famines et aux
épidémies dans l'histoire du Maroc, de même que
Nicolas Michel a pu mettre l’accent sur une
« économie de subsistances dans le Maroc pré-
colonial » en s'appuyant sur un riche ensemble de
données mais qui, comme le rappelle l’auteur,
posent problème pour le regard et les
reconstitutions de l'historien1. Ce travail tentera
donc une étude de ce phénomène mais en
s´appuyant sur la relation entre ciel et terre et
surtout sur un type de magie qui renvoie à la
succession de la sécheresse, de la pluie et du
pouvoir politico-religieux. C´est dire que les
oppositions classiques entre pays makhzen et pays
de l´anarchie ou encore entre la plaine et la
montagne ne seront pas souvent prises en compte.
La priorité sera donc donnée à cette alliance entre
le sacré et le profane (baraka et violence) qui a pu
souvent venir en aide à un pouvoir politique en
* Je tiens à remercier B. Dennerlein du Zentrum moderner
Orient (ZMO) à Berlin, M. Naciri et A. Sebti pour leurs
précieuses suggestions et remarques.
1 M. El Amin El Bezzaz, Tarikh al-maja´at w al-awbia bi al-
Maghrib, Rabat, faculté des Lettres et des sciences humaines,
1992
N. Michel, Une économie de subsistance, le Maroc pré-colonial, Le
Caire, IFAO, 1997, 2 vols.
proie à des difficultés internes et auxquelles les
textes sacrés ne trouvent pas de remède.
Notre connaissance actuelle est loin de
cerner les questions liées au flux et au reflux du
pouvoir du makhzen et des tribus sous l'effet de
l'abondance et de la rareté des pluies. Le pouvoir du
sultan se rétrécit au cours des saisons pluvieuses
quand la tribu est « rassasiée » et peut entrer en
révolte, sinon c'est le sultan qui soumet le pays en
« mangeant » les tribus affamées2. Faut-il donc se
fier à l'historiographie marocaine qui s'est accordée
sur un consensus plaidant pour une expression
devenue célèbre : « le sultan qui grâce à la famine et
la sécheresse arrive à soumettre le pays ? ». Ne s'agit-
il pas là d'une règle qui ne s'applique qu'aux
moments de crises ? Sinon, quels sont les enjeux et
les mécanismes d'un équilibre au niveau des
rapports entre les tribus et le makhzen ? Enfin,
peut-on parler d'une histoire marocaine faite d’une
incessante succession de périodes de paix et de
périodes de révoltes ? Autrement dit, dans quelle
mesure peut-on considérer une historiographie,
largement préoccupée par l’enregistrement des
révoltes, des sécheresses et des famines, comme le
reflet de la situation d'un pouvoir makhzenien
toujours en proie à sa tendance dominatrice et d’un
pouvoir tribal souvent à la recherche d'une
« autonomie » ? C'est à partir de cette vision
2 R. Jamous, Honneur et Baraka, les structures traditionnelles dans le
Rif, Paris, MSH, 1981, p. 226. L´expression du sultan qui
mange les tribus a été rapportée par les chroniqueurs
marocains et aussi par les lettres sultaniennes (information
fournie par A. Sebti).

3
historienne et anthropologique que cette étude
tentera de retrouver les lacunes, les divergences et
les convergences qui ont souvent rendu difficile
l'étude de la relation tribus/makhzen. C'est
pourquoi on a choisi de traiter des rites pour
obtenir la pluie et des constructions
hagiographiques à partir de plusieurs textes
historiques du XIXe siècle dont les conditions et les
motifs de rédaction sont aussi ceux qui ont
engendré les frustrations, les espoirs et les mythes
de cette époque. On commencera par introduire le
lecteur dans cette historiographie avant de passer
en revue les fondements et les fonctions du mythe
de la pluie qui tue le sultan. Le but de cette étude
est aussi de savoir pourquoi ce mythe de la pluie
relatif au pouvoir politique n’est apparu que dans
la deuxième moitié du XIXe alors qu’au XVIIe déjà
les élèves refusent de suivre le cours d’exégèse d’al-
Ifrânî (m. 1727) parce que, disent-ils, chaque fois
qu’on l’enseigne survient la sécheresse3 comme si
certains mythes manifestaient la crise du savoir et
d’autres celle du pouvoir politique. Ainsi, le mythe
de la pluie dont il sera question sera aussi
l’occasion de vérifier à quel point le makhzen, la
tribu et les savants partageaient les mêmes soucis
vis-à-vis de la pratique politique, et de voir
combien les interprétations des légendes par les
anthropologues pour prouver la marginalité des
tribus (E. Gellner) sont loin de la réalité historique.
Ce travail tentera aussi de montrer la
fonctionnalité du mythe de la pluie qui nous
montre par quels moyens le pouvoir politique se
reproduisait et aussi comment l´anarchie alimente
le processus de la stabilité et de la légitimation.
Les rapports entre les tribus et le
makhzen d’après l’historiographie
marocaine du XIXe siècle
L’historiographie de même que
l’hagiographie et la généalogie faisaient partie des
sciences non enseignées dans les écoles mais qui
étaient surtout le fait du pouvoir central et des
grandes familles détentrices du savoir et de la
baraka. Parmi les écrits auxquels on aura recours
dans cette étude il y a le kitâb al-Ibtissâm, écrit par
un auteur anonyme, le Jaysh al-‘Aramram d’Akansûs
3 A. Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme
marocain (1830-1912), Paris, F. Maspero, 1980, 481 p., p. 198,
note 17 (d’après I. Ibrahim, al-I’lâm biman halla bi
Marrakech w Aghmât mina al-A’lâm, (Identifier les
personnages célèbres qui ont séjourné à Marrkech et
Aghmât), Fès, Imprimerie al-Jadida, 1936-1939, t. V, p. 394
et le kitâb al-Istiqsâ d’al-Nâsirî. Ces trois écrits ont
tous été rédigés après les temps des grandes crises
notamment les défaites militaires de l’armée
marocaine d’abord face aux tribus du moyen Atlas
entre 1818 et 1822 puis à Isly en 1844 et enfin à
Tétouan en 1860. Cette prolifération des écrits et
des pamphlets relatifs au contact avec les Européens
a été suivie aussi d’une augmentation du nombre des
devins et des majdûbs dont celui qui s’était adressé au
sultan Muhammed IV alors qu’il s’apprêtait à aller à
Oujda pour faire face à l’armée française en 1844, et
lui avait dit : « Va plutôt à Tétouan » faisant allusion
à la guerre contre l’Espagne qui devait avoir lieu en
18604. Quels sont donc les apports de ces écrits sur
la question du rapport entre tribus et makhzen et
entre celui-ci et les forces européennes ? De même
quelles sont les attitudes de ces historiens vis-à-vis
du mythe de la pluie qui tue le sultan ?
Le Kitâb al-Ibtissâm
On a commencé par l’œuvre de l’auteur
anonyme, qui est un secrétaire de la cour sultanienne
(et un disciple de la tarîqa Darqâwiyya), dont
l’identification est en cours, pour des raisons
strictement chronologiques et aussi du fait qu’il est
le premier historiographe à rapporter le mythe de la
pluie qui tue le sultan, qu’on ne trouve que sous
forme de bribes dans les autres écrits. Il faut dire
aussi que cet écrit est l’un des premiers à mettre
l’accent sur les réformes militaires et surtout sur les
changements survenus en Orient et précisément en
Egypte où il connaît l’œuvre de Muhammed ‘Ali5.
Cet écrit donne des détails précis sur l’armée
marocaine au moment même où les réformes
s’imposaient.
Dans l’historiographie marocaine, la faim
était considérée, on l’a vu, comme une arme secrète
du sultan. L’auteur anonyme d’al-Ibtissâm disait de la
famine de 1824 : « Ce fut un grand bienfait, car les
tribus, du Souss à Oujda, étaient devenues
insolentes. Après sept ans de désordre, Dieu fit
rentrer, par ce moyen, tout le monde dans
l’obéissance6 ». Le même auteur dit par ailleurs que
la mort de M. ´Abd al-Rahman en 1859 est survenue
à la suite de la participation du sultan à la prière de
l´Istisqsâ comme si le sultan n'avait pas le droit de
réaliser le bien pour ses sujets et que le bien accordé
par la volonté divine et la bénédiction du sultan était
4 A. Laroui, op. cit., p. 224
5 Anonyme, al-Ibtissâm, mss Bibliothèque royale, H 114, p. 78.
6 A. Laroui, op. cit., p.122.

4
contraire à la stabilité politique du souverain7. Mais
il faut dire que les années de sécheresse qui étaient
survenues par hasard après le traité de 1856 avec
les Anglais, furent considérées comme le résultat
néfaste du contact avec les Européens. Cette pluie
qui tue le sultan n'est autre que celle qui renforce la
tribu. L’idée est confirmée par cette croyance des
gens du Souss qui prédisaient la fin du règne d’un
sultan s’il osait entrer dans le territoire des tribus et
surtout s’il traversait le fleuve Souss8.
L'auteur d'al-Ibtissâm était attentif aux
menaces et aux croyances qu’exprimaient les gens
du commun. Tout se passe comme si le point de
vue de l’auteur d'al-Ibtissâm relevait d'un amalgame
entre une hagiographie apocalyptique et une
astrologie maléfique9. Cependant l’auteur avait
rapporté dans son ouvrage toute une série d’adages
sur les fondements du pouvoir politique tel que l’a
décrit Aristote : « Le monde est un jardin dont le
fondement est l’Etat, celui-ci s’appuie sur la sunna
dont le soutien est le pouvoir politique, qui dépend
de l’armée, qui exige de l’argent dont la source est
le peuple, lequel a besoin de justice, qui est le pivot
du monde, qui est un jardin… » Cette
« circularité » grecque devait être reprise quelques
années plus tard par l’historien Akansûs alors que
le makhzen était en crise politique et militaire.
Si l’œuvre d’al-Ibtissâm, écrite sans doute
sans autorisation sultanienne, a exprimé avec plus
de liberté les opinions de son auteur qui a voulu
7 Anonyme, al-Ibtissâm, p. 214
8 Viviane Pâques rapporte que : « C´est pourquoi
actuellement encore aucun souverain ne peut entrer
officiellement dans Ouezzane car deux rois ne peuvent se
trouver ensemble dans un même lieu ». Voir V. Pâques, La
religion des esclaves, recherches sur la confrérie marocaine des Gnawa,
Bergamo, Moretti et Vitale éditions, 1991, 329 p., p. 40.
9 C’est aussi la vision de Muhammed al-Mashrafî qui a écrit
que Mawlây Sulaymân avait été destitué parce qu’il était le
sixième de la dynastie alawite tout comme M. al-Hassan
descendant d'`Ali, le sixième élu après le Prophète, ou encore
al-Walîd b. ‘Abd al-Malik, le sixième prince de la dynastie des
Umayyades. Voir M. al-Mashrafî, al-Hulal al-Bahiyya,
Bibliothèque nationale, Rabat, 1463D, p. 190. D'autre part,
Marc-Antoine Pérouse de Mont-Clos parle quant à lui de
rites de pluie intégrés au dhikr soufi : « Chez les nomades du
Somaliland, la danse jenile qui célébrait le dieu Wak lors des
célébrations zar a, par exemple, été incorporée dans les
cérémonies dikr des confréries ». Voir « NGOs in a country
without government : Islamic Movements and Aspirations to
Replace the State in War-torn Somalia », in Ben Néfissa,
Sarah et al. (ed.), NGOs and Governance in the Arab World,
Cairo, The American University in Cairo Press, 2005, pp.
291-310.
garder l’anonymat, celle d’Akansûs le Jaysh a été
écrite à la demande du sultan Muhammed IV (m.
1873). Ce qui nous incitera à nous étendre
davantage sur cet écrit dont l’auteur avait été témoin
du règne de quatre sultans10.
L’œuvre d’Akansûs ou la gouvernance par le
« mal »
L'historien tijânî Akansûs, qui est arrivé à
Fès en 1229H/1813 et a fait ses études à la
Qarawiyyîn, est devenu ministre du sultan Mawlây
Sulaymân vers 1822. C’est après son éviction par
Mawlây ‘Abd al-Rahmân, la même année
qu’Akansûs s’affilia à la confrérie Tijâniyya auprès
de Muhammad al-Ghâlî11, soit en 1822-3.
Soupçonné de comploter en faveur du sultan
Mawlây Brahîm (fils du sultan M. Sulaymân) qui
avait été investi par un serment d’allégeance, bay'a,
rédigé par Mohammed al-Yâzghî et signé par
certains tijânîs comme ‘Abd al-Salâm al-Azamî12,
Akansûs a donc été éloigné de l'entourage du
makhzen.
C’est à la suite d’une demande écrite du
sultan Muhammed IV13 et sur ordre de son ministre
sîdî al-Yamânî Bû‘ashrîn, qu'Akansûs rédigea son
ouvrage en 1866, soit sept ans après le « désastre de
Tétouan14 » en 1859-1860, et après l’intronisation
de Muhammed IV en 185915. La rédaction du Jaysh
est en quelque sorte une tentative de rendre son
éclat à la puissance du sultan, qui avait été « dévoilée
par son attitude » fébrile devant l'armée espagnole,
et aussi, comme on va le voir, de dénoncer les
coupables et de montrer du doigt les « indécents ».
Le jugement d’Akansûs suit le schéma que la plupart
des historiens traçaient et qui consistait à épargner le
sultan, sujet sacré et objet de vénération, et à
s’attaquer aux « forces du mal » : les chefs de l’armée
10 En effet Akansûs a participé à la vie politique du règne de
Mawlây Sulaymân (m. 1822), de M. ‘Abd al-Rahmân (m. 1859),
de M. Muhammed IV (m. 1873) et de M. al-Hasan I (m. 1893).
11 Muhammed al-Ghâlî sera expulsé par le fondateur de la
Tijâniyya vers la Mecque et c'est au cours de son séjour au
Hijâz qu'il a donné le wird tijânî au grand introducteur et
fondateur d'un empire en Afrique de l'Ouest, le fameux al-Hâjj
'Umar (m. 1864).
12 Voir le texte de cette bay'a à la bibliothèque royale, mss. n°
12452, pp. 98-106.
13 M. Mennouni, al-Masâdir al-‘arabiyya li târîkh al-maghrib, Rabat,
publications de la faculté des lettres et des sciences humaines,
1989, p. 93.
14 C’est ainsi que al-Nâsirî, auteur d’al-Istiqsâ, appelle la guerre
de Tétouan de 1860.
15 Cette défaite était considérée comme une première défaite
honteuse par l’auteur d’al-Hulal, p. 213.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%