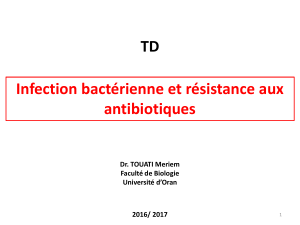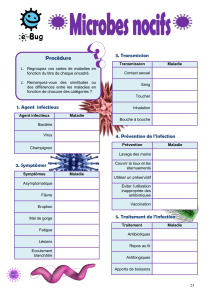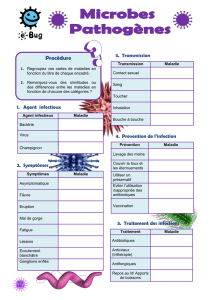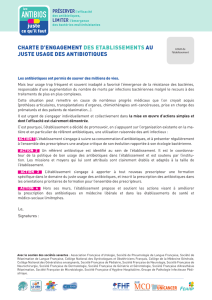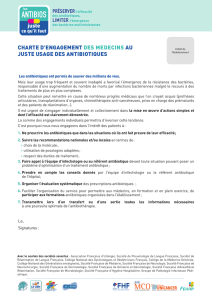Antibiotiques : après l`espoir et les succès, la banalisation, l`impasse

Éditorial
WWWREVMEDCH
octobre 1691
Antibiotiques après l’espoir
et les succès la banalisation
l’impasse et les dangers
Dr GÉRARD PRAZ et Pr NICOLAS TROILLET
Abuse of penicillin… A lavish dispensation of the
drug « for all patients with fever and for most of
those in whom fever or infection might be antici-
pated, irrespective of any possible benefit that
could reasonably be expected from it uses » (N
Engl J Med 1945)
La découverte de la pénicilline a modifié
l’histoire de la médecine et celle de l’humanité
toute entière. Les premiers succès furent
remportés sur les champs de bataille de la
Seconde Guerre mondiale où des milliers de
blessés eurent la vie sauve grâce à elle. Un
«remède miracle» était né. Des patients souf-
frant d’infections graves et sou-
vent mortelles guérissaient.
Durant plus de 50 ans, les anti-
biotiques ont connu une évolu-
tion constante et contribué de
façon déterminante aux progrès
de la médecine dans tous les
domai nes. Que seraient par exemple sans eux
la chirurgie, l’oncologie ou l’immunologie,
disciplines dont les trai tements, certes très
ef ficaces, rendent toutefois les patients vul-
nérables à des infections potentiellement
mortelles? Ainsi, la mortalité des septicémies
à Pseudomonas lors de neutropénies surve-
nant chez des patients traités pour leucémie
aiguë est passée de 100 à 25% avec l’arrivée
de la première substance ef ficace contre ce
micro-organisme dans les années 70.
Dès le début, l’utilisation des antibiotiques a
été banalisée. Bien que des médecins mili-
taires se soient très tôt insurgés contre la
«pénicillinisation de la population», les pres-
criptions ont continué de croître, notamment
parce que le corps médical comptait sur l’in-
dustrie pharmaceutique pour produire régu-
lièrement de nouvelles substances. Mais aux
nouveaux antibiotiques succédaient de nou-
velles résistances. Suite à l’absence de nou-
velles substances depuis 20 ans et à l’appa-
rition de nombreux micro-organismes résis-
tants sans liens avec les soins hospitaliers, la
résistance aux antibiotiques est devenue un
problème de santé publique prioritaire auquel
personne n’échappe. En Suisse, avec un certain
retard sur d’autres pays, le Conseil fédéral a
récemment élaboré un projet global dénom-
mé Stratégie Antibiorésistance (StAR), visant à
garantir l’efficacité des antibiotiques à long
terme pour le maintien de la santé humaine
et animale. Il prévoit notamment une restric-
tion et un contrôle de leur prescription. La
contribution du corps médical,
qui peut agir par plusieurs moyens,
est essentielle.
Sensibilisation des patients
L’efficacité des antibiotiques est
surestimée et leurs effets indési-
rables sous-estimés, voire occul-
tés. Les éléments suivants doivent être inté-
grés dans la décision partagée avec le patient
de prescrire ou non un antibiotique:
1. Les infections banales des voies aériennes
supérieures sont l’une des raisons les plus
fréquentes à l’origine d’une antibiothérapie.
Il est pourtant démontré que son effet n’est
pas supérieur à un placebo.
2. Les effets indésirables ne sont souvent pas
rapportés dans les études cliniques. Les anti-
biotiques représentent néanmoins 20% des
médicaments responsables de consultations
aux urgences pour des effets indésirables.
3. Quelques jours d’antibiotiques provo quent
une colonisation durable ( jusqu’à une année
ou plus) par des germes résistants.
4. Ceux-ci se propagent rapidement dans l’en-
tou rage et l’environnement et peuvent toucher
l’ensemble de la planète en quelques mois.
5. La colite à Clostridium difficile, autre com-
plication de l’antibiothérapie, est de plus en
Articles publiés
sous la direction de
GÉRARD PRAZ
Médecin-chef,
Service des maladies
infectieuses
NICOLAS TROILLET
Médecin-chef,
Service des maladies
infectieuses
Institut Central des
Hôpitaux, Hôpital du
Valais, Sion
DèS LE DÉbuT,
L’uTILISATION
DES ANTIbIO-
TIquES A ÉTÉ
bANALISÉE

REVUE MÉDICALE SUISSE
WWW.REVMED.CH
12 octobre 2016
1692
plus fréquente dans la communauté, les EMS ou
les hôpitaux et sa morbidité/mortalité est en
constante augmentation.
Mieux diagnostiquer pour mieux (moins)
traiter
En l’absence de signes cliniques de gravité,
bon nombre d’infections fréquentes (voies
aériennes et urinaires) ne nécessitent pas un
traitement immédiat et le diagnostic peut être
affiné par des examens paracliniques (culture,
PCR, biomarqueurs, etc.) dont les résultats
associés à l’évolution clinique seront utiles
pour la décision de traiter ou non. Le coût de
ces examens n’est plus un argument en regard
des surcoûts liés aux résistances, sans compter
leur coût humain. En effet, toujours plus de
patients mourront d’infections intraitables
menaçant les progrès de la médecine.
Rôle des spécialistes et des autorités
Le praticien confronté quotidiennement au
dilemme de prescrire ou non des antibio-
tiques et culpabilisé à chaque prescription
est en droit d’attendre des autorités et des
spécialistes qu’ils élaborent en collaboration
avec les différents intervenants des recom-
mandations pour la pratique clinique qui
soient simples et ne fassent pas courir de
risque aux patients.
La fin de la prescription libre ?
Le succès de la lutte contre la ré-
sistance aux antibiotiques exige
une diminution importante de leur
utilisation. Ceci passera peut-être
par une restriction du droit de
prescription. Certains pays l’ont déjà instau-
ré et le projet StAR le prévoit de même qu’un
contrôle des prescriptions et des mesures
pour ceux d’entre nous qui en effectueraient
plus que la moyenne. Bien que paraissant
extrême et en contradiction avec les habitudes
actuelles, ce moyen pourrait s’avérer le seul
apte à produire un effet positif.
CECI PASSERA
PEuT-êTRE PAR
uNE RESTRICTION
Du DROIT DE
PRESCRIPTION
1
/
2
100%