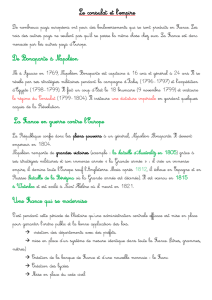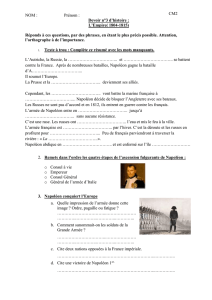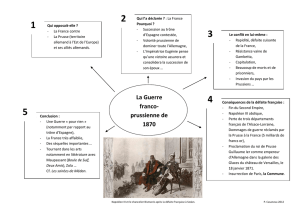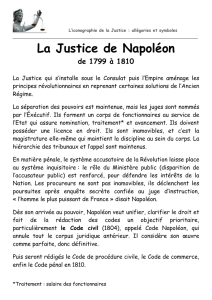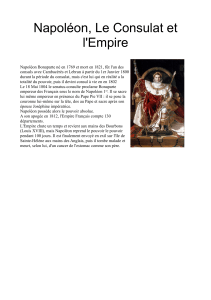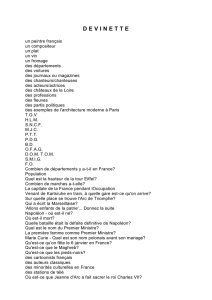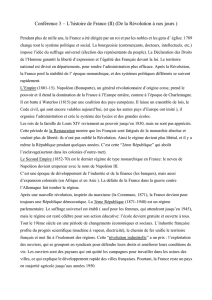Histoire de la guerre 1813 en Allemagne

1
Histoire de la guerre
1813 en Allemagne
PAR
LE LT-COLONEL CHARRAS
DERNIERS JOURS DE LA RETRAITE DE RUSSIE
INSURRECTION DE L’ALLEMAGNE
ARMEMENTS
DIPLOMATIE ENTRE EN CAMPACNE
Cet ouvrage a été téléchargé en format image du site Gallica. Il a été converti en
format texte mais comme il n’a pas vocation d’être édité mais seulement d’être plus
accessible visuellement, veuillez être indulgent s’il y a quelques erreurs grammaticales
et/ou de syntaxe.
LEIPZIG - F. A. BROCKHAUS - 1866

2
Ce livre devait être le monument d'une noble existence, dévouée tout entière à la Patrie,
à l'Humanité. Il demeure incomplet, inachevé, image trop fidèle d'une vie prématurément
tranchée, avant d'avoir pu accomplir toute sa tâche.
La proscription avait brisé l'épée de Charras, entravé son intervention directe dans les
événements contemporains, modifié profondément les conditions de son action politique. Mais
elle n'avait pu lui arracher sa plume ; et, de soldat devenu écrivain, il n'avait pas un seul jour
interrompu la lutte. La mort est venue saisir cette vaillante main, au moment où elle s'apprêtait à
terminer une oeuvre qui devait servir la plus juste des causes, honorer l'homme et le pays. Du
livre, il ne reste qu'un fragment ; de l'homme, un grand exemple et un grand souvenir. C'en est
assez pour faire sentir à la patrie la perte immense qu'elle a faite!
Après nous avoir donné l'histoire définitive, incontestable et, au fond, incontestée de la
campagne de 1815, le colonel Charras voulait remonter à l'origine de nos désastres, en dévoiler la
cause et, par l'évidence de sa démonstration, compléter l'enseignement commencé par son premier
ouvrage. Continuant donc ses patientes recherches avec la résolution inflexible de découvrir la
vérité, autant qu'il serait en lui, et de la dire sans réticences et sans ménagements, il avait réuni,
pièce à pièce, tous les matériaux d'une histoire de la campagne de 1813 en Allemagne. Pour
s'approcher des sources mêmes de l'histoire, il avait appris la langue la plus difficile de l'Europe.
Il avait étudié, contrôlé, tout ce qui a été publié en France, en Allemagne, en Russie, en
Angleterre, sur cette effroyable mêlée des peuples. Il avait réussi, par sa volonté persévérante et
par le concours d'amis dévoués, à forcer les portes des archives les mieux closes. Il avait eu à sa
disposition d'importants documents inédits, notamment la correspondance militaire du général
Bertrand. Il avait consulté plusieurs des survivants des grandes batailles et recueilli leurs
témoignages. Il avait son opinion complètement fixée sur les hommes, sur les faits.
Affranchi des préjugés de nation et des préjugés de métier, dominant par la force de son
esprit et de sa volonté les entraînements de sa propre passion, il voulut être juste pour tous.
Quelles que fussent ses convictions, ses douleurs, ses colères de citoyen, il s'éleva au-dessus de
ses affections et de ses haines et n'écouta que la voix austère de la vérité.
Son amour incorruptible pour la vérité l'a conduit à raconter sans ménagements des faits, à
exprimer des opinions qui contrarient quelquefois les préjugés nationaux, mais non le vrai
patriotisme. Ainsi, il s'est refusé à voir dans Napoléon le représentant armé de la Révolution, c'est-
à-dire de la Justice. Comme Metternich qui lui donnait sa sympathie, comme les patriotes
allemands, espagnols, qui lui vouaient leur haine, il a constamment vu en lui, il a détesté le
promoteur le plus redoutable de la Contre-Révolution. Fortement pénétré de la notion moderne de la
justice qui pose un devoir en regard de chaque droit et qui reconnaît que ce qui est légitime pour un
peuple, pour un citoyen, est légitime pour tous, il n'a pas hésité à déclarer que la France, acceptant
ou subissant le despotisme de Napoléon, et se rendant complice de l'asservissement de l'Europe,
avait, en 1813, le droit contre elle ; que les peuples écrasés, foulés par l'abus de la force, se devaient
de recourir à la force pour s'affranchir ; que l'insurrection contre l'oppresseur était pour eux, selon la
parole des vaillants logiciens de 1793, «le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs».
Cette mâle doctrine, qui fut la règle de la vie de Charras, est aussi la moralité de son livre.
Il l'applique généreusement à l'Europe asservie, comme il la revendique pour la France. Il donne
sans hésitation, sans réserves, ses éloges, son enthousiasme, à la patriotique insurrection de
l'Allemagne ; il la compare au magnanime élan de la France en 1792 ; il la glorifie, avec raison,
comme l'un des actes les plus héroïques qui aient honoré l'humanité et comme une consécration
nouvelle des principes que la France avait eu la faiblesse de déserter, après les avoir proclamés
avec un immortel éclat. Personne encore n'avait raconté avec cette hauteur de vue, cette
connaissance approfondie des faits et cette libérale impartialité, ce mouvement national qui, parti
du peuple, entraîna l'armée, la noblesse, les gouvernements, et renversa l'oppresseur de l'Europe.

3
Le livre du colonel Charras devait embrasser dans son vaste ensemble toute l'histoire
militaire, politique et diplomatique de cette année 1813, l'année la plus tragique du siècle. Mais il
ne donne que l'exposition du drame, et s'arrête à la veille de Lützen.
Incomplet, mutilé, ce récit n'en contient pas moins tout entièrement la pensée de l'historien,
la haute moralité de son livre. En le publiant sans retouche, sans changement d'aucune sorte, avec
l'aide et sous les yeux de celle à qui Charras avait confié cette mission, nous avons la conscience de
remplir un devoir, non seulement envers lui, mais envers sa cause, envers la patrie. Aujourd'hui la
proscription qui poursuit l'œuvre au de-là même de la tombe de l'écrivain, ne permettra pas à la
France de la lire ; mais un jour elle connaîtra ce livre de l'exil, ce livre écrit pour elle, par un de ses
plus dévoués enfants, sous la constante préoccupation de la patrie. Elle y apprendra une fois de plus
à quelles extrémités elle s'était réduite, en s'abandonnant elle-même, en désertant les principes qui,
au début de la Révolution, avaient fait sa force et sa gloire, en abdiquant sa volonté entre les mains
d'un homme. Elle verra ce qu'étaient devenus, sous l'action d'un despotisme sans frein, non
seulement les ressources matérielles du pays, mais ce qui est de plus haut prix, la noblesse et le
ressort des caractères et la véritable gloire de la nation.
Nul ne quittera ce livre sans emporter quelque chose de l'âme de son auteur. Comme jadis
dans sa parole d'un si mâle et si vif accent, les faibles y trouveront un aiguillon, les forts une force
nouvelle. Il s'y est donné tout entier, avec ses qualités natives, avec celles qu'il devait à l'étude.
C'est un livre de foi et de bonne foi, vaillant, sincère, plein d'une ardeur concentrée et d'autant
plus pénétrante.
En vain Charras avait vu les ruines s'amonceler ; en vain il avait vu le triomphe insolent de
la force, la défaite lamentable du Droit et l'abaissement progressif des caractères. Le froid qui
l'entourait ne pouvait l'atteindre. Son attitude invaincue était pour quelques-uns un frein, pour
d'autres une terreur, pour beaucoup un exemple et un encouragement. Il avait une foi raisonnée,
indestructible, dans le triomphe définitif de la justice. Cette foi ne quitta jamais son noble coeur.
Elle l'avait soutenu dans les plus mauvais jours ; elle fut sa force pendant qu'il écrivait cette
histoire, pendant qu'il luttait contre la maladie qui nous l'a enlevé. Il est resté à son poste jusqu'au
bout; la mort, elle-même n'a pu l'en relever, et sa tombe qui, par sa volonté, attend sur la terre
d'exil, continue et confirme la protestation de sa vie.
V. CHAUFFOUR-KESTNER
30 octobre 1865

4
CHAPITRE PREMIER
Retour en Prusse et dans le grand-duché de Varsovie des débris de l'armée
perdue en Russie par Napoléon. - Murat, qui les commande, arrive à
Königsberg. - Ses instructions pour la réunion sur divers points et la
réorganisation des restes des différents corps. - Forces réunies déjà et à réunir
en quelques jours sur Königsberg. - Corps de Macdonald, de Schwarzenberg,
de Reynier. - Oubli qu'en a fait Napoléon. - Erreur dans laquelle il les a
entretenus. - Instructions tardives qui leur sont envoyées. - Leur position, leur
effectif à la fin du mois de décembre 1812. - Confiance, calculs de Murat au
dernier jour de cette année même.
Basée sur cette politique qui n'admettait d'autre droit que la force et n'avait d'autre règle
que l'ambition d'un homme, calculée avec légèreté, engagée sans prévoyance, conduite avec
incurie, poursuivie avec une téméraire obstination, tardivement ramenée, l'expédition dirigée
contre la Russie se terminait en un désastre sans égal.
Opérée par six cent dix mille hommes1, l'invasion de cet empire avait commencé dans les
derniers jours du mois de juin 1812. Jamais dans les temps modernes, et peut-être même dans
les temps anciens, armée si nombreuse n'avait été réunie sous un même chef, et mise en
mouvement pour une même entreprise.
Dans son immense organisation, celle-ci comprenait dix corps d'armée, la garde impériale
française, un corps auxiliaire autrichien et quatre corps de réserve de cavalerie.
Six mois ne s'étaient pas écoulés et elle repassait précipitamment, dans le plus effroyable
désordre, dans la plus affreuse détresse, la frontière russe; elle était réduite de plus de cinq cent
mille hommes perdus par la désertion, enlevés, ramassés par l'ennemi, tués par le fer et le feu, par
la fatigue et le dénuement, par la faim et le froid; elle laissait derrière elle les cadavres de cent
cinquante mille chevaux, un millier de canons et quinze ou vingt mille voitures d'artillerie et
d'équipages. Déjà. Napoléon l'avait quittée, courant à Paris exiger de la France une nouvelle
armée.
En partant, ce funeste artisan du désastre avait imposé à Murat la mission de conduire et
de rallier les débris de tant et de si belles légions. Murat n'avait pu que se mettre à la tête de la
déroute, alors déjà complète2.
Cette longue déroute trouvait enfin un terme comme finissait l'année 1812. L'armée
russe semblait avoir renoncé à la poursuite ; les Cosaques eux-mêmes, ces infatigables coureurs,
avaient disparu. On touchait le sol de la Prusse et du grand-duché de Varsovie ; on y trouvait
des vivres, des abris ; on respirait.
1 Six cent dix mille cinquante-huit hommes, tel est le chiffre exact des officiers, sous-officiers et soldats qui
pénétrèrent, à diverses époques, en Russie. On le trouve dans la remarquable histoire de l'expédition de Russie, par
le général de Chambray. Chambray l'a extrait des situations envoyées au ministre de la guerre par les corps, le jour
de leur entrée en Russie.
2 Dans ses mémoires, où il respecte si peu la vérité quand il est en scène, Napoléon a écrit qu'au moment de son départ «
la garde était entière et que l'armée comptait quatre-vingt mille combattants, sans compter le corps du duc de Tarente
(Macdonald), qui était sur la Dwma. » Or, une situation officielle du 2 décembre prouve que ce jour même, le nombre
des combattants de tous les corps qui étaient avec Napoléon, y compris la garde, ne s'élevait qu'à huit mille huit cent
vingt-trois hommes, marchant plus ou moins en ordre (Voir Chambray, t. III ) ; et, le 5 décembre, jour du départ de
Napoléon, cette poignée d'hommes était réduite des deux tiers. Le 6
e corps, alors sous les ordres de de Wrède, et
flanquant à gauche a déroute, n'est pas compris dans la situation que nous citons ; mais y ajouter son effectif, ce ne
serait pas diminuer beaucoup l'erreur calculée de Napoléon, car c'est tout au plus si, le 2 décembre, de Wrède avait
encore trois ou quatre mille combattants ; et six jours après, il ne lui en restait que deux mille. (Voir
Kriegsgeschichie von Bayern, etc., von Frh. von Völderndorf und Waradein.)

5
Le 19 décembre, Murat arrivait à Königsberg, à peine escorté de quelques cavaliers. Bien
des fuyards l'y avaient précédé. Il y avait fait requérir à l'avance des logements et des subsistances
pour vingt-cinq mille hommes. On y attendait un corps d'armée. Mais, au lieu de ces vingt-cinq
mille hommes bruyamment annoncés, les habitants surpris virent, à deux jours de là, passer une
petite troupe de quatre ou cinq cents fantassins et de deux ou trois cents cavaliers misérablement
vêtus, d'aspect reconnaissable, à peine en ordre. Des quarante-six mille hommes de la garde
impériale, de ce corps d'élite naguère si brillant, de tenue si pompeuse, qui n'avait pas tiré un coup
de fusil pendant presque toute la campagne, et le seul qui eût reçu des distributions à peu près
régulières, c'était là tout ce qui était demeuré dans le rang. Après, il ne parut plus que des hommes
isolés, des traînards dans un état plus misérable encore. Sur d'autres routes, dans d'autres villes où
avaient été prescrites les mêmes réquisitions qu'à Königsberg, l'armée française offrit un spectacle
tout aussi lamentable, et le nombre d'hommes marchant militairement fut encore plus restreint. Ici et
là ils étaient cent cinquante ou deux cents à peine escortant les aigles réunies des divers régiments
de chaque corps d'armée. Et ces aigles mêmes n'étaient plus aux drapeaux. Depuis longtemps elles
en avaient été détachées. Les drapeaux avaient été brûlés, et les aigles étaient cachées dans les
havresacs des soldats.
Jusqu'à Königsberg, Murat n'avait montré que découragement; mais une fois là, il
retrouva l'énergie perdue dans les horreurs des derniers jours, et il prit des mesures pour
recueillir les épaves de l'immense naufrage.
A Kowno, où l'on avait repassé le Niémen au milieu d'un tumulte tristement fameux, il
avait reconnu, de concert avec les maréchaux, l'impossibilité absolue de tenter un ralliement sur
ce fleuve profondément gelé ; et il leur avait indiqué, au loin en arrière, des points vers lesquels
ils devaient se rendre de leur personne et s'efforcer de diriger leurs soldats débandés,
démoralisés, épuisés.
Il régularisa et précisa, par un ordre du 20 décembre, ces dispositions provisoires.
D'après cet ordre, les restes de la garde impériale durent se réunir à Königsberg, ceux de
la cavalerie démontée à Elbing, ceux du 2e et du 3e corps à Marienburg, ceux du 4e et du 9e à
Marienwerder, ceux du 1er et qu 8e à Thorn, ceux du 6e à Plozk; enfin, ceux du 5e, qui avaient
été envoyés directement par Napoléon de Malodeczno à Ollita sur la rive gauche du Niémen et qui
avaient ensuite marché sur Varsovie, durent s'établir dans cette dernière ville.
Murat ordonna, en même temps, de renvoyer sur les derrières, à Stettin et à Cüstrin, les
officiers blessés et malades qui pourraient supporter le trajet ; et il prescrivit que tout soldat qui
serait trouvé sans autorisation sur la rive gauche de la Vistule, fût considéré comme déserteur
devant l'ennemi.
Ces instructions annonçaient, enfin, l'existence d'un commandant en chef.
Au moment où ils avaient repassé le Niémen, les débris confus de l'armée s'élevaient peut-
être encore à trente-cinq ou quarante mille hommes. Mais, depuis, ce nombre ne cessait pas de
diminuer. Une abondance relative succédant brusquement à la disette, la chaude température des
habitations à l'atmosphère glacée des bivacs, multipliaient les maladies et les victimes. Dans la
seule ville de Königsberg, il mourait de cinquante à soixante hommes par jour.
Le 31 décembre, Murat put reconnaître, d'après les rapports parvenus à Königsberg, que
vingt mille hommes environ étaient demeurés valides ou le redeviendraient promptement ; que ce
nombre s'augmentait de six ou sept mille isolés, convalescents et autres, retrouvés en Prusse et dans
le grand-duché de Varsovie ; et que, des hôpitaux, il ne sortirait guère que des mutilés et des
cadavres.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
1
/
219
100%