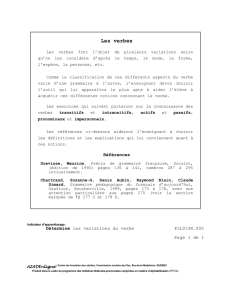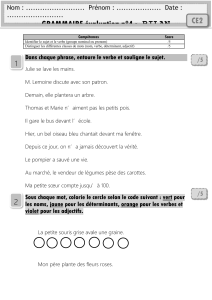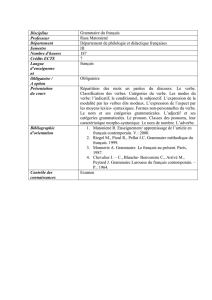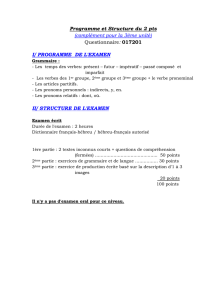Cahier du CRISCO n°21

Cahier du CRISCO n°21
janvier 2006
AUTOUR DES GRAMMAIRES DE
CONSTRUCTIONS ET DE PATTERNS
Dominique LEGALLOIS
&
Jacques FRANÇOIS
(dir.)
CRISCO
Université de Caen (Bât. Sciences Porte SA S13), 14032 CAEN CEDEX
Tél. : 02 31 56 56 27 — Fax : 02 31 56 54 27 — Site web : www.crisco.unicaen.fr
Courriel direction : jacque[email protected]
Courriel secrétariat : [email protected]

SOMMAIRE
Introduction 1
Chapitre I : La Grammaire de Construction (D. Legallois & Ph. Gréa) 5
I─0. Un tournant phraséologique de la linguistique 5
I─1. Un préambule : Bolinger (1975) 6
I─2. La Grammaire de Construction 9
I─3. G. Nunberg et la compositionnalité 11
I─4. Synthèse intermédiaire 15
I─5. A. Goldberg et la notion de Construction 16
I─6. La notion d’entrenchment dans le cadre des linguistiques cognitives 18
I─6.1. Définitions de la notion d’entrenchment 18
I─6.2. Applications en sémantique 20
I6.3. Bilan général sur la notion d’entrenchment 26
I6.4. Entrenchment et Construction 26
I─7. Conclusion 27
Chapitre II : La phraséologie dans la linguistique contextualiste
(D. Legallois)
28
II─1. Présentation 28
II─2. J. Sinclair 29
II2.1. Le principe de l’idiomaticité / le principe du libre choix 30
II2.2. La différenciation entre mots et items lexicaux en rapport avec la prosodie
sémantique 31
II─3. Pattern Grammar 33
II─4. Comparaison entre pattern et construction 36
II─5. M.Hoey et le lexical priming 42
II5.1 Présentation 42
II5.2 Les dix thèses 43
II5.3 La grammaire émergente 47
II─6. Conclusion générale 48

Chapitre III : Le sémantisme propre des cadres prédicatifs et la
polysémie des verbes de production de parole
(J. François & M. Sénéchal)
49
III1. La notion de ‘construction’ appliquée aux structures argumentales par
Adele Goldberg 49
III2. Les verbes de production de parole, primaires ou dérivés ? 52
III3. Les types d’emploi fondamentaux des verbes de production de parole
primaires 52
III3.1. hurler et crier, verbes à emploi primaire d’élocution 54
III3.2. appeler, verbe à emploi primaire d’appel 56
III 3.3. dire, verbe à emploi primaire de déclaration 57
III 3.4. demander, verbe à emploi primaire de questionnement ou de requête ? 59
III4. Trois cadres prédicatifs des verbes de production de parole susceptibles de
constituer des ‘constructions prédicatives’ 61
III5. Conclusion 69
Bibliographie 70

D. Legallois & J. François Introduction
1
Introduction
Les apports des Grammaires de Construction1 dont le programme se dessine à la fin des
années quatre-vingt chez Charles Fillmore et Paul Kay, puis chez Adele Goldberg, restent
encore relativement peu exploités par l’analyse linguistique française. Même si la linguistique
cognitive, dans laquelle s’inscrit cette grammaire, prête de plus en plus souvent son cadre aux
travaux de sémantique grammaticale et lexicale, la syntaxe reste encore marquée ou bien par
les approches formelles et compositionnelles, ou bien par l’approche traditionnelle. Les
Grammaires de Construction n’opèrent pas de coupure radicale entre les deux orientations :
elles ne manquent pas de formalisme ni de compositionnalité (Chez Fillmore et Kay en
particulier) et soulignent parfois que la notion de construction est relativement proche de la
construction de la grammaire traditionnelle. Néanmoins, la perspective qu’elles offrent va
dans le sens d’une renégociation de la coupure entre syntaxe et sémantique. Il est vrai que
souligner les rapports entre syntaxe et sémantique est devenu une sorte de topos ; pourtant,
les analyses qui réclament une appréhension d’ensemble de la forme et du contenu laissent
toujours persister une indépendance entre les deux niveaux : elles ne font que mieux identifier
l’interface.
Les grammaires de constructions vont plus loin puisqu’elles conçoivent que les cadres
syntaxiques sont dotés d’une signification, rappelant par là-même l’indistinction entre sens et
forme dans la théorie de la Gestalt. D’ailleurs, elles partagent avec cette théorie la
composition holiste des structures. Surtout, les Grammaires de Constructions plaident pour un
traitement phraséologique des formes. En effet, la notion de construction est redevable,
comme l’expose le chapitre 1 de ce Cahier du CRISCO, à l’analyse du phénomène
phraséologique : l’idiosyncrasie des comportements, la fréquence (l’entrenchment) des formes
sont autant de propriétés qui permettent d’appréhender la grammaire comme un champ
d’unités symboliques (au sens de Langacker). Mais les Grammaires de Construction ne sont
pas les seules à partager cette vision phraséologique de la langue. La linguistique anglaise,
marquée par une longue tradition contextualiste, a récemment apporté une contribution
importante au débat. Les travaux très peu connus en France de John Sinclair, Michael Hoey et
Susan Hunston et Gill Francis, fortement appuyés sur des corpus, ont mis en évidence la
dimension idiomatique de la grammaire et du lexique. Hunston et Francis (2000) ont même
identifié des « patterns » grammaticaux communs aux constructions des linguistes américains.
Ce qui est remarquable (et ce dont rend compte le chapitre 2), c’est que les travaux
britanniques et américains, pour des raisons épistémologiques et de tradition, se sont
superbement ignorés. Lors d’un récent colloque à Louvain-La-Neuve (octobre 2005) consacré
à la phraséologie, J. Sinclair avouait dans sa conférence connaître qu’approximativement les
1 On peut préférer le pluriel au singulier dans la mesure où plusieurs conceptions du phénomène de construction
existent.

D. Legallois & J. François Introduction
2
Grammaires de Construction, tout en pressentant dans ces dernières des points communs avec
sa conception idiomatique de la langue.
Les chapitres 1 et 2 du Cahier, écrits par Dominique Legallois, et, pour l’exposition de
la notion d’entrenchment, par Philippe Gréa, présentent donc les deux perspectives
grammaticales – chaque perspective présentant d’ailleurs des conceptions variables – et
discutent de leur points communs et de leurs différences, en proposant comme fil conducteur,
l’usage de la phraséologie dans l’argumentation de ces deux théories.
Le chapitre 3 est une version développée de la communication de même intitulé,
présentée par Jacques François & Morgane Sénéchal au colloque La prédication organisé par
J.M. Merle à Aix-en-Provence en décembre 2004. La longueur des contributions au volume
d’actes de ce colloque étant strictement limitée, la diffusion d’une version téléchargeable sur
le site du CRISCO a été annoncée dans l’article issu de la communication.
Dans ce chapitre, J. François & M. Sénéchal testent sur une classe de verbes français la
thèse d’Adele Goldberg (1995) selon laquelle certains types de structures argumentales
(appelées ici « cadres prédicatifs » dans le prolongement de François 2003) présentent un
sémantisme propre, en sorte que différents types de polysémie verbale – que D. Willems
(2005) classe comme « réguliers » et « syntaxiques » – sont analysables en termes de greffe
entre deux cadres prédicatifs, l’un primairement attaché au verbe et l’autre fonctionnant
comme greffon. Les auteurs s’attachent particulièrement à la greffe d’une construction
verbale à un cadre prédicatif divalent (lui-même éventuellement issu de la greffe d’un actant
à un cadre prédicatif monovalent) dans le domaine des verbes de production de parole, par
exemple :
Marie crie (qch) (à qn)
→ Marie crie à qn de faire qch ;
Paul demande (qch) (à qn)
→ Paul demande à Marie de faire qch
→ Cela demande qch {un effort / de la bonne volonté / etc.} à Marie.
Ce chapitre 3 reprend sans modification les sections I et II de l’article, mais les sections
III et IV suivent le détail de la communication. Le chapitre délivre de nouvelles observations
sur un point important : la communication présentait une disparité en matière d’analyse
quantitative de données textuelles, car la section III sur les types d’emploi fondamentaux des
verbes de production de parole primaires exploitait comme corpus l’année 1993 du Monde,
alors que la section IV sur les cadres prédicatifs des verbes de production de parole
susceptibles de dégager des « constructions prédicatives » exploitait la méthode de requête
délexicalisée (c’est-à-dire comportant uniquement une chaîne de classes syntaxiques) élaborée
par J.L. Manguin dans la syntaxe de la base FRANTEXT catégorisée. Entre-temps, la
communication à paraître de M. Sénéchal au colloque des jeunes chercheurs de Paris 10 en
juin 2005, consacrée à la polysémie du verbe investir2, a mis en évidence la répartition
disparate des cadres prédicatifs (i) selon le type de texte constitutif du corpus textuel étudié et
(ii) selon les périodes.
Pour les cinq verbes de production de parole étudiés, les auteurs ont donc mis en
contraste la répartition des cadres prédicatifs dans l’année 1993 du Monde et dans la rubrique
‘romans’ (période 1990-97) de la base FRANTEXT catégorisée. Cette confrontation révèle des
disparités criantes, qui ont permis d’associer à chaque verbe un profil énonciatif pour les deux
types de texte, romanesque et journalistique.
2 « Distribution des emplois d’un verbe polysémique français à travers la base FRANTEXT par périodes et par
types de textes »
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
1
/
78
100%