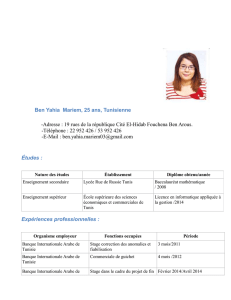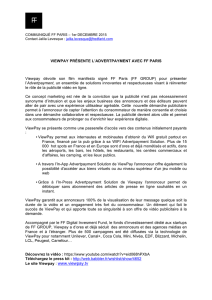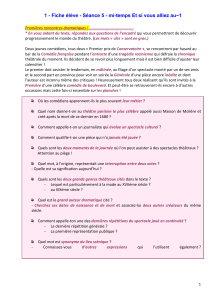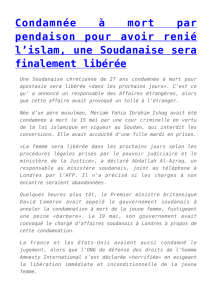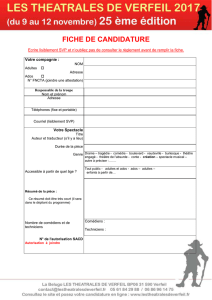Dossier de presse - Théâtre La passerelle

137BdG.POMPIDOU|GAP
,072.71.71.71.
3%'+'4!+4+''!!'3'
4
SAISON
2011I 2012
4
<>
7./7<
20:30
Photo Mohamed Frini
YAHIA YAÏCH
DE 77ET 7;

$'7('7''77+%$+7+5)%7 '$+
De+!$!+7+))+ et+(%'!7+5*$
Miseenscène+(%'!7+5*$
Avec+!$!+7+))+A7+ +7'7+6(+'A
+*+%7$+A7+ $7+$'A7
'7?+*'A7*+7?!$"+A7+ +7!
)%$A7+$ 7!7'&$A7$+(%7!7+ ($A7
%+!'(7$(A7%+ '(7!$7+!+6
Assistanteàlamiseenscèneetrégieson
+#'7'7 +
Scénographie+67
Musique:+(7*'' (ArtZoyd)
Lumière+(%'!7+5*$
Costumes$+7?($$
E()$ :FamiliaProductions;Bonlieu,
scènenationaled’Annecy
Productiondéléguée:Bonlieu,scènena-
tionaled’Annecy
()$ :TnBAThéâtreNationalde
BordeauxenAquitaine;Théâtredel’Union,
centredramatiquenationalduLimousin;
Théâtredel’Agora,scènenationaled’Evry
etdel’Essonne
')7!'7$' duministèredelaCulture
etdelasauvegardeduPatrimoinede
Tunisie,etpourlatournéedel’Office
InternationaldelaFrancophonie
' ')$' '7àSyhemBelkhodja,à
l’équipedeNessElFenetàl’équipede
l’espaceleMondialàTunis
Spectacle en arabe surtitré en
français
7./7
20:30
7E
Pièce prémonitoire s'il en est, Yahia Yaïch Amnesia, créée quelques mois avant «la
révolution de jasmin», raconte la déchéance d'un autocrate tunisien et les méthodes
insidieuses de la répression d'un régime autoritaire. Les auteurs, Fadhel Jaïbi et Ja-
lila Baccar, mettent en avant la responsabilité de chacun à travers le silence des in-
tellectuels et des
journalistes, le repli sur soi, la perte de repère d’un peuple...
En dénonçant les mécanismes d’un pouvoir despotique, ces artistes, figures de proue
du théâtre arabe, nous offrent une magnifique ode à la liberté.
Le personnage principal de la pièce, Yahia Yaïch, est un homme politique de haut
rang. Brutalement écarté du pouvoir, il apprend sa destitution à la télévision. Sa chute
est alors inexorable : disgrâce, assignation à résidence et accusations multiples. Il est
interné pour confusion mentale après avoir mis le feu à sa bibliothèque, et sera livré
à une hiérarchie médicale arbitraire et fantasque, à l’image du système qui l’avait
promu.
Magistrale et chorégraphique, la pièce s'écrit comme une ronde autour de la chute
de l'homme haï. Chaque comédien y incarne plusieurs personnages, automates en-
glués dans un monde absurde. Monté comme un thriller, tissé de révélations et de
rebondissements, Yahia Yaïch Amnesia est un spectacle de chair et de sang, super-
bement porté par onze comédiens.
7777;7
Projection de Plus jamais peur, au coeur de la révolution de jasmin
Un documentaire de Mourad Ben Cheikh
! à 20:30 au cinéma le Club
Gratuit pour les personnes possédant une place pour le spectacle Yahia Yaïch Amnesia
Ce film retrace les moments forts de la révolution tunisienne à travers l'itinéraire et
l'activisme de trois personnages : un va-et-vient entre petite et grande histoire tourné
dans l’urgence et au vif de l’actualité. La grande histoire, on le sait, c'est la
révolution, le départ de Ben Ali et tous les événements qui l'ont émaillé, et la petite
histoire, c'est non seulement le vécu militant des personnages, mais aussi leur
quotidien entre ruines et larmes, euphorie et découragement, peurs et espoirs.

Votre spectacle ", qui met en scène le
limogeage d’un despote, apparaît maintenant comme prémo-
nitoire au vu des événements survenus en Tunisie. Pensiez-
vous, au moment où vous l’avez répété, que la chute du
régime était imminente ?
Bien sûr que non. Nous sentions que quelque chose allait se
passer, mais il nous était impossible de savoir quand. À l’origine
de notre projet, il y avait une trilogie qui devait s’interroger sur
cinquante ans d’indépendance (1956-2006) et sur ce qui avait
été assassiné pendant cette période : les corps, les consciences
et une mémoire. Une mémoire vraie qui disparaissait sous la
mémoire officielle. C’est à la suite de Corps otages, le premier
volet de cette trilogie, créé en 2006, que nous avons décidé de
nous intéresser au système dictatorial. C’était risqué puisque le
spectacle Corps otages avait subi les foudres de la censure et
que nous allions nous attaquer directement au cœur du sys-
tème : le président Ben Ali. On nous conseillait de nous cacher
derrière Shakespeare ou Sophocle, mais nous voulions avan-
cer à visage découvert. Nous savions qu’il y avait une ligne
rouge à ne pas franchir : nous ne pouvions pas nommer di-
rectement le président. Alors nous avons appelé notre « héros
» Yahia Yaïch. L’histoire se passerait ici et maintenant, avec des
références à des événements antérieurs, du passé récent.
Avez-vous subi la censure ?
Il y a eu un bras de fer dont nous sommes sortis vainqueurs,
avec quelques petits « aménagements » anecdotiques. La cen-
sure était très organisée avec un cheminement qui allait du mi-
nistère de la Culture jusqu’au ministère de l’Intérieur puis à la
présidence de la République, avant de redescendre vers le mi-
nistère de l’Intérieur, principal décisionnaire. Nous avons donc
discuté et avons accepté de supprimer ce qui ne nous parais-
sait pas véritablement important. Par exemple, il ne fallait pas
parler du disque dur de l’ordinateur de notre héros : Ben Ali
était un fanatique des ordinateurs et d’informatique ; ne pas
utiliser le mot « portable » qui pouvait signifier que notre pièce
se déroulait aujourd’hui. Il ne fallait pas non plus parler des
émeutes de la famine en 2010 à Redeyef, mais de celles de
2008 à Gafsa… Pour le reste, nous n’avons pas cédé, nous ne
voulions pas qu’ils réécrivent la pièce. Il a fallu un mois et demi
pour avoir une autorisation. Le pouvoir pensait récupérer poli-
tiquement notre travail en nous laissant jouer en Tunisie et à
l’étranger. Nous lui servions d’alibi, nous le savions bien, mais
nous pensions que l’important était de jouer et de dénoncer.
777;
E74=7E
Votre théâtre emprunte une forme minimaliste, avec une scéno-
graphie très dépouillée…
Très dépouillée. Nous raclons le théâtre jusqu’à l’os pour pouvoir jouer
partout. Nous ne nous encombrons donc que du minimum de décor
et d’accessoires. C’est le geste significatif que nous recherchons, c’est
la forme synthétique qui nous intéresse. Nous n’avons ni fumigènes,
ni vidéos, juste des corps d’acteurs mis en lumière et en scène.
Vous utilisez plusieurs langues dans . Pourquoi ?
Nous utilisons en effet trois langues arabes. C’est la grande leçon des
tragiques grecs et de Shakespeare, qui utilisent aussi bien le profane
que le sacré, la prose que la poésie, le trivial que le spirituel. Nous
avons des comédiens qui viennent de régions différentes, avec des
cultures différentes et un parler particulier. J’aime l’idée que les per-
sonnages soient issus des comédiens, j’utilise donc leur voix, leur
corps et leur mémoire. Ici en Tunisie, il y a une multitude de dia-
lectes, presque un par région ou par ville, et c’est d’une richesse éton-
nante. L’arabe classique est merveilleusement poétique, l’arabe
littéraire est plus simple et l’arabe dialectal est d’une grande richesse
et, surtout, toujours en évolution.
Dans nos créations, nous mêlons trois langues parce qu’elles font
partie du quotidien des Tunisiens.
Le personnage principal parle souvent en voix off. Pourquoi ?
C’est la voix de son cerveau. Elle parle en arabe littéraire. En Tunisie,
on ne connaît de nos hommes politiques que la voix médiatisée, celle
qui passe par les micros. C’est pour cela que Yahia Yaïch est souvent
traité en voix off pour accentuer cette mise à distance. Il y a cepen-
dant une continuité sur le plateau entre cette voix off et sa voix nor-
male.
Dans le texte de votre spectacle, vous êtes assez critiques sur la jeu-
nesse de la Tunisie que vous accusez de passivité et d’abandon
aux « jouissances » de la consommation ?
C’est pourtant elle qui s’est soulevée contre la dictature… Je crois
que nous nous sommes trompés sur la jeunesse de ce pays : nous
voulions qu’elle porte les mêmes rêves que nous, alors qu’elle avait
ses propres revendications, ses propres moyens de mobilisation et
surtout son propre humour. Mais nous ne nous sentons pas coupa-
bles de ne pas l’avoir comprise. Je crois que le tsunami politique était
difficilement imaginable : nous avions déjà eu des événements aussi
forts et mêmes plus forts que ceux de Sidi Bouzid dans le passé qui
n’avaient pas ébranlé le pouvoir de Ben Ali. C’est sans doute l’accu-
mulation des frustrations et le combat mené depuis la fin des années
60 par les intellectuels, les artistes, les défenseurs des droits de
l’Homme, parfois au prix de leur vie, qui ont servi de terreau au sou-
lèvement de la jeunesse.
$'7('7''77+%$+7+5)%7 '$+

C 7<>7 B
Par 7+)"'!, in
Mouvement,
janvier-février 2011
Amnesia développe bien davantage qu'une charge contre le régime en place, elle radiographie une
société jeune et sans mémoire, suiviste, comme anesthésiée, que les deux auteurs tentent de ré-
veiller... À travers l'aventure de Yahia Yaïch, Amnesia métaphorise ainsi une pratique instituée de-
puis Bourguiba, consistant pour chaque régime à édifier une mémoire nationale tout à sa gloire.
« Chaque régime constitue une mémoire nationale sélective et arbitraire. Celle-ci envahit les mé-
dias et les manuels scolaires sous l'impulsion des historiens officiels. Seuls les artistes continuent
à résister face à l'amnésie collective. Cette lobotomie de la mémoire est inacceptable (...) »
Face à l'absence de débat public dans la société tunisienne, il s'agit pour Fadhel Jaïbi et Jalila Bac-
car de faire un théâtre qui gratte, qui pique, qui frotte et confronte. La structure dramaturgique
d'Amnesia procède ainsi par renversements de situations successifs qui produisent autant de re-
tournements dialectiques de la pensée du spectateur. Cette réflexion critique que ni les médias,
ni l'enseignement ne peuvent encourager (faute de liberté) seuls les artistes peuvent encore la sti-
muler. (...)
Dans Amnesia, le texte est le résultat de plusieurs mois d'improvisations. « C'est un texte pour la
représentation avant tout. » Pour preuve, cette impressionnante plage de vingt minutes de théâ-
tre sans parole qui introduit la pièce, où s'installe lentement un climat d'oppression à la fois sourde
et sucrée, sur scène, dans la salle et à travers le corps des comédiens.
Dans le vocabulaire scénique du couple, ce corps prend également une place centrale. Il est sou-
vent otage des contraintes qui s'exercent sur lui. Le corps de l'homme, bien sûr, mais aussi celui
qu'il métaphorise à travers de nombreuses scènes chorales parfaitement réglées : le corps social.
Courbé, rabougri, maltraité, entravé, le corps (humain et social) s'impose au centre de la scène,
souffrant mais aussi burlesque, incorporant sur le mode comique la somme des pressions qui
s'exercent sur lui.
Polémique et incarné, frontal et explosif, le théâtre de Fadhel Jaïbi et Jalila Baccar conserve en
même temps un certain classicisme. Amnesia maintient tout du long une remarquable tension
dramatique liée à la rapidité (relative) du rythme mais aussi à une narration qui fait de l'ellipse le
support d'une action souvent énigmatique, qui oblige le spectateur à sans cesse reconstituer de
lui-même le puzzle des événements. Exigeant dans l'attention, stimulant sans cesse la réflexion,
visuellement épatant et boosté par un univers sonore explosif emprunté à la musique électro-
nique de Gérard Hourbette, le spectacle ne recule donc pas devant une certaine efficacité qui
achève de lui assurer un véritable succès populaire. Et le rire de parachever ce succès, là encore,
de manière pleinement assumée. « Je veux faire un théâtre de divertissement, énonce Jaïbi, au
sens où Brecht l'entend, car le divertissement est un moyen de la politique. »
$'7('7''77+%$+7+5)%7 '$+

7E
« Voici le choc, celui qu'on attendait, celui qu'on attend toujours en allant au théâtre, et qui est
si rarement au rendez-vous. Amnésia, la dernière création de Fadhel Jaïbi et Jalila Baccar, est
un véritable coup de poing, tant politique qu'esthétique. Il y est question d'oubli, mais parler de
la défaillance de mémoire est aussi une façon de s'en prémunir. »
« Avec 11 superbes comédiens, en noir et blanc, une chorégraphie magistrale, une bande-son
remarquable et un décor minimaliste, Jaïbi dépose sur le plateau, l'ennui, la peur, la corruption,
le népotisme, la stigmatisation, la langue de bois, l'enfermement.(...) La pièce avance comme
un thriller avec la stature d'une tragédie grecque, toujours en proximité avec le public. Pas de
jugement, pas de commentaires, mais des actions et un état des corps sous un régime dictato-
rial. Des corps qui s'endorment, sursautent et sont pris de tics sous la terreur et l'effroi, des corps
qui brûlent dans des incendies volontaires ou gisent reclus dans des hôpitaux psychiatriques. Sa-
lutaire, ce théâtre radicalement laïc et contemporain est un forum politique ultrasensible qui
donne l'envie d'agir. »
« Vive la Tunisie libre ! » C'est le moment des saluts, explosifs, chaleureux. Face aux spectateurs
debout, les comédiens jubilent, certains font le signe de la victoire. Ce cri sort des gradins et l'eu-
phorie, palpable, est vécue comme une libération. Libération bien sûr, de 55 ans de musellement
politique, célébrée dans un même élan par les artistes de ce pays et le public réunis à Annecy.
Mais libération aussi du tunnel angoissant dans lequel le metteur en scène et sa femme enfer-
ment savamment le héros d'Amnesia, tyran limogé qui devient la victime du système d'oppres-
sion qu'il a lui-même élaboré. »
« Par leur gestuelle outrée, proche de la pantomime, les protagonistes appuient pleinement la
métaphore d'un gouvernement tunisien liberticide. Les puissants, avec leur allure d'automates
bien réglés, sont logés à la même enseigne que les plus faibles, dont ils font des pantins désar-
ticulés. Si bien que la situation semble sans issue, engluée par des décennies d'asphyxie. Où
chercher une solution, quand tout est gouverné par l'absurde ? La question est inévitable : elle
s'impose à chaque instant, sature l'espace ténu qui sépare les spectateurs de la scène. »
$'7('7''77+%$+7+5)%7 '$+
 6
6
 7
7
1
/
7
100%