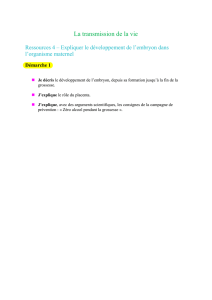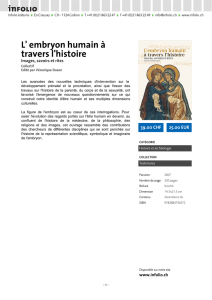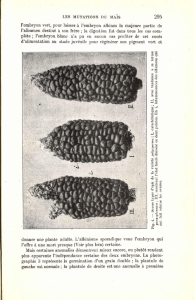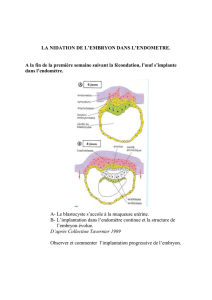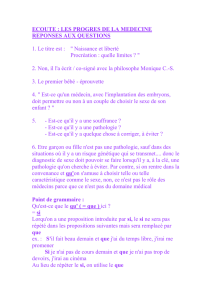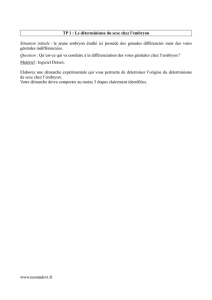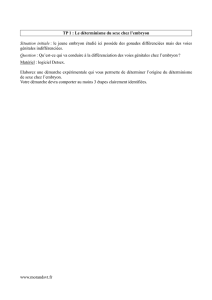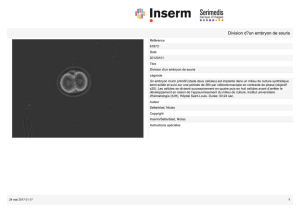Expérimentation homme-embryon

65
L’expérimentation sur l’homme et sur l’embryon :
des règles visant à ne pas les réduire
à des matériaux biologiques
En quels termes, l’expérimentation sur l’homme et celle sur
l’embryon se posent-elles ?
L’expérimentation sur l’homme nécessite d’intervenir sur le
corps d’une personne malade dans le but de mettre en évidence
les règles du vivant ; or, l’activité de soins déployée sur des
individus malades n’est légitime qu’autant qu’il s’agit de les
soigner. Dans un cadre clinique, le médecin a affaire à un
individu unique, son action devant être guidée par le seul intérêt
de la personne dont il essaie de rétablir la santé. En revanche,
l’activité expérimentale en ce qu’elle vise une meilleure
compréhension des phénomènes vitaux est par nature objective
et suppose de ne voir chaque individu que comme élément d’une
espèce. La nécessité de réaliser des essais sur l’homme
n’échappe à personne ; toutefois cette nécessité est à elle seule
insuffisante pour rendre légitime la recherche biomédicale sur
l’homme.
C’est Claude Bernard
1
qui a théorisé la compatibilité du
modèle expérimental avec le modèle clinique, d’une part en
affirmant que l’expérimentation est nécessaire parce que le
modèle animal est insuffisant pour restituer pleinement la
complexité et la spécificité de l’organisme humain, d’autre part
en estimant que l’expérimentation est acceptable si elle ne nuit
pas à la personne sur qui elle est pratiquée
2
. La médecine
1
Cl. Bernard, Principes de médecine expérimentale, PUF, coll. Quadrige,
2
e
éd. 1987, 2.
2
Cl. Bernard, ibid, : « parmi les expériences que l’on peut tenter sur
l’homme celles qui ne peuvent que nuire sont défendues, celles qui

66
expérimentale qui recherche les causes des maladies et cherche à
comprendre les effets des remèdes
3
a besoin d’une série de
malades pour mener à bien ses investigations. S’appuyant sur le
modèle bernardien, les médecins français aussi bien à la fin du
XIXe siècle qu’au XXe siècle –et ce jusqu’aux années 1980–
ont conduit des essais essentiellement sur les personnes
hospitalisées en intégrant la démarche expérimentale à celle des
soins : les patients étaient soignés, mais faisaient aussi l’objet
d’une recherche. La recherche menée sur une personne étant
englobée dans la pratique thérapeutique, cette manière de
concevoir l’expérimentation impliquait qu’elle était pensée
comme n’étant pas contraire aux intérêts de la personne.
Toutefois, les médecins français ont distingué deux types de
pratiques expérimentales : ils ont considéré que des essais
conduits sur des personnes malades le sont dans un but
thérapeutique car susceptibles de les soigner
4
; en revanche, des
recherches n’ayant pas de but thérapeutique n’étaient pas
pratiquées sur des personnes malades, mais sur des personnes
dites « volontaires sains ». On remarquera combien la
terminologie utilisée est révélatrice : est volontaire celui qui agit
librement, sans contrainte et qui, pour ce faire, exprime sa
volonté, ce qui implique un acte délibéré. L'accord de la
personne n'était donc requis que lorsque cette dernière n'était pas
malade.
Est-ce à dire que la maladie écarterait la nécessité de
demander au patient son point de vue ? Cette situation
longtemps admise peut s'expliquer par la manière dont la
sont innocentes sont permises, celles qui peuvent faire du bien sont
commandées ».
3
Cf. sur ce point G. Canguilhem, L’idée de médecine expérimentale
chez Claude Bernard, Etudes d’histoire et de philosophie des sciences,
J. Vrin, 1983, 127-114.
4
D’emblée une confusion a été opérée entre le but de la recherche et
l’intérêt de la personne ; le but, c’est la finalité qui est certes toujours
thérapeutique (chercher à mieux connaître les maladies et à améliorer

67
relation médecin-malade a été construite : le médecin est
considéré comme celui qui, compte tenu de ses compétences,
sait ce qui est bon pour le malade; il lui revient donc de définir
l'intérêt de ce dernier et de prendre la décision en fonction de
l'idée qu'il s'en fait. Dans ce modèle de relation, il est acquis que
le médecin prend toujours des options qu’il estime bénéfiques au
malade; il n'est donc pas nécessaire de l'informer, ni de lui
demander s'il est d'accord.
Encore faut-il ajouter que porter atteinte à l'intégrité
physique d'une personne est constitutif d'une infraction de coups
et blessures volontaires, les médecins n'échappant à leur
responsabilité pénale que si l'intervention a un but thérapeutique.
Or, c'est précisément ce point qui constituera une pierre
d'achoppement et conduira à la loi du 20 décembre 1988, dans
une lente gestation dont le contexte mérite d'être rappelé.
C’est parce qu’il est apparu progressivement que
l’amélioration des connaissances et l’intérêt d’une personne
d’être soignée ne coïncidaient pas nécessairement, que la
participation de cette dernière à une recherche a été organisée
par des règles spécifiques. L’expérimentation a été autonomisée
par rapport aux soins et est devenue une pratique identifiée
comme telle. Il n’est pas indifférent de savoir que la création de
règles propres s’est faite dans le cadre des essais de
médicaments. Il existe depuis 1941 une législation et une
réglementation visant à protéger
5
les éventuels utilisateurs de
médicaments. Avant l’entrée de la France dans le Marché
commun ceux-ci ne pouvaient être mis sur le marché qu’après
avoir obtenu un visa, procédure qui nécessitait de faire la preuve
que des essais thérapeutiques relatifs à la molécule avaient été
conduits.
les soins) mais ne coïncide pas nécessairement avec l’intérêt
thérapeutique qui est celui du patient à être soigné.
5
La loi du 11 septembre 1941 modifiée par la loi du 22 mars 1946 a
établi un statut de la spécialité pharmaceutique.

68
Une fois le Traité de Rome ratifié, plusieurs directives
6
transposées en droit français ont organisé l’autorisation de mise
sur le marché, laquelle n’est accordée que si le produit a fait
preuve de son innocuité et de son intérêt thérapeutique. Or, la
démonstration doit en être faite grâce à des essais thérapeutiques
mais aussi de pharmacologie et de toxicologie cliniques. Ces
derniers à la différence des premiers sont sans caractère
thérapeutique pour ceux sur qui ils sont effectués, car il s'agit de
mettre en évidence les effets pharmacologiques du produit
expérimenté, d'étudier son métabolisme, d'établir des résultats
pharmacocinétiques; toutes ces recherches ont été entreprises sur
des volontaires sains ou, en tous les cas en dehors de tout acte de
soins, puisque les règles dont se sont dotés les médecins français
leur interdisaient d'envisager de telles recherches sur des
patients, faute d'intérêt thérapeutique pour ces derniers.
Par hypothèse, ces personnes n'étant pas malades,
l'intervention sur leur corps n'avait pas de légitimité
thérapeutique; aussi était-elle pénalement punissable. En outre,
les conséquences dommageables d'un acte volontaire ne peuvent
être assurées. Aussi est-ce pour ces deux raisons que les milieux
de l'industrie pharmaceutique ont, à partir de 1980, mis en avant
les contradictions existant entre ces différentes règles
juridiques, contradictions qui les conduisaient, pour respecter
une catégorie de règles– celles de l'autorisation de mise sur le
marché des médicaments– à tomber sous le coup d'une autre
catégorie de règles, celles du droit pénal. On aurait pu trouver
cette situation curieuse puisque les médecins n'auraient fait
qu'obéir à une disposition particulière de l'arsenal juridique
6
La Directive européenne 65/65 CEE du 26 Janvier 1965 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques et la
Directive européenne 75/318 CEE du 20 mai 1975 sur le
rapprochement des législations des États membres concernant les
normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et
cliniques en matière d'essais de médicaments.

69
applicable à l'autorisation de mise sur le marché. Mais, au regard
du droit pénal français, seule une loi peut exceptionnellement
légitimer un comportement qui, sans cette dernière constituerait
un délit. Or, le texte prévoyant des essais sans but thérapeutique
n'était qu'un arrêté.
On peut s’interroger sur le point de savoir pourquoi il a
semblé nécessaire de protéger les potentiels utilisateurs de
médicaments sans que ceux sur qui les essais étaient conduits
pour garantir leur effet thérapeutique et faire en sorte d’écarter
une potentielle nocivité, bénéficient d’une prise en considération
équivalente de leurs intérêts. Cela est dû au fait que les
médecins qui réalisaient ces expérimentations estimaient agir
dans l’intérêt de leurs patients au prétexte que ceux-ci pouvaient
espérer en retirer un bénéfice éventuel
7
. A partir du moment, où
en revanche l’idée s’est progressivement affirmée qu’une
expérimentation était conduite dans l’intérêt général et non dans
l’intérêt de la personne, cette activité a été considérée comme
autonome et a cessé d’être confondue avec les soins.
Les garanties imaginées ont trait à la protection de
l’intégrité physique de la personne, sachant qu’une
expérimentation ne peut être imposée à celle-ci ; aussi des règles
ont-elles été édifiées de telle façon à lui assurer des garanties au
regard de la qualité scientifique des projets de recherche, à lui
fournir une information complète et à ne conduire une recherche
qu’autant que la personne l’aura acceptée. Dans cette hypothèse,
si l’on n’est pas certain que la personne puisse avoir intérêt à
participer à une recherche, au moins peut-on prendre en
considération son point de vue, en l’informant du projet et en ne
le conduisant qu’avec son accord.
7
Confusion exposée supra note 4, entre intérêt et bénéfice ; un essai
est conduit au nom de l’intérêt général d’une amélioration des
connaissances biomédicales. S’il est possible qu’une personne en retire
un bénéfice, cela n’implique nullement que l’essai soit réalisé dans
l’intérêt thérapeutique de cette dernière.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%