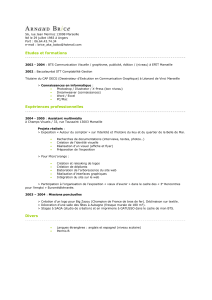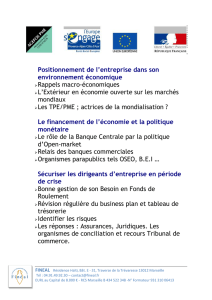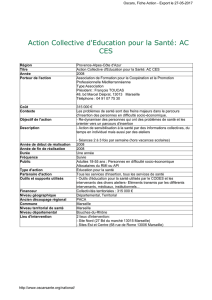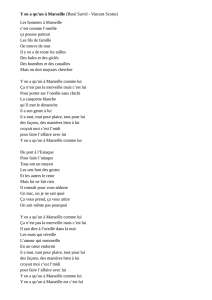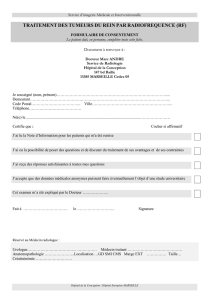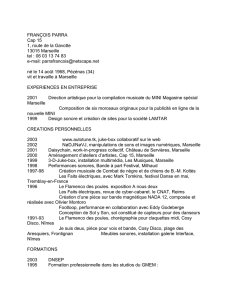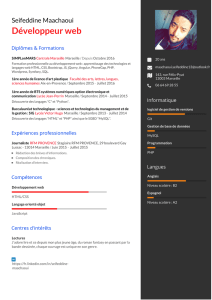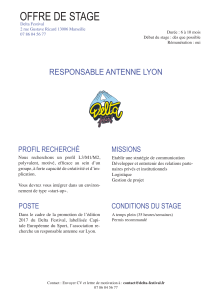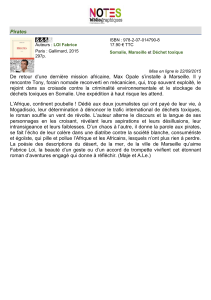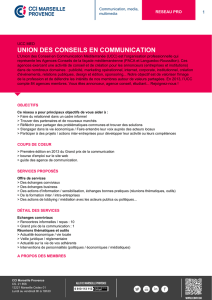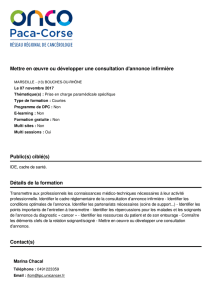Ce que rapporte la culture

un gratuit qui se lit
N°73 du 16/04/14 au 21/05/14
Ce que
rapporte
la culture


Politique culturelle
Economie de la culture ......................................................4, 5
Événements
Entretien avec Macha Makeïeff ..............................................6
68e édition du Festival d’Avignon ..........................................7
MuCEM, Villa Méditerranée, carte Flux ................ 8 à 10
Venise à Marseille ......................................................11
Critiques
Théâtre .......................................................................12 à 25
Danse ...........................................................................26, 27
Jeune public ..................................................................28, 29
Musique .....................................................................30 à 35
Au programme
Théâtre ......................................................................36 à 40
Danse ...........................................................................41, 42
Jeune public ...............................................................44 à 46
Cirque/rue .....................................................................47, 48
Musique .....................................................................50 à 53
Cinéma ....................................................................54 à 59
Arts visuels
Marseille ...........................................................................60
La Friche ..........................................................................61
Arles ................................................................................62
Biennale des écritures du réel, la Compagnie .........................64
Galerie d’Art CG .................................................................65
Au programme ................................................................ 66, 67
Livres ..........................................................68 à 71
Rencontres
Paroles d’auteurs, Escapades littéraires, BD ............................ 72
Bibliothèque départementale, ABD Gaston Defferre .................74
Sélection Prix littéraire, ARL ................................................ 75
Nouvelle lauréate de Lire Ensemble .......................................76
Journée Méditerranée, I2MP ................................................78
Mensuel gratuit paraissant
le deuxième mercredi du mois
Édité à 32 000 exemplaires
imprimés sur papier recyclé
Édité par Zibeline SARL
76 avenue de la Panouse n°11
13009 Marseille
Dépôt légal : janvier 2008
Directrice de publication
Agnès Freschel
agnes.fr[email protected]
06 09 08 30 34
Imprimé par Rotimpress
17181 Aiguaviva (Esp.)
Photographe
Agnès Mellon
095 095 61 70
photographe-agnesmellon.
blogspot.com
Rédactrice en chef
Dominique Marçon
journal.zibeline@gmail.com
06 23 00 65 42
Secrétaire de rédaction
Delphine Michelangeli
d.michelangeli@free.fr
06 65 79 81 10
Arts Visuels
Claude Lorin
claudelorin@wanadoo.fr
06 25 54 42 22
Livres
Fred Robert
fred.robert.zibeline@free.fr
06 82 84 88 94
Musique et disques
Jacques Freschel
jacques.fresch[email protected]
06 20 42 40 57
Dan Warzy
danwarzy@free.fr
Thomas Dalicante
thomasd[email protected]
Cinéma
Annie Gava
annie[email protected]
06 86 94 70 44
Élise Padovani
elise.padovani@orange.fr
Philosophie
Régis Vlachos
regis.vlach[email protected]
Sciences
Christine Montixi
christine.montixi@ac-aix-marseille.fr
Polyvolants
Chris Bourgue
chris.bourgue@wanadoo.fr
06 03 58 65 96
Maryvonne Colombani
06 62 10 15 75
Gaëlle Cloarec
Marie-Jo Dhô
dho.ram[email protected]
Marie Godfrin-Guidicelli
06 64 97 51 56
Alice Lay
06 26 26 38 86
Jan Cyril Salemi
Maquettiste
Philippe Perotti
philippe.zibelin[email protected]
06 19 62 03 61
Directrice Commerciale
Véronique Linais
06 63 70 64 18
La régie
Jean-Michel Florant
06 22 17 07 56
Collaborateurs réguliers :
Frédéric Isoletta, Yves Bergé,
Émilien Moreau, Christophe
Floquet, Pierre-Alain Hoyet,
Aude Fanlo, Laurence Perez,
Anne-Claire Veluire, Maurice
Padovani, Estelle Barlot,
Hélène Dos Santos
RetrouveZ Zibeline et vos invitations sur notre site
www.journalzibeline.fr
Austérité mortifère
Les victoires du Front national dans notre pays, dans notre région,
font froid dans le dos. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Quel va être le résultat des Européennes, puis des Régionales où
le FN peut gagner en PACA ? Quand nos responsables politiques
se rendront-ils compte de l’abandon où nous sommes ? Quand
proposeront-ils un candidat aux Régionales crédible à gauche, à
droite ? Leur lâche traficotage pour gagner en triangulaires nous
conduit année après année à la catastrophe, à la banalisation
du discours FN qui contamine les rangs de l’UMP, jusqu’aux élus,
jusqu’aux adjoints. Leur surdité et leur aveuglement aux souffrances
du peuple est effarant, et au soir des Municipales ils parlaient
encore de pédagogie… Ne savent-ils pas que, dans la 5e puissance
économique mondiale, la plupart des citoyens, et pas seulement
les plus pauvres, se demandent comment payer des études à leurs
enfants qui de toute façon n’ont pas d’avenir ? Que les classes
moyennes commencent à vendre, pour payer les maisons de retraite
de leurs parents, leurs biens acquis en 25 ans d’emprunt qui n’ont
enrichi que les banques ? Que les classes populaires sont à sec,
désespérées, et qu’il n’est plus temps d’imposer une austérité
qui ne pourra rien redresser, sinon le vote du désespoir ? Qu’il
est suicidaire de mener une politique si éloignée de celle pour
laquelle ils ont été élus, de signer un pacte de stabilité assassin,
de négocier en douce des accords commerciaux avec les États-Unis,
de laisser pourrir à ce point les affaires locales, de ne pas accorder
aux étrangers le droit de vote qu’ils ont promis ?
Comment agir aujourd’hui ? Les artistes et les intellectuels, après
cette campagne où les enjeux culturels ont disparu des discours
politiques, peuvent-ils porter une parole singulière qui ferait tomber
les masques des fascistes, les cataractes des politiques, les œillères
des journalistes ? Une parole qui donnerait aux citoyens l’impression
qu’on entend enfin leur voix assourdissante ? En appauvrissant
systématiquement les artistes et acteurs culturels, la presse et les
médias publics, les associations et centres sociaux, les enseignants,
les chercheurs et les intellectuels, les gouvernements de gauche et
de droite détruisent depuis 30 ans les forces vives qui ont permis
la cohésion de la Nation, et de la démocratie. Nous risquons fort
qu’ils en payent le prix.
AGNÈS FRESCHEL

La comparaison est pourtant explicite : les activités
culturelles représentaient en 2011 «une valeur
ajoutée de 57,8 M d’euros, l’équivalent du secteur de
l’agriculture et des industries alimentaires (60,4 M d’euros),
deux fois les télécommunications (25,5 M d’euros),
quatre fois l’industrie chimique (14,8 M d’euros) ou
l’assurance (15,5 M d’euros), sept fois l’industrie
automobile (8,6 M d’euros)». Malgré cela, et cet
aspect du rapport est nettement moins commenté
par les médias, la baisse de cette part des activités
culturelles dans la richesse nationale depuis 2005
est importante, et conséquente à la baisse des
investissements publics et privés dans ce domaine :
le secteur culturel représentait encore 3,7% du
PIB en 2005, et avait été en hausse constante
pendant une décennie entière, depuis le milieu des
années 1990. Malgré son importance en volume
dans l’économie, sa forte valeur ajoutée, le nombre
d’emplois non délocalisables qui en dépendent et la
forte attractivité territoriale qui en découle, le secteur
est en crise, et en recul, faute de financements.
Légitimer les dépenses publiques
Le rapport est politique, a-t-on lu dans la presse,
émanant de la volonté d’Aurélie Filippetti de défendre
le budget de son ministère qui a été revu à la
baisse dès son installation rue de Valois en 2012.
La cécité est patente : le gouvernement socialiste
ne comprend pas en quoi il est ridicule de mettre à
mal un secteur si important pour économiser des
bouts de chandelles : baisser de 20% le budget du
ministère de la Culture, comme certains socialistes
le préconisent, reviendrait à économiser environ
0.15 % du budget de l’État, mais tuerait un secteur
économique qui peut représenter, lorsqu’il est
suffisamment soutenu, 3.7 % du PIB, et n’est certes
pas pour rien dans le fait que la France demeure
le premier pays touristique du monde.
Car la collaboration avec Bercy permet aussi de
comprendre et d’évaluer l’imbrication des activités
culturelles dans le reste des activités économiques.
Les auteurs de l’étude signalent en effet l’utilisation
d’une méthodologie singulière s’appuyant sur les
cadres conceptuels utilisés par l’Unesco et l’Union
européenne, mais cherchant à les dépasser, non
seulement pour «saisir l’intégralité des activités
culturelles» mais aussi leurs «effets induits», c’est-
à-dire l’activité qu’elles génèrent auprès d’autres
entreprises.
En termes d’emplois, cela représente 670 000
personnes qui travaillent dans des entreprises
culturelles, soit 2,5 % des actifs en France. En
tout, rajoute le rapport, 870 000 travailleurs sont
liés à la culture, relevant un certain paradoxe : «Il
existe plus de personnes ayant un emploi culturel
en dehors d’entreprises culturelles (par exemple un
photographe dans une entreprise agroalimentaire),
que de personnes ayant un emploi non culturel dans
une entreprise culturelle (par exemple un standardiste
dans une chaîne de télévision).» La culture irrigue
donc tous les secteurs de l’économie, et la mise en
danger des emplois culturels comporte un risque
certain d’augmentation brutale du chômage, bien
plus que la fermeture de certains sites industriels.
Impact sur les territoires
Plus notable encore, «une corrélation positive existe
entre les initiatives culturelles et le développement
local». Au cas où on en aurait douté, les deux
inspections générales concluent, après avoir comparé
des territoires aux caractéristiques socio-économiques
similaires, que ceux dotés d’implantations culturelles
(salles de spectacles, manifestations culturelles
régulières etc.) sont plus dynamiques que ceux
qui en sont dépourvus. Le rapport parle d’un «effet
substantiel» et illustre son propos avec, sur un
territoire donné, une retombée économique estimée
de 30 à 40 euros par visiteur grâce à l’organisation
d’un festival -un chiffre que l’on peut nettement
augmenter en comptant la diffusion indirecte dans le
tissu économique local. «Quand vous investissez un
euro dans un festival ou un établissement culturel,
vous avez 4 à 10 euros de retombées économiques
pour les territoires» peut ainsi affirmer la ministre
au moment où le Medef, en février dernier, veut
remettre en cause le statut des intermittents du
spectacle, indispensables pourtant en particulier
lors des festivals.
Tout rentable ?
C’est le spectacle vivant qui nourrit le plus le
«PIB culturel» français avec une valeur ajoutée
qui s’élève à 8,8 M d’euros, soit 15% de la valeur
ajoutée globale du secteur culturel (pour rappel,
57,8 M d’euros). Le spectacle vivant produit sa
richesse principalement en interne, sans impliquer
d’activité indirecte -une particularité partagée avec
les secteurs de l’audiovisuel, de la publicité, du
La culture,
question de PIB ?
3,2% du PIB :
c’est le chiffre
repris dans les
médias après
la diffusion en
décembre 2013
d’un rapport
commandé
conjointement
par l’inspection
générale des
finances et celle
des affaires
culturelles. Un
rapport qui
mesure l’apport
de la culture
à l’économie
française et
qui donne une
légitimité à
l’investissement
culturel, dans
une période où
des activités
considérées
parfois comme
improductives
sont de moins en
moins financées,
à la fois par
l’investissement
public et par le
mécénat
4
P
O
L
I
T
I
Q
U
E
C
U
L
T
U
R
E
L
L
E

cinéma, de l’architecture et de l’accès aux savoirs
et à la culture. En revanche, des secteurs comme
le patrimoine nécessitent une forte intervention
d’activités externes, par exemple celle d’ouvriers
du bâtiment spécialisés dans la réhabilitation de
monuments historiques. La presse et l’industrie
du livre requièrent également -du moins encore
quelque temps- le concours des imprimeries.
Au-delà des enjeux politiques de valorisation du
secteur culturel, la lettre de mission adressée aux
inspecteurs généraux est claire. Il ne s’agit pas
uniquement de justifier la dépense publique, mais
-contexte économique oblige ?- de rechercher
l’efficacité de l’intervention ; l’objectif est de
«déterminer les leviers d’action qui permettraient
d’utiliser pleinement le potentiel de croissance des
industries culturelles». Dans ce contexte, une attention
particulière a été portée à la mode, au cinéma,
à l’audiovisuel et aux jeux vidéo, qui, fleurons
de l’industrie culturelle française, sont porteurs
d’enjeux commerciaux à l’international. Surtout, ces
trois derniers sont particulièrement affectés par les
bouleversements technologiques en œuvre, et les
ministères sont invités à «suivre et à anticiper les
mutations sectorielles» pour renforcer l’attractivité
du territoire français. Ces industries se développent
en effet via les nouveaux modes de diffusion et de
consommations numériques -des plateformes qui
captent une partie de la richesse créée.
On perçoit clairement le paradoxe d’une telle vision
de l’intervention de l’État dans le financement
culturel : le cibler vers les industries rentables, ou au
fort potentiel de croissance, détache l’intervention
de la notion de service public de la culture, pour
valoriser l’aspect marchand, très loin des idéaux
qui ont vu naître le ministère de la Culture et la
notion même de politique culturelle. L’État est-il là
pour financer ce qui rapporte, ou pour faire vivre
les œuvres de l’esprit ?
Un budget de 13,9 M d’euros ?
Cette richesse produite par la culture nécessite un
investissement public conséquent : 13,9 M d’euros,
concède le rapport entérinant les chiffres du MCC,
«dont 11,6 M d’euros en crédits budgétaires, 1,4 M
d’euros en dépenses fiscales et 0,9 M d’euros en taxes
affectées». Mais ce chiffre est contestable en tant
que base de travail : les dépenses des collectivités
locales ne sont pas comptabilisées, or elles sont
aujourd’hui, en volume, plus importantes que celles
que le MCC consacre à la culture : en fait, en dehors
de l’audiovisuel et de la presse, le ministère de la
Culture ET de la Communication consacre moins de
7 M d’euros à la culture. Ainsi certains secteurs
sont très peu impactés par la puissance publique
(les arts visuels, les industries d’’image et de son,
l’architecture et le livre). D’autres en revanche
captent d’énormes crédits, notamment l’audiovisuel
(97,6% de sa valeur ajoutée, redevance comprise) et
l’accès au savoir et à la culture. L’État joue surtout
un rôle structurant pour le cinéma, le patrimoine,
la presse et le spectacle vivant, avec un apport
entre 9 et 15% de leur valeur ajoutée : il est loin,
contrairement à ce qu’il prétend, d’être le principal
financeur de la culture dite publique.
Et le qualitatif ?
S’il s’agit de justifier l’effort financier de l’État
à l’attention de la culture, en arriver à prouver
la nécessité de l’investissement culturel par sa
rentabilité a quelque chose de misérable, et risque
en fait de desservir les secteurs qui nécessitent
de l’investissement… à perte. Tout doit-il être
rentable ? On pourrait supprimer les théâtres, les
hôpitaux, les transports et les écoles, qui coûtent
bien trop cher et ne rapportent rien… La volonté
même de chiffrage doit donc aussi être critiquée,
elle va à l’encontre de l’idée d’exception culturelle.
La culture doit-elle rapporter ? Mais surtout, l’État
doit-il financer ce qui rapporte ou pourra le faire ?
On prend le risque d’un abandon
dès lors qu’il s’agit de justifier
par l’économie l’existence d’un
budget et d’un ministère de la
Culture…
Le rapport, d’ailleurs, tente
quelques intrusions qualitatives ;
«Les retombées économiques ne
sont pas la seule justification
d’une subvention publique»,
concèdent les inspecteurs, car
les résultats peuvent être autant
à attendre «en termes de prestige
et de positionnement culturel
que d’impact économique direct».
On se demande si ce sont les
retombées économiques ou le
prestige qui justifient les dépenses
de santé ?
En dehors de cette mécon-
naissance des enjeux réels de
la culture, le rapport introduit
une méthodologie opérationnelle
quant à l’incidence de la culture
sur les territoires. Pour l’étude,
l’échantillon était composé de
cinq manifestations culturelles
(Blues Passion de Cognac, les
Vieilles Charrues de Carhaix,
Django Reinhardt de Samois-
sur-Seine, Arts et traditions
populaires de Confolens, les
Médiévales de Provins). Cette
même méthodologie est en cours
d’application pour évaluer les
retombées économiques... de
Marseille Provence 2013. Que
Marseille veut remplacer par une
Capitale du Sport pour booster
à nouveau le territoire, preuve
même que l’impact économique
de la culture peut amener à la
sacrifier ! les retombées cultu-
relles se font dans les esprits, leur
émancipation, qui passe par la
pérennisation du fonctionnement
des équipements nouveaux et
une attention sur le long terme
à la santé du secteur.
ANNE-CLAIRE VELUIRE Et AGNÈS FRESCHEL
Le rapport L’apport de la culture
à l’économie en France a
été établi par Serge Kancel,
Inspecteur général des affaires
culturelles, Jérôme Itty, Inspecteur
des finances, Morgane Weil,
Inspectrice des finances, sous la
supervision de Bruno Durieux,
Inspecteur général des finances
© Ministère de la Culture et de la Communication
5
P
O
L
I
T
I
Q
U
E
C
U
L
T
U
R
E
L
L
E
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
1
/
80
100%