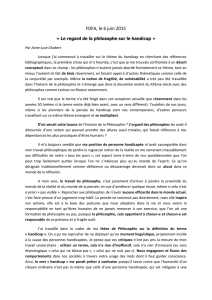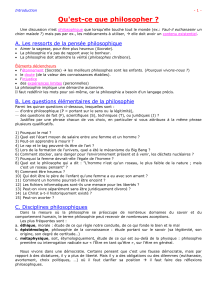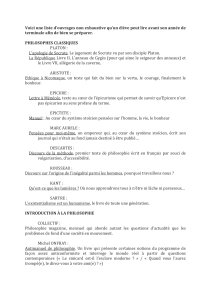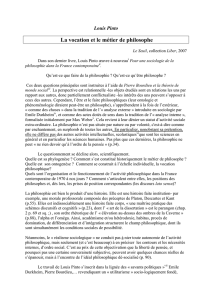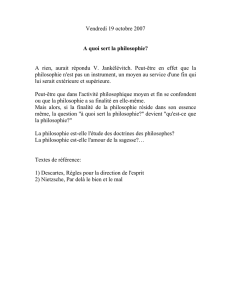2 - Les présocratiques ou la naissance de la philosophie

DEUXIÈME SUJET
LES PARTICULARITÉS DE LA PHILOSOPHIE ANTIQUE
I LA PHILOSOPHIE ANTIQUE, UNE PHILOSOPHIE OU UNE CHRONOLOGIE PHILOSOPHIQUE ?
1 - Peut-on parler d'une philosophique antique au-delà du découpage chronologique ?
2 - L'illusion du philosophisme général de l'Antiquité : philosophisme n'est pas philosophie
3 - La philosophie est une communauté intellectuelle dans le monde grec
II PHILOSOPHER DANS L'ANTIQUITÉ
1 - Qu'est-ce que philosopher dans l'Antiquité ?
2 - Philosopher, une pratique de vie vers l'idéal du Sage
3 - L'adhésion philosophique, la conversion à une école philosophique
4 - L'étrangeté des philosophes
5 - La Sagesse, un état de perfection idéal
6 - La divinisation du sage
7 - Le philosophe et les conventions sociales
8 - Les différences entre les écoles seront des divergences face à ces questions
III LES ÉCOLES PHILOSOPHIQUES
1 - L'apparition d'écoles philosophiques organisées dès le Vème siècle
2 - Les principales écoles
3 - Les origines de ces pratiques d'écoles
4 - Le principe des écoles, les lieux d'une "paideia" supérieure
5 - Le fonctionnement des écoles
6 - Les moyens de la philosophie
7 - La pérennité des écoles, des écoles qui vont survivre à leurs fondateurs
8 - Chaque école est un monde de pensée en soi
IV LES PRATIQUES PHILOSOPHIQUES
1 - L'adhésion à une école
2 - Les exercices philosophiques, des exercices "spirituels"
3 - La méditation philosophique des dogmes essentiels de l'école
4 - La lecture philosophique, une lecture oralistique
5 - L'enseignement philosophique et la direction de conscience
V LES PARTICULARITÉS PHILOSOPHIQUES DE LA PHILOSOPHIE GRECQUE
1 - Le monde comme cosmos, la réalité comme nature
2 - Ces manières de penser la philosophie, le philosopher et le philosophe
3 - Le rapport au savoir
4 - La connaissance comme moyen, la théoria est au service de la praxis
5 - L'attachement à la vérité et non pas à la vraisemblance rhétorique
6 - La dimension oralistique de l'écrit
Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4303 : “Les philosophes grecs antiques” - 04/01/2007 - page 1

VI CONCLUSION
1 - Il y a bien une philosophie grecque classique, cohérente dans son unité et ses divergences
2 - Une finalité de l'activité philosophique qui fut historiquement perdue
3 - Toutes nos pratiques philosophiques actuelles sont inexistantes et contradictoires
4 - Les philosophes grecs ne cherchaient pas à innover
5 - L'importance de l'effectivité du choix de vie
ORA ET LABORA
Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4302 : “Les philosophes présocratiques” - 28/12/2013 - page 2

Document 1 :
Pour nous autres modernes (ou postmodernes), la philosophie est essentiellement un
discours, écrit ou oral, portant sur des notions ou des concepts, en quelque sorte un
discours sur le discours, donc une théorie, une construction conceptuelle ; c'est d'ailleurs,
pense-t-on, ce qu'elle a été dès l'origine, depuis les premiers penseurs de la Grèce, au
VIème siècle avant Jésus-Christ. N'est-elle pas d'ailleurs une spécificité occidentale, qui
a son origine dans le génie grec, particulièrement doué pour la spéculation, la discussion
et l'abstraction ? Toutes les philosophies de l'Antiquité et les œuvres qu'elles ont
produites ne se présentent-elles pas comme des exposés de théories et de savoirs
abstraits ?
TELLE EST DONC LA REPRÉSENTATION COURANTE que l'on se fait aujourd'hui de la
philosophie en général, et particulièrement de la philosophie antique. Mais correspond-
elle à la réalité ? La philosophie, au cours des âges, n'aurait elle pas oublié ses origines ?
Car des faits troublants pourraient ébranler notre tranquille assurance. Tout d'abord,
pourquoi donc un certain nombre de philosophes antiques se sont-ils volontairement
abstenus d'écrire ? Parce que, précisément, ils refusaient de construire des théories et
de les enseigner ? C'est le cas, par exemple, de Socrate, de Pyrrhon, d'Arcésilas, de
Carnéade et, en un certain sens, d'Épictète. Pourquoi surtout certains personnages qui
n'ont jamais enseigné dans une école philosophique ni écrit d'ouvrage philosophique,
mais ont été des hommes d'action, tels Dion de Syracuse ou Caton d'Utique, étaient-ils,
dans l’Antiquité, considérés comme des philosophes ? Théorie et philosophie sont-elles
alors vraiment inséparables ?
Il nous faut donc revenir sur l'origine et sur la signification du mot philosophie. Si l'on avait
dit aux premiers penseurs grecs qu'ils étaient des philosophes, ils n'auraient pas très bien
compris de quoi il s'agissait. Le mot n'existait même pas à leur époque. Mais ils auraient
accepté qu'on les nommât des “sages” (sophoi), le mot “sagesse” signifiant alors
l'habileté, l'expérience, le savoir-faire en toutes sortes de domaines. Cette sagesse, ce
savoir ou savoir faire des premiers penseurs de la Grèce est né à la périphérie du monde
grec, dans ces colonies d'Asie Mineure qui étaient en contact avec les sagesses plus
anciennes encore de l'Égypte et du Proche-Orient. Avec l'essor de la démocratie
athénienne au VIème siècle avant Jésus-Christ, cette activité intellectuelle va venir, au
moins en partie, se fixer désormais au cœur de la Grèce, à Athènes, et prendre une tout
autre forme, avec ce que l'on appelle le mouvement des sophistes. Ceux-ci se
présentaient comme des professionnels de l'enseignement de la sagesse, se déclarant
prêts, moyennant finance, à fournir à la jeunesse avide de pouvoir l'habileté à raisonner,
à parler, à convaincre et finalement à gouverner. Ce sont les premiers “professeurs”, de
notre civilisation occidentale. Le mot "philosophia", qui fait son apparition à cette époque,
a encore un sens très vague : il englobe tout ce qui se rapporte à la culture intellectuelle
et générale.
Mais un événement déterminant va se produire : c'est, dans les dernières années du
Vème siècle avant Jésus-Christ, la vie et la mort de Socrate. Grâce surtout à
l'interprétation qu'en a donnée Platon, la vie et la mort de Socrate vont devenir les
modèles de la vie et de la mort du philosophe en général, et la philosophie, se distinguant
de l'antique sagesse-savoir, va prendre conscience de son essence véritable. Dans « le
Banquet », Socrate est comparé à Éros : de même que celui-ci, privé de beauté, aime
celle-ci et cherche à l'atteindre, de même Socrate est privé de sagesse mais s'efforce de
l'atteindre. La sagesse, désormais conçue comme un mode d'être parfait, divin et
inaccessible, se distingue radicalement de la philosophie (amour ou recherche de la
sagesse), qui sera un effort sans cesse renouvelé pour vivre concrètement selon cette
norme transcendante de la sagesse. Socrate n'est pas un théoricien, il prétend ne rien
savoir, et s'il interroge les autres, c'est pour les obliger à s'examiner et à changer de vie.
Et finalement son seul véritable enseignement, c'est sa vie : « je ne cesse pas de faire
voir ce qui me paraît être juste ; à défaut de discours, je le fais voir par mes actes. »
Désormais, la vraie philosophie ne sera plus conçue comme un pur savoir, une habileté
ou une culture, mais comme une manière de vivre, une manière d'être au monde,
engageant toute la vie, un exercice de la vie et un « exercice de la mort », selon
l'expression de Platon.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de discours philosophique. Mais il n'est jamais
purement théorique, malgré apparences ; il est toujours lié et subordonné à la décision
fondamentale du philosophe de choisir un certain mode de vie, qui sera d'ailleurs très
différent s'il est platonicien, ou aristotélicien, ou cynique, ou épicurien, ou stoïcien, ou
sceptique, et qui impliquera chaque fois une certaine vision du monde. Le discours
philosophique aura pour tâche d'inviter à prendre cette décision et à la justifier, ou encore
Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4302 : “Les philosophes présocratiques” - 28/12/2013 - page 3

d'exposer la vision du monde qui lui correspond. D'une manière générale, le discours
philosophique visera moins à informer qu'à former il sera moins un exposé qu'un exercice
intellectuel ou spirituel destiné à la transformation de l'individu. C'est le cas aussi bien
des dialogues de Platon, des traités d'Aristote, des lettres d'Epicure ou des écrits de
Plotin. Par suite, dans l'Antiquité, l'école philosophique n'est pas seulement une certaine
tendance doctrinale ou théorique, mais la communauté vivante où l'on pratique un certain
mode de vie et dans laquelle, ainsi chez les épicuriens, maîtres et disciples se soucient
mutuellement de leur état intérieur. Car toutes les écoles de philosophie antiques se
présentent comme des thérapeutiques, commençant par diagnostiquer les causes de
l'état habituel de souffrance, de désordre et d'inconscience dans lequel se trouvent les
hommes et proposant ensuite une méthode de guérison.
ON ENTREVOIT LA DISTANCE QUI SÉPARE la représentation que l'on se fait de nos
jours de la philosophie comme discours théorique et abstrait et celle que s'en faisaient les
philosophes antiques. Comment un tel oubli a-t-il pu se produire ? Tout d'abord, il y aura
toujours une tendance, chez les philosophes, à se satisfaire de leur discours, sans
éprouver le besoin de passer à l'acte. Les philosophes de l'Antiquité dénonçaient déjà ce
danger, qu'ils qualifiaient de “sophistique”. Platon décelait en lui-même ce risque : «le
craignais de passer à mes yeux pour un beau parleur incapable de s'attaquer résolument
à une action. » Mais, historiquement, c'est l'essor du christianisme qui a joué un rôle
décisif. Celui-ci étant en soi un mode de vie, la philosophie n'eut plus que le rôle d'un
instrument théorique au service de la théologie et elle resta théorique, lorsqu'elle
s'émancipa, très tardivement d'ailleurs, de la tutelle chrétienne. Enfin, les institutions
universitaires, issues du Moyen Âge, ont conduit à faire de la philosophie un métier et du
philosophe un fonctionnaire formant d'autres fonctionnaires.
Oubli donc, mais qui n'est peut-être pas si profond. En fait, l'inspiration socratique de la
philosophie reste toujours vivante. Déjà au XVIIIème siècle, on entrevoit un effort pour
revenir à ce que Kant appelait l'Idée du philosophe, à laquelle, disait-il, les philosophes
antiques étaient restés fidèles plus que tous les autres. Un premier pas vers ce retour à
l'essentiel ne devrait-il pas être aujourd'hui une nouvelle éthique du discours
philosophique, qui, parce qu'il s'est pris lui-même pour fin, est devenu trop souvent une
sophistique obscure et prétentieuse ? Pierre Hadot
Document 2 :
Socrate, qu’avons-nous fait de la philosophie ? Qu’avons nous fait de cet art de bien
vivre et de bien mourir qui mène l’homme au bonheur véritable ? N’avons nous pas
oublié qu’elle était une voie de dépassement et de transcendance de soi ? Avons-nous
oublié qu’il y a “Sophia” dans “philosophie” ? Pendant des siècles, elle fut l’esclave
intellectuel de la théologie, mais maintenant qu’elle a été libérée de ces chaînes et qu’elle
a contribué de manière décisive au mouvement de libération de l’Humanité, pourquoi
n’est-elle pas réellement libérée et restaurée ? Aurait-on peur de sa force critique et
révolutionnaire ? Pourquoi n’a-t-elle pas repris sa place en pleine lumière, au cœur de la
cité, au cœur des hommes et de leurs préoccupations ? Pourquoi l’enseignement de la
philosophie n’est-il plus aujourd’hui qu’un triste enseignement de l’histoire des idées,
réduit à la philosophistique ? Où sont les écoles du Jardin, du Lycée ou du Portique où
l’on n’enseignait pas seulement des idées philosophiques mais avant tout une éthique de
vie, à travailler sur soi pour se libérer de ses problématiques, un art de vivre, de ressentir
et d’être ? Le philosophe ne se mesurait pas seulement à son éloquence et à ses
lectures mais surtout à la qualité et à la nature de ses actions, à son éthique publique et
privée, à sa manière de réagir face à l’adversité, à sa manière d’être dans les moments
joyeux ou pénibles, face au plaisir et au devoir, dans ses relations avec les autres êtres
humains, à sa manière de cultiver l’ouverture d’esprit et un constant émerveillement et
étonnement curieux sur le monde. Pourquoi avons-nous presque rendu la philosophie
incompatible avec le restant des activités humaines ? Socrate, qu’avons-nous fait de la
philosophie ? Ce que nous appelons philosophie aujourd’hui est une ombre de
philosophie. [...]
Depuis sa création en 1969, notre association est engagée dans la Renaissance
Philosophique, ce mouvement initié à la fin du 19ème siècle qui essaye de rétablir la
philosophie dans sa plénitude, sa spécificité et sa finalité par rapport à l’individu et à la
société. Le plus souvent aujourd’hui, la philosophie est une philosophie académisée,
universitarisée, professorisée, agrégationnée; faisant du philosophe un penseur
professionnel, elle est à un tel point exclue de la vie humaine qu’en général, les gens ont
Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4302 : “Les philosophes présocratiques” - 28/12/2013 - page 4

du mal à penser que l’on puisse être philosophe sans être professeur de philosophie.
Enseignée comme une discipline technique avec examens, notes et contrôles, entre
l’histoire, la géographie et les mathématiques, la philosophie est assimilée à un jeu
rhétoricien d’idées et de concepts dont on ne voit plus trop l’intérêt. Au mieux, elle est
traitée comme un art du raisonnement et du questionnement qui vise à penser par soi-
même de manière plus lucide, plus rationnelle, où l’on se contente d’exposer les
différents courants philosophiques afin ensuite de choisir la philosophie qui nous
conviendrait le mieux en fonction de notre personnalité. Les notions de philosophes et
d’actions semblent aujourd’hui incompatibles, le philosophe apparaissant le plus souvent
comme planant dans un univers de concepts éthérés, métaphysiques et déconnectés de
la réalité humaine concrète; alors que sans action il n’y a pas de philosophes mais
penseurs, théoriciens, intellectuels, idéologues, sophistes ... [...]
La Renaissance Philosophique passe en premier par un retour à l’essentiel de la
philosophie, à savoir la démarche philosophique, cette quête de sagesse qui pousse à
s’améliorer, à se dépasser et à se perfectionner à travers l’ensemble des activités la vie.
En un mot à se transcender. La démarche philosophique est plus qu’une activité de
réflexion pour rechercher la meilleur voie d’agir et de penser, c’est une démarche de vie
constante qui investit en les modifiant et les qualifiant toutes les activités,
professionnelles et privées. La démarche philosophique ne consiste pas à consacrer un
moment particulier dans la semaine pour l’entretien des capacités critiques de notre
cerveau, comme on va faire un jogging ou entretenir son corps dans une salle de sport,
au contraire c’est une recherche de qualité supérieure de conscience et d’état d’être, sept
jours sur sept, dans tous les instants du quotidien, hic et nunc. Roman Wallis
La renaissance de la philosophie
Association ALDÉRAN © - Cycle de cours 4302 : “Les philosophes présocratiques” - 28/12/2013 - page 5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%