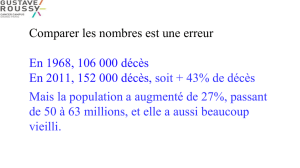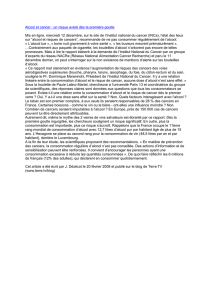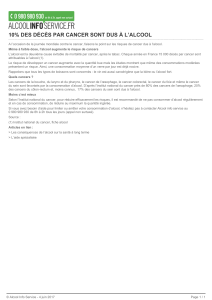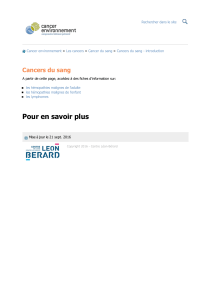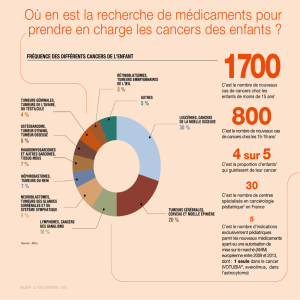épidémiologie, cancérogenèse, développement tumoral, classification

1.10.138
1420 BOOK DES ECN
Cancer : épidémiologie, cancérogenèse,
développement tumoral, classification
Christophe Massard
I. Épidémiologie
Le cancer est une maladie très fréquente et représente la première cause de mortalité en France chez les hommes et la
deuxième chez les femmes derrière les maladies cardiovasculaires. Il a été estimé que le nombre de cancers en France,
en 2009, est de 346 900 nouveaux cas de cancers (197 700 hommes et 149 200 femmes). Les données de mortalité ob-
servées pour l’année 2007 sont disponibles auprès du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc)
de l’INSERM. Les projections d’incidence pour l’année 2009 sont réalisées à partir des données d’incidence observées
jusqu’en 2005 dans les départements où il y a un registre et à partir des données de mortalité observées jusqu’en 2007.
En 2007, il y a eu 149 000 décès par cancer en France : 89 000 hommes et 60 000 femmes.
Le taux d’incidence (pour 100 000 personnes/année) des cancers en France est estimé pour 2009 à 319 pour 100 000 ha-
bitants/année (378 pour 100 000 hommes/année et 262 pour 100 000 femmes/année).
Cancers les plus fréquents et les plus mortels en 2009
Les quatre cancers les plus fréquents en France sont les cancers de la prostate (71 000 nouveaux cas estimés), du sein
(52 000 cas), du côlon-rectum (40 000 cas) et du poumon (34 000 cas) et représentent 57 % de l’ensemble des cancers
survenus en 2009.
La forte proportion de cancer de la prostate est le résultat de la pratique du dépistage par PSA au cours de ces dernières
années. De plus, la mortalité par cancer du poumon continue de croître dans la population féminine et représente 11 %
des décès par cancers dans cette population pour l’année 2007.
Patients Type de cancers Incidence (cas)
Homme Prostate
Poumon
Côlon-rectum
Bouche, pharynx, larynx
Vessie
71 000
25 000
21 000
10 500
9 000
Femme Sein
Côlon-rectum
Poumon
Endomètre
Ovaire
Mélanome
51 700
18 700
9 200
6 300
4 400
4 000
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

1.10.138
BOOK DES ECN 1421
Patients Type de cancers Mortalité (décès)
Homme Poumon
Prostate
Côlon-rectum
Foie
Bouche, pharynx, larynx
21 000
8 900
9 200
5 400
3 600
Femme Sein
Côlon-rectum
Poumon
Pancréas
Ovaire
11 300
8 200
7 300
3 800
3 100
Les principaux facteurs de risque sont :
Principaux cancers Facteurs de risque Exemple de méthode
de prévention
Sein Estrogènes
Côlon-rectum Une alimentation riche en graisses
et pauvre en fruits et légumes
Alimentation particulière
Prostate Androgènes
Poumon Tabac Arrêt du tabac
Voies aérodigestives supérieures Tabac et alcool Arrêt du tabac et de l’alcool
Vessie Tabac Arrêt du tabac
II. Histoire naturelle des cancers
Il est reconnu que le cancer à une origine monoclonale, une seule cellule se transforme puis se divise et du fait de l’insta-
bilité génétique, les cancers sont hétérogènes et composés de populations polyclonales. Le cancer est donc une maladie
« génétique » (au sens que plusieurs altérations moléculaires d’oncogènes et anti-oncogènes coopèrent pour aboutir à la
formation du cancer) multifactorielle.
Les oncogènes sont tout gène auquel une anomalie quantitative ou qualitative confère la propriété de transformer une
cellule normale en cellule maligne. Une anomalie génétique touchant une seule copie d’un oncogène est suffisante : effet
dominant. Exemples de gènes codant pour des oncoprotéines intervenant dans la régulation du cycle cellulaire ou dans
la signalisation cellulaire.
Les anti-oncogènes ou gènes suppresseurs de tumeurs sont des régulateurs négatifs de la croissance cellulaire. C’est la
perte de leur fonction qui permet la transformation tumorale. Action récessive : la perte d’activité des gènes nécessite
l’altération des deux allèles. Deux étapes successives sont donc nécessaires : la première étape peut être somatique (can-
cer sporadique) ou germinale (cancer héréditaire). Si la première étape est de type germinal (transmission héréditaire
d’un allèle muté), le gène agit alors comme un facteur de prédisposition à un cancer héréditaire. Dans les deux cas de
figure, l’atteinte du second allèle est somatique et peut aboutir à l’émergence d’un clone de cellules transformées.
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

1.10.138
1422 BOOK DES ECN
Un délai de cinq à trente ans entre l’apparition de la première cellule cancéreuse et l’émergence clinique du cancer est
souvent nécessaire.
Plusieurs altérations moléculaires ont été décrites et sont schématiquement classées en 6 grandes familles d’anomalies
moléculaires :
– activation des voies de transduction du signal permettant une prolifération cellulaire ;
– indépendance par rapport aux signaux d’inhibition de croissance ;
– potentiel invasif et métastatique ;
– résistance à la « mort cellulaire », dite apoptose ;
– potentiel de néoangiogenèse ;
– potentiel d’immortalisation avec activation de la télomérase.
Ainsi, la néoangiogenèse est indispensable lorsqu’une tumeur dépasse 2 à 3 mm3, et ainsi inhiber l’angiogenèse est une
nouvelle voie thérapeutique (bévacizumab, sorafénib, sunitinib).
– Les cellules tumorales ont la capacité de former des néovaisseaux à partir de cellules endothéliales normales, permet-
tant le développement d’une tumeur ;
– principaux facteurs angiogéniques : le VEGF (facteur de croissance vasculaire épithélial), le FGF (facteur de croissance
des fibroblastes) ou le PDGF (facteur de croissance dérivé des plaquettes).
Deux concepts permettent d’expliquer la carcinogenèse :
– le concept de cancérogenèse de champs : tout l’épithélium soumis à un même toxique (le tabac par exemple) est à
risque de se cancériser expliquant la possibilité de cancers multiples synchrones ou métachrones ;
– le concept de carcinogenèse multiétape : plusieurs anomalies moléculaires sont nécessaires pour la formation du
cancer.
Une révolution conceptuelle a commencé à la fin des années 1990 et a permis de mettre en évidence que les cancers
sont des maladies dues à l’accumulation d’altérations moléculaires, qui peuvent être inhibées par de nouvelles thérapies
appelées thérapies moléculaires ciblées.
La prise en charge des patients atteints de cancer a été complètement bouleversée à la fin du siècle dernier par la mise à
disposition de nouveaux traitements appelés thérapies ciblées ou plus exactement thérapies moléculaires ciblées (TMC).
La terminologie « thérapies moléculaires ciblées » fait référence à des stratégies thérapeutiques dirigées contre des ano-
malies moléculaires supposées impliquées dans le processus de transformation néoplasique. Le développement de ces
nouveaux médicaments est en fait parallèle au développement d’une vision moléculaire et non plus seulement clinique
et morphologique de la maladie cancéreuse. Les progrès de la biologie permettent aujourd’hui de commencer à classer
les cancers en fonction de l’organe (cancer du poumon, de la peau) mais surtout en fonction des altérations moléculai-
res impliquées dans la progression du cancer et donc d’espérer proposer une thérapeutique spécifique à chaque patient.
Ces TMC se distinguent des médicaments cytotoxiques anciens (alkylants, antimétabolites…) ou récents (inhibiteurs
de topo-isomérase et taxanes), même si ces agents inhibent aussi une cible (microtubules, ADN). En effet, les cibles
des chimiothérapies classiques sont classiquement en rapport avec les propriétés de prolifération accélérée des cellules
tumorales et ne sont le plus souvent pas directement impliquées dans le processus de transformation néoplasique. Il ne
s’agit cependant pas d’un concept tout à fait nouveau en cancérologie, car les modulations hormonales, réalisées pour
le traitement des phases métastatique ou adjuvante du cancer du sein, de la prostate ou de la thyroïde, ont démontré de
longue date leur bénéfice thérapeutique. Ces traitements peuvent être considérés comme les ancêtres des TMC, car ils
agissent sur des anomalies moléculaires de cancers hormonodépendants, et ces récepteurs hormonaux (aux estrogènes
pour le cancer du sein, récepteurs aux androgènes pour le cancer de la prostate) sont bien directement impliqués dans
le processus néoplasique. À ce jour, plus d’une dizaine de thérapies ciblées ont l’AMM pour le traitement de patients
atteints de cancer avancé ou en situation adjuvante (Tableau 1).
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

1.10.138
BOOK DES ECN 1423
III. Classification des cancers
Différentes classifications des cancers sont possibles, en fonction du type histologique, du stade et des altérations
moléculaires.
III.1. Classification en fonction du type histologique
Carcinomes
Développés aux dépens des épithéliums
•Carcinomesépidermoïdes
Développés aux dépens d’un épithélium malphigien (bronches, ORL, col utérin…)
•Adénocarcinomes
Développés aux dépens d’un épithélium glandulaire (sein, pancréas, tube digestif, bronches…)
•Carcinomesparamalpighiens
Développés aux dépens d’un épithélium transitionnel (voies excrétrices urinaires)
Sarcomes
Développés à partir du tissu mésenchymateux, classés en fonction de leur tissu d’origine
•Ostéosarcome Os
•Liposarcome Graisse
•Léiomyosarcome Muscle lisse
•Rhabdomyosarcome Muscle strié
•Fibrosarcome Tissu conjonctif
Tumeurs d’origine ectodermique
•Neuroectodermiques
Gliomes,épendymomes,tumeursdesplexuschoroïdes
•Mésoectodermiques
Méningémiomes, ganglioneurones, sympathoblastomes, schwannomes, mélanomes, tumeurs endocrines
Tumeurs embryonnaires
•Tumeursgerminales
•Neuroblastome
•Néphroblastome
Tumeurs mixtes
Association de structures diverses, elles sont rares et ont le pronostic du contingent tissulaire de plus forte malignité
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN

1.10.138
1424 BOOK DES ECN
III.2. Classification en fonction du stade TNM
C’est la classification pronostique principale. Il s’agit d’une classification clinique qui peut être affinée par l’étude histo-
logique, on écrit alors pT, pN ou pM. Cette classification est indispensable dans la majorité des cancers, car elle permet
le plus souvent d’établir la stratégie thérapeutique (le type de traitement et sa séquence) : chirurgie ou non, chimiothé-
rapie première, adjuvante ou complémentaire, radiothérapie.
Tumeur primitive (T pour
tumor
) Les quatre sous-types varient en fonction de la taille ou de la
profondeur d’envahissement. Les T1 et 2 sont en général de bon
pronostic, et les T3 et 4 le sont nettement moins
Envahissementganglionnaire(Npournode)Ensonabsence(N0),lepronosticestbienmeilleur.Dansbeaucoup
de cancers comme les cancers du sein, le nombre de ganglions
envahis a une grande importance
Extension métastatique (M pour metastasis)Dans la majorité des cancers (en dehors des tumeurs germinales),
l’existence d’une métastase rend la survie à 5 ans quasi nulle.
En général, des métastases osseuses sont de meilleur pronostic que
les métastases viscérales
Autres classifications d’extension tumorale
Elles utilisent le plus souvent le même principe :
•classicationFIGO(Fédérationinternationaledegynécologieobstétrique)pourlescancersdel’ovaireetdel’utérus;
•classicationdeDukespourlescancerscolorectaux,quiestdemoinsenmoinsutiliséeauprotdelaclassicationTNM;
•classicationenstadesIàIVpourlescancersbronchiquesoudutesticuleparexemple:lesstadessontenfaitdénis
selon le TNM ;
•classicationdeBreslowpourlesmélanomesmalins:épaisseurdepeauenvahieparlemélanome.
III.3. Classification en grades histopronostiques
Cette classification tient compte de la différenciation des tumeurs. Une tumeur bien différenciée, de grade I, aura un
meilleur pronostic qu’une tumeur indifférenciée de grade III. Cette classification est affinée en prenant en compte des
critèresmorphologiques(anisocytose)etlenombredemitosesdanslecancerdusein(gradeSBR).
III.4. Envahissement des marges de la pièce opératoire
R 0 Marges saines à l’analyse histologique
R 1 Marges envahies microscopiquement
R 2 Marges envahies macroscopiquement
•Desmargespositivessontdemauvaispronostic
La présence d’emboles tumoraux vasculaires ou lymphatiques et d’engainements périnerveux. Ces éléments sont de
moins bon pronostic.
III.5. Classification en fonction des marqueurs tumoraux
D’une façon générale, les marqueurs tumoraux ne sont pas pronostiques en fonction de leur taux.
Pour les tumeurs germinales, les valeurs des LDH, de l’α-fœtoprotéine et des HCG sont diagnostiques et pronostiques.
TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN
 6
6
1
/
6
100%