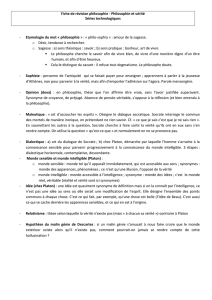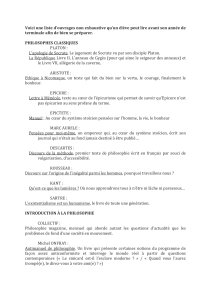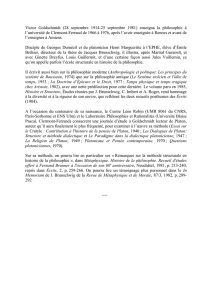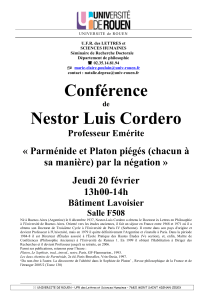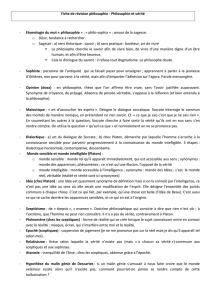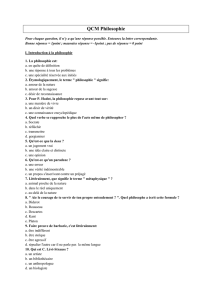tintin en amérique - Les Cahiers de l`idiotie

LE MUTISME DE LA PHILOSOPHIE
OCCIDENTALE MODERNE
j
Anne-Lise Polo

On prend pour acquis que l’Occident existe
comme une chaîne d’œuvres et d’événements
[…] qui de l’Antiquité jusqu’à nous font sens,
dont nous nous sentons collectivement les hé-
ritiers et que nous inscrivons sans y penser
dans le sens de l’histoire. Que l’histoire ait une
direction et que nous, Occidentaux nous sen-
tions porteurs de cette flèche du temps, voilà
sans doute le trait le plus puissant et le moins
questionné de notre conception du monde.
(Raconter et mourir : 12)

L’œuvre de Thierry Hentsch est, à proprement
parler, déroutante. Elle s’articule à une quête
de sens qui remet en question les idées reçues
sur lesquelles se sont construites nos certitu-
des, en particulier cette idée de flèche du temps
qui, dans la vision hégélienne du monde,
conduit à l’avènement de l’homme universel en
Occident. La conscience de l’Occident est mar-
quée par la prétention exorbitante qui consiste
à faire de son propre parcours particulier, un
chemin de vérité universelle tracé par la mar-
che rationnelle de l’histoire, une voie linéaire
marquée par le progrès. Le destin de la civilisa-
tion occidentale consisterait à éclairer le
monde, à conduire l’humanité vers son éman-
cipation, politique, morale, intellectuelle. Nulle
philosophie n’a autant que la philosophie des
Lumières davantage cru dans cette mission,
nulle philosophie ne s’est davantage « trompée
sur elle-même, sur ses intentions et sur ses
motivations » (2003 : 79).
Loin de réaliser l’émancipation de l’homme, la
pensée occidentale moderne nous a engagé
« vers un destin que nous ne sommes plus trop
certains de vouloir et que nous avons plus ou
moins renoncé à comprendre » (2002 : 12). Em-
porté comme nous le sommes dans le maels-
tröm des vérités scientifiques et de l’innovation
technologique, de la logique du marché et de la
concurrence, nos vies semblent de plus en
plus dirigées par un « progrès » qui se déroule
désormais en dehors de toute finalité humaine.
145

Arrimée aux vérités de la science, la philoso-
phie contemporaine n’a désormais plus grand-
chose à nous dire sur la place de l’homme
dans le monde. Elle se réfugie de plus en plus
dans les rares domaines qui lui sont encore
ouverts : l’épistémologie et l’éthique1. Le renver-
sement du rapport entre science et philoso-
phie, la seconde étant désormais à la remorque
de la première2, indique que l’homme
d’aujourd’hui ne sait plus comment vivre. La
philosophie contemporaine a renoncé à inter-
roger notre façon d’être au monde pour se
consacrer finalement à notre façon d’agir sur le
monde. « Où est, pour nous mortels, la vérité de
notre être au monde ? […] Voilà ce que notre
époque […] ne sait plus trop et ne cherche guère
à savoir. Voilà ce que je voudrais justement inter-
roger pour tenter de mieux comprendre ce que
nous disons ou taisons sur nous-mêmes au-
jourd’hui. » (ibid. : 11)
La critique et la dénonciation de nos idées re-
çues ne sont qu’une étape préparatoire qui
conduisent Hentsch à s’engager dans une ré-
flexion éthique qui remet en question notre vi-
sion du monde, des autres et finalement de
nous-mêmes. « Nous, Occident, savons qui nous
1 Auxquelles Hentsch ajoute l’herméneutique.
2 Notons que la séparation science/philosophie
comme deux disciplines distinctes ne semble avoir
aucun sens avant la modernité. Voir l’introduction de
Pierre Wagner (2002 : 10-65).
146

sommes. Nous sommes à la fois l’aboutis–
sement et la frontière en marche, le monde en
puissance, le bras droit de l’Histoire, la fille aînée
de la découverte et de la science. La contestation
interne de notre propre hégémonie participe elle-
même du mouvement novateur qui nous pousse
en avant, nous les porteurs du monde. Nous
sommes comme Œdipe avant la chute, rois et
maîtres. Sans limites. Aveugles à notre
aveuglement. Là où il n’y a pas de limite on ne
voit rien. À commencer par la place qu’on oc-
cupe. » (2006 : 14-15)
L’Occident est aveugle car il ne sait plus voir sa
place dans le monde ; il est sourd car il ne veut
rien entendre de l’autre et de tout ce qui le dé-
range ; il est muet car notre civilisation n’a plus
rien à dire sur le sens de la vie et semble avoir
raison de se taire. Se comprendre soi-même
dans le monde est devenu, pour Thierry Hent-
sch, une urgence éthique pour notre civilisa-
tion. La connaissance de soi, au sens socrati-
que, est à la fois la fin et le moyen de la
connaissance, elle est au service de la conduite
de la vie, le préalable à la connaissance du
monde. Cette connaissance de soi n’est donc
pas un repli sur soi ni une tentative narcissi-
que d’introspection au service de l’indi–
vidualisme de notre temps qui cherche son
épanouissement dans sa « vie privée », alors
même que la participation à la vie publique ne
semble avoir d’autre fin que de servir l’ainsi-de-
suite économique. Le savoir qui commence par
soi est la recherche de ce qui nous relie au
147
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%