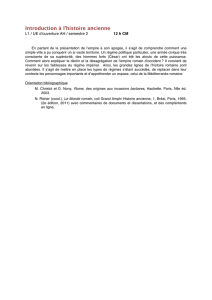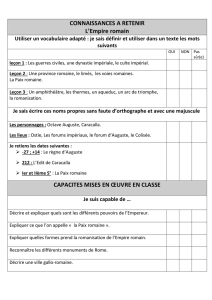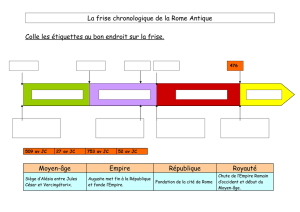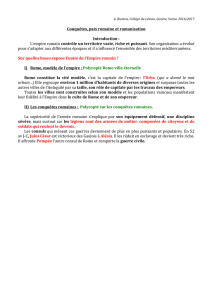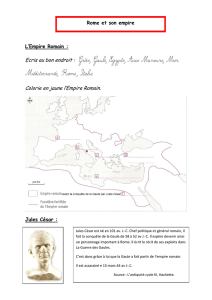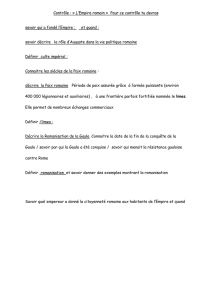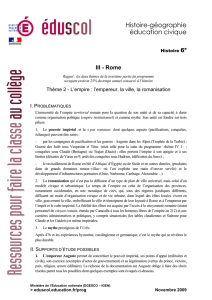6 L`Empire romain

(environ 25% du temps consacré à l’Histoire)
Programme officiel
– Étude du personnage d’Auguste et d’un autre empereur
important au choix.
– L’étude est conduite au choix à partir d’une villa gallo-romaine
ou du trajet d’un produit (vin, huile, métaux, céréales…).
– L’étude est conduite à partir d’une visite de l’Urbs (monu-
ments, sanctuaires, statuaire) et d’un exemple au choix d’une
ville romaine en Gaule ou en Afrique du Nord.
6L’Empire romain
pp. 94-113 du manuel
corresPondance avec le manuel
x
x : Auguste, le premier empereur, pp.96-97
x : L’empereur romain, pp.98-99
x : Lyon, capitale des Gaules, pp.106-107
x : Le commerce du vin gaulois, pp.100-101
x : Rome, capitale de l’Empire romain, pp.104-105
x : Carthage, page 111
– L’empereur dispose de l’essentiel des pouvoirs ;
il a le soutien de l’armée et fait l’objet d’un culte.
– La paix romaine, appuyée sur la puissance militaire, s’im-
pose aux provinces de l’Empire. Elle favorise la construction
d’infrastructures et le développement des échanges.
– L’Urbs, capitale de l’Empire, concentre les monuments
symboliques où le pouvoir se met en scène.
– La romanisation s’appuie sur l’urbanisation sur le modèle
de Rome, et sur la diffusion du droit de cité romaine sans
faire disparaître la diversité religieuse et culturelle.
x : L’empereur romain, pp.98-99
x : La paix romaine, pp.102-103
x : Rome, capitale de l’Empire romain, pp.104-105
x : Rome et la romanisation de l’Empire, pp.108-109
Connaître et utiliser les repères suivants :
– Le principat d’Auguste, 27 av. J.-C. - 14
– « Paix romaine », ie et i i e siècles
– L’édit de Caracalla, 212
Décrire et expliquer le rôle d’Auguste dans la vie politique
Reconnaître les principaux monuments de l’Urbs au ie siècle
Décrire une ville gallo-romaine
x : Je révise, page 113
x : Auguste, le premier empereur, pp.96-97
x : Rome, capitale de l’Empire romain, pp.104-105
x : Lyon, capitale des Gaules, pp.106-107
InterprétatIon du programme
• Le programme est centré sur trois thèmes : le rôle de l’empereur,
la Paix romaine et la romanisation de l’Empire. La ville de Rome
n’est pas négligée, puisqu’elle doit être étudiée à travers ses monu-
ments, et par son influence sur la création d’autres villes romaines
au cours de la période.
• La Paix romaine et la notion de romanisation seront l’occasion de
présenter les échanges économiques dans l’Empire romain ainsi
que les multiples influences (urbanistiques, architecturales, cultu-
relles, etc.) de Rome sur les territoires qu’elle domine.
• La notion de citoyenneté romaine et le syncrétisme religieux
seront également abordés. Quatre à cinq heures pourront être
consacrées à cette partie du programme.
Structure adoptée
• Le chapitre s’ouvre sur un dossier consacré à l’empereur Auguste,
suivi d’un cours sur l’empereur romain (exemple : Trajan). Les élèves
découvrent un régime très différent de celui de la République qu’ils
viennent d’étudier. Ensuite, la prospérité et les relations commerciales
dans l’Empire sont abordées à travers le commerce d’un produit, le vin
gaulois. Ce dossier précède le 2
e
cours, consacré à la Paix romaine.
• Conformément au programme, le dossier suivant est consacré
aux édifices emblématiques de Rome, capitale de l’Empire. Le choix
d’une ville romaine en Gaule s’est porté sur Lyon, capitale des
Gaules. Une page complète est également consacrée à Carthage, la
ville romaine d’Afrique du Nord. Le dernier cours est une synthèse
du thème de Rome et de la romanisation de l’Empire.
23
Chapitre 6 x L’em p i r e r O m a i n
> Carte interactive :
– L’Empire romain au i i e siècle
> Vidéo :
– Rome, capitale d’empire
> Fiches d’activités :
– L’empereur romain – La paix romaine
– Rome, et la romanisation – Je révise
– B2i : Analyser une reconstitution virtuelle d’un bâtiment :
Les thermes de Cluny à Paris
VoS outIlS pour ce chapItre

24
[pp. 94-95]
L’Empire romain
x x Problématique
Sur quelles bases repose l’unité de l’Empire romain ?
Cette problématique globalise les principaux thèmes proposés par
cette partie du programme : autorité de l’empereur, prestige de la
ville de Rome, prospérité due à la paix romaine et diffusion de la
citoyenneté, comme ciment de l’Empire.
x x Réponses aux questions
Doc. 1. Aucune ville à l’époque n’est aussi peuplée que Rome (plus
d’un million d’habitants au i i
e
siècle), et ne comporte autant d’édifices
et de monuments (politiques, religieux, de loisirs), hérités de la période
républicaine ou bâtis à l’initiative des empereurs successifs. Il n’est
donc pas étonnant que la ville suscite l’admiration de ses visiteurs.
Doc. 2. Marc Aurèle est représenté sur un piédestal, mais il semble
également à l’écoute des citoyens, qu’il regarde directement. Cette
œuvre suggère donc à la fois le respect pour l’empereur et une cer-
taine proximité de celui-ci avec les citoyens.
[pp. 96-97]
Auguste, le premier empereur
x x Problématique
Comment Auguste transforme-t-il le gouvernement de Rome ?
Les historiens romains insistent sur la sagesse et l’autorité naturelle
du premier empereur romain. C’est pourtant Auguste qui met défini-
tivement fin au régime républicain. À partir de son règne, l’essentiel
du pouvoir à Rome passe entre les mains de l’empereur.
x x Réponses aux questions
1)
Doc. 1 et 2. Auguste est lié à César, dont il était le petit-neveu,
mais surtout le fils adoptif. Cette filiation participe de la nature
religieuse de son pouvoir, puisque César prétendait lui-même des-
cendre de la déesse Vénus.
2)
Doc. 3. Selon Tacite, Auguste arrive au pouvoir en ayant mis habi-
lement de son côté l’armée et le peuple par des « cadeaux ». Il lui
est aussi reconnu d’avoir rétabli la paix, après des années de guerre
civile. Dion Cassius compare Octave Auguste à un roi, parce qu’il
concentre tous les pouvoirs entre ses mains (Tacite fait référence à
l’autorité du Sénat et des magistrats).
3)
Doc. 5. Le Sénat honore Auguste parce qu’il est parvenu à
soumettre des tribus ligures encore révoltées contre Rome. C’est
donc l’empereur victorieux qui est honoré par la construction du
monumental Trophée des Alpes, dont la légende précise qu’il était
surmonté d’une statue géante d’Auguste.
4)
Doc. 4. Après sa mort, Auguste est divinisé par le Sénat romain.
Cette représentation le montre assis sur le trône des dieux. Il est
donc comparé à Jupiter, roi des dieux romains.
5)
Doc. 1, 4 et 5. Les éléments rappelant le pouvoir militaire
d’Auguste sont la cuirasse et le manteau militaire sur la statue. Sa
biographie rappelle également qu’il a réorganisé l’armée romaine.
Le doc. 4 représente enfin une couronne de laurier au-dessus de la
tête de l’empereur victorieux.
La nature religieuse de son pouvoir apparaît sur la statue (la repré-
sentation d’Apollon sur la cuirasse de l’empereur) et sur le camée, où
l’on voit Auguste siéger sur le trône de dieux au milieu de divinités.
x x Bilan du dossier
Les élèves rappelleront qu’Auguste accède au pouvoir après une guerre
civile et l’élimination de son rival, Antoine. On attendra des récits qu’ils
situent le règne d’Auguste entre 27 avant J.-C. et 14. C’est la fin de la
République, l’Empereur cumulant la quasi-totalité des pouvoirs.
[pp. 98-99]
L’empereur romain
x x Réponses aux questions
Doc.2. Ce détail de la colonne Trajane illustre le pouvoir militaire
de l’empereur. Chef suprême de l’armée, il s’adresse directement
à ses soldats.
Doc.3. Entre la République et l’Empire, les changements sont nom-
breux, sur le plan des institutions. Les magistrats ne sont plus élus
par les citoyens, mais désignés par l’empereur. Ce ne sont plus
les censeurs qui recrutent les membres du Sénat, mais l’empereur
lui-même. Ce dernier dispose également du pouvoir législatif et
judiciaire, qui échappe également aux citoyens. Enfin, les finances,
l’armée et la conduite de la politique étrangère ne dépendent plus
du Sénat mais de l’empereur.
Doc.4. L’empereur attend de ses soldats qu’ils lui soient entière-
ment fidèles. On remarque que le premier devoir des soldats n’est
plus la défense de la patrie, mais le dévouement à l’empereur.
Doc.5. D’après le texte, c’est par une décision du Sénat que le culte
rendu à Octave Auguste est mis en place (titre d’ “Augustus”, vœux
dans des temples, sacrifices). Le texte précise que cette décision
fait l’unanimité parmi les citoyens. Auguste est le premier empereur
à faire l’objet d’un culte de son vivant, que l’on appellera par la suite
le « culte impérial ».
[pp. 100-101]
Le commerce du vin gaulois
x x Problématique
Comment se fait le commerce du vin entre la Gaule et l’Italie ?
À travers l’exemple du vin gaulois, il s’agit de montrer concrètement
aux élèves comment la « Paix romaine » s’accompagne d’un déve-
loppement du commerce dans l’Empire, et qu’elle entraîne un afflux
de produits et de richesses vers Rome.
x x Réponses aux questions
1)
Doc. 4. Les régions de la Gaule romaine qui produisent du vin sont
localisées autour de Bordeaux (Aquitaine), le long de la vallée du
Rhône et dans le Languedoc (province romaine de Narbonnaise).
2)
Doc. 1. La maison du maître est un très vaste bâtiment. La rési-
dence donne une impression de luxe, renforcé par une piscine au
centre d’un espace paysager. Les bâtiments à gauche sont sans
doute consacrés aux activités viticoles. On peut supposer qu’ils
abritent un pressoir, et la taille de l’édifice s’explique sans doute par
l’entreposage des tonneaux de vin. Le domaine agricole est étendu.
La plus grande partie de l’espace est consacrée au vignoble, mais
on distingue également ce qui ressemble à des arbres fruitiers.
3)
Doc. 3 et 4. Le vin est transporté par des bateaux, sur la Garonne
et le Rhône. Puis, il est acheminé sur des charrettes qui empruntent
alors les voies romaines. Le tonneau remplace l’amphore parce qu’il
est plus pratique à transporter (on peut le faire rouler) et à stocker,
et qu’il est moins fragile que l’amphore, qui parce qu’elle est en
terre cuite peut se casser.
4)
Doc. 2 et 5. Les Romains utilisent le vin gaulois de deux façons.
Ils le consomment au cours des repas, mais ils l’utilisent également
en cuisine, pour réaliser des sauces.

25
Chapitre 6 x L’em p i r e r O m a i n
correspond aux forums impériaux, à proximité de l’ancien Forum
républicain.
2)
Doc 1 et doc p. 94. Sous l’Empire, Rome donne l’impression d’être
une ville vaste, s’étendant sur une grande superficie, à l’habitat
dense. Surtout, le nombre de ses édifices publics et de ses monu-
ments impressionne.
3)
Doc. 1, 3, 5 et 6.
Bâtiments de loisirs Bâtiments religieux
– Le Colisée (combats de
gladiateurs)
– Théâtre de Marcellus
– Sur le plan, on distingue éga-
lement : plusieurs cirques et
théâtres, des thermes, le stade,
la naumachie d’Auguste, etc.
– Le Panthéon
– Sur le plan, on peut égale-
ment citer les temples d’Isis
et de Claude.
4)
Doc. 1. L‘Empire est gouverné par l’empereur à partir des palais
impériaux, situés sur la colline du Palatin.
5)
Doc. 1, 2, 4 et 7. Les empereurs donnent leur nom aux édifices
qu’ils construisent pour s’assurer gloire et postérité. De leur vivant,
ils souhaitent s’attirer l’admiration et la reconnaissance de leur
peuple. Et ils pensent certainement qu’après leur mort, les édifices
qu’ils ont fait bâtir marqueront la ville de leur empreinte.
x x Bilan du dossier
Les élèves devraient citer plusieurs catégories d’édifices (monuments
religieux, arc de triomphe, bâtiments de loisirs, etc.) et en nommer
quelques-uns avec précision. Ils pourront expliquer pourquoi de nou-
veaux édifices sont sans cesse construits, à l’initiative des empereurs.
[pp. 106-107]
Lyon, capitale des Gaules
x x Problématique
Quelles sont les caractéristiques d’une ville gallo-romaine ?
Les élèves doivent pouvoir retrouver dans ce dossier des édifices
et des monuments qu’ils ont étudiés dans le dossier sur Rome. On
leur fera également remarquer le quadrillage urbain, caractéristique
des villes romaines. Ils retrouveront ces éléments dans l’exercice
sur Carthage, p. 111.
x x Réponses aux questions
1)
Doc. 3 et 4. Lyon est construite à la confluence de la Saône et
du Rhône. Cette situation constitue déjà un élément favorable aux
échanges.
2)
Doc. 1 à 3. On retrouve à Lyon certains édifices et certains lieux
caractéristiques de Rome : les forums, le théâtre, l’odéon, le cirque,
l’amphithéâtre. Et comme Rome, la ville de Lyon est approvisionnée
en eau grâce à un aqueduc.
3)
Doc. 3 et 4. Lyon abrite le Sanctuaire des Trois Gaules, dans
lequel des délégués représentant les tribus gauloises viennent célé-
brer chaque année le culte de l’empereur. C’est l’empereur Claude
qui a fait de Lyon la capitale des Gaules.
4)
Doc. 4. D’après Strabon, Lyon est au carrefour des grandes rou-
tes de l’Aquitaine, de la Manche, du Rhin et de la Narbonnaise. Cette
position de carrefour commercial a fait la prospérité et la richesse
de la ville.
x x Bilan du dossier
Les élèves devraient avoir retenu que Lyon est une ville prospère,
animée et qu’elle abrite des lieux et des édifices semblables à ceux
x x Bilan du dossier
On attendra des élèves qu’ils citent les régions de production viticoles
en Gaule, et qu’ils utilisent les termes de « villa » et de « vignes » ou
« vignobles ». Les récits devraient également préciser par quels modes
de transports le vin est acheminé vers l’Italie (évoquer les tonneaux
qui remplacent les amphores), où il est consommé comme boisson ou
utilisé comme ingrédient en cuisine.
[pp. 102-103]
La paix romaine
x x Réponses aux questions
Doc.1. L’empereur Hadrien a fait construire cette ligne de fortifica-
tion en Bretagne (Angleterre), afin de protéger cette partie de l’Em-
pire des incursions des guerriers « barbares » Scots.
Doc.2. Les voies romaines permettent un déplacement rapide des
légions. Celles-ci peuvent intervenir plus vite en cas de révolte ou
d’incursion d’une armée ennemie dans l’Empire. Sur le plan com-
mercial, elles permettent un développement des échanges, qui se
font à l’échelle de tout l’Empire.
Doc.3. L’Empire est protégé par une frontière fortifiée (le Limes).
Celle-ci est constituée de remparts, de tours de guet et des garnisons
de légionnaires sont positionnées à intervalles réguliers le long de
cette frontière. On remarque que cette frontière fortifiée n’est pas
continue. Les Romains l’ont mise en place à des endroits vulnérables,
susceptibles d’être envahis par des peuples « barbares ». La carte
montre également la provenance de produits acheminés à Rome
depuis tout l’Empire. Les principaux produits alimentaires sont l’hui-
le, le blé, et le vin. Les produits de luxe sont les métaux précieux, l’or
en particulier, les pierres précieuses, ainsi que la soie en provenance
de Chine et les épices importées d’Orient. Les esclaves viennent
d’Afrique noire et d’Europe (Europe du Nord et Europe centrale et
orientale), c’est-à-dire de régions extérieures à l’Empire.
Doc.4. La ville d’Ostie, située à l’embouchure du Tibre, abrite le port
par lequel les marchandises transitent vers Rome. Son importance
est donc capitale, dans la mesure où, comme le montre la carte, la
paix romaine entraîne un développement commercial tel que des
produits de toutes natures affluent, convergent vers Rome depuis
l’ensemble du monde romain et même au-delà.
[pp. 104-105]
Rome, capitale de l’Empire romain
x x Problématique
Qu’est-ce qui fait de Rome la capitale de l’Empire ?
Il s’agit de montrer aux élèves le rayonnement de Rome à travers
l’ensemble de l’Empire. Ils devront repérer quels édifices font de
Rome une grande capitale. Dans les pages suivantes de ce chapitre,
ils reconnaîtront certains d’entre eux dans d’autres villes, parfois
situées aux confins de l’Empire.
x x Réponses aux questions
1)
Doc. 1 et plan p. 81. Depuis la période étrusque, la ville s’est
tout d’abord étendue en direction du Nord-Ouest. Elle s’est aussi
enrichie de nombreux monuments et édifices. Il ne subsiste de la
période étrusque que les palais royaux, le grand cirque, le Forum
et le temple de Jupiter. Le Colisée est situé au pied de la colline de
l’Esquilin. L’arc de triomphe de Vespasien et Titus près du forum,
au Nord-Est du Palatin. Le Panthéon se trouve au Nord-Ouest du
Capitole, à côté des thermes de Néron. Le théâtre de Marcellus
est situé entre le Tibre et le Capitole. Enfin, le forum d’Auguste

26
Ce sont les plus nombreux. Au-dessus d’eux, il existe une élite com-
posée de sénateurs, de magistrats et d’hommes d’affaires.
3 Décrire une ville de l’Empire romain
1)
Carthage est située dans la province romaine d’Afrique du Nord.
2)
La ville est totalement détruite par les Romains, en 146 avant J.-C.,
sous la République, à la fin de la guerre entre Rome et Carthage. Elle
est refondée en 27 avant J.-C. par Auguste.
3)
Les rues se croisent à angle droit, forment un quadrillage, un plan
en damier, autour des deux axes majeurs, l’un Nord-Sud (le cardo)
et l’autre Est-Ouest (le decumanus). Le forum se situe à l’intersec-
tion de ces axes.
4)
Les thermes, le forum, l’odéon, le théâtre, l’amphithéâtre, le
cirque et l’aqueduc, qui approvisionne la ville en eau, montrent que
Carthage est une ville romaine.
Pour cet exercice, les attentes sont similaires à ceux du récit
sur Lyon, p. 107. Les élèves devraient évoquer les différents élé-
ments urbanistiques et architecturaux qui font de Carthage une ville
romaine. On peut attendre des élèves qu’ils évoquent les loisirs liés
aux lieux cités.
4 Décrire une construction romaine
1)
Le pont du Gard a deux rangées d’arches superposées. La canali-
sation d’eau se trouve au sommet de la plus haute rangée.
2)
Ce pont sert à la fois de route, puisqu’une voie romaine passe
au-dessus de la première rangée d’arche, et d’aqueduc, comme
l’indique la canalisation d’eau.
3)
Pour construire le pont, les bâtisseurs ont utilisé des échelles,
des poulies, des treuils, ainsi que des systèmes d’échafaudages.
4)
Le pont du Gard est étonnamment bien conservé, ce qui prouve la
qualité et la solidité des constructions romaines au fil des siècles.
5)
Cet ouvrage d’art, particulièrement spectaculaire, n’est qu’un
exemple des qualités de bâtisseurs des Romains. Les voies romai-
nes, les villes construites dans tout l’Empire et les différents monu-
ments étudiés dans ce chapitre en sont autant d’autres exemples.
[pp. 113]
1 Se repérer dans l’espace
1)
Lyon = I ; Gaule = B ; Asie Mineure = G ; Bretagne = A ; Italie
= E ; Afrique du Nord= D ; Espagne = C ; Grèce= F ; Égypte = H ;
Rome = J
2)
Le deuxième point de la légende représente les frontières forti-
fiées, le limes. Le troisième point représente les voies romaines.
2 Se repérer dans le temps
1)
– 27-14 : principat d’Auguste ; i
er
et i i
e
siècles : paix romaine ; 212 :
édit de Caracalla
2)
On attend des élèves qu’ils sachent écrire quelques lignes sur
chacun de ces repères. Ainsi, ils devraient avoir retenu qu’Auguste
est le premier empereur romain, et que c’est sous son principat
que l’empereur concentre l’ensemble des pouvoirs et fait pour la
première fois l’objet d’un culte.
Pour la paix romaine, les élèves devraient être capables d’expliquer
qu’il s’agit d’une période de deux siècles, au cours de laquelle l’Em-
pire connaît une période de prospérité et de sécurité.
Ils doivent enfin savoir que Caracalla est un empereur romain qui,
par un édit, a étendu la citoyenneté romaine à tous les hommes
libres de l’Empire.
3 Composer des expressions
1. Expressions : culte impérial, droit de cité, arc de triomphe, empire
romain, paix romaine, pouvoir absolu.
que l’on trouve à Rome. Les récits devraient citer ces lieux ainsi que
des exemples de monuments, et évoquer les activités des habitants
d’une ville qui est également un grand carrefour commercial.
[pp. 108-109]
Rome et la romanisation de l’Empire
x x Réponses aux questions
Doc.1. Les habitants de cette ville, comme ceux des autres grandes
villes romaines, pouvaient assister à des combats de gladiateurs,
parfois agrémentés de la participation de fauves ou de courses
de chars. Ces spectacles avaient lieu dans un cirque ou un amphi-
théâtre.
Doc.2. Selon ces textes, la citoyenneté romaine peut s’obtenir après
avoir servi dans l’armée, ou après avoir exercé une magistrature.
Dans les deux cas, il s’agit d’une récompense. On remarque que les
femmes, les enfants et les petits-enfants de ceux qui obtiennent la
citoyenneté romaine deviennent eux-mêmes citoyens.
Doc.3. À l’arrière-plan de la photographie, on aperçoit les vestiges
d’un temple romain. D’autre part, le sol de la maison, au premier
plan, est recouvert de mosaïques caractéristiques d’une décoration
luxueuse à la romaine.
Doc.4. À Nîmes, le culte impérial est célébré dans la « Maison car-
rée », un temple construit à cet effet au i
er
siècle.
Doc.5. L’association d’une déesse gauloise et d’un dieu gréco-
romain montre que sur le plan religieux, la romanisation n’a pas
entraîné une disparition des croyances locales dans les différentes
provinces de l’Empire. Celles-ci ont conservé leurs divinités, mais
ont également intégré à leur panthéon des dieux et des déesses
romaines. Les Romains eux-mêmes pratiquaient le syncrétisme
religieux, c’est-à-dire le mélange de leurs croyances à celles des
peuples qu’ils côtoyaient. On observera d’ailleurs qu’Apollon est à
l’origine un dieu grec adopté par les Romains.
[pp. 110-112]
1 Analyser une pièce de monnaie romaine
1)
Cette pièce date de la fin du i
er
siècle, ou plus sûrement des pre-
mières années du i i
e
siècle, puisque Trajan a régné de 98 à 117.
2)
L’empereur Trajan.
3)
Chef militaire Chef religieux Chef de l’État
Vainqueur
des Germains
Vainqueur des Daces
Général victorieux
Élu des dieux
Grand Pontife
Pouvoir de proposer
des lois
Consul
Père de la patrie
César (devenu un titre
royal à Rome)
4)
L’empereur se fait représenter ainsi pour célébrer ses victoires
et montrer son pouvoir, politique et religieux. Comme pour d’autres
empereurs romains, se faire représenter sur une monnaie sert la
propagande impériale.
2 Lire et comprendre un schéma
1)
Les provinciaux affranchis, les femmes, les enfants et les esclaves
ne sont pas citoyens.
2)
Les situations des non-citoyens ne sont pas comparables : les
provinciaux affranchis, les femmes et les enfants sont libres, alors
que les esclaves ne le sont pas.
3)
Parmi les citoyens, les gens du peuple sont au bas de la hiérarchie.
1
/
4
100%