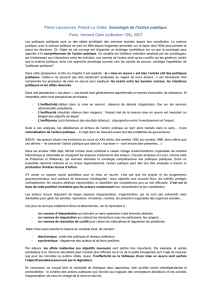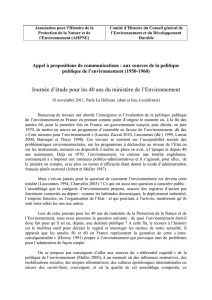Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, Sociologie de l`action publique

se révèlent particulièrement grossières. Ainsi,
lorsque M. Berger calcule « le coût réel de la pro-
tection de l’enfance » (pp. 131-133), il rajoute
allègrement le coût du bénéfice du revenu mini-
mum d’insertion ou de l’allocation aux adultes
handicapés (pendant quarante ans, précise-t-il),
voire de la prison, comme si les dizaines de mil-
liers d’enfants pris en charge adoptaient tous ces
trajectoires de vie.
Au-delà, l’ouvrage soulève deux questions impor-
tantes pour les sciences sociales aujourd’hui. En
premier lieu, celle de la place des acteurs d’un
champ dans le discours savant sur ce même
champ. M. Berger essaie de faire passer un point
de vue situé pour une description objective et
exhaustive. Or, son prisme est évidemment réduit
par les situations auxquelles il fait face dans sa
pratique de psychiatre, même s’il s’en défend au
chapitre 4, sans convaincre. En second lieu, et
c’est la conséquence de ce qui précède, l’ouvrage
s’inscrit dans une tendance lourde de psycho-
logisation tous azimuts de la question sociale, qui
minimise toute explication sociologique (1). Point
de parents fragilisés ponctuellement par des acci-
dents de vie dans ses descriptions d’enfants mal-
traités : la protection de l’enfance, selon l’auteur,
s’entend uniquement vis-à-vis de parents psycho-
pathes (psychotiques ou schizophrènes…) les
incapacités parentales décrites sont permanentes,
et la précarité une excuse « souvent utilisé[e] de
manière idéologique pour éviter de reconnaitre
les troubles psychiques réels de nombreux
parents ». Plus loin, il laisse d’ailleurs entendre
que les deux phénomènes sont corrélés, sans
développer un tel raisonnement largement
démenti par ailleurs (2).
L’intérêt de CCeesseennffaannttssqquu’’oonnssaaccrriiffiieeva donc
bien au-delà de la pertinence de l’analyse qu’il
contient. Il faut lire cet ouvrage comme un
témoignage fort sur les tensions actuelles entou-
rant la protection de l’enfance et, au-delà, l’en-
semble de l’État-providence français. Il peut éga-
lement être mis à profit par tous ceux qui
s’intéressent à la fabrication de l’action publi-
que, car il est un exemple saisissant de mobilisa-
tion de connaissances scientifiques en vue d’im-
poser une redéfinition d’un problème social (3).
Frédéric Vabre
Caisse d’Allocations familiales
du Val–de-Marne.
Recherches et Prévisions n° 93 - septembre 2008
125 Comptes rendus de lectures
Cet ouvrage pédagogique a pour objectif de pré-
senter une synthèse aussi exhaustive que possible
des différentes approches théoriques sur l’action
publique dans la littérature anglo-saxonne et fran-
çaise. Les auteurs, Pierre Lascoumes (juriste et
sociologue) et Patrick Le Galès (sociologue et
politiste) – directeurs de recherche au Centre de
recherches politiques de Sciences-Po – déve-
loppent une approche qui met l’accent sur le rôle
des instruments et des technologies de gouverne-
ment, déjà présente dans leur précédent ouvrage,
GGoouuvveerrnneerrppaarrlleessiinnssttrruummeennttss, en 2005.
Dès l’introduction, ces deux spécialistes des poli-
tiques publiques expliquent pourquoi ils ont
choisi l’acceptation désormais courante en science
politique d’« action publique » laquelle, comme
les politiques publiques, permet de « désigner
l’action menée par une autorité publique (seule
ou en partenariat) afin de traiter une situation
perçue comme posant un problème » (p. 5). Le
terme d’« action publique » rend toutefois mieux
compte des transformations dans la manière
d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques
publiques : introduction des méthodes de gestion
propres aux entreprises ; articulation de différents
niveaux (européen, national, régional, local) ceux-ci
Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès
SSoocciioollooggiieeddeell’’aaccttiioonnppuubblliiqquuee
2007, Paris, Armand Colin, collection 128, 126 pages.
(1) Voir sur ce sujet François Sicot, 2006, La psychologisation rampante de la question sociale, in LLaaFFrraanncceeiinnvviissiibbllee(sous la
dir. de Beaud S., Confavreux J et Lindgaard J.), la Découverte, pp. 618-631.
(2) Voir sur ce sujet les écrits de Maryse Bresson notamment Le lien entre santé mentale et précarité sociale : une fausse
évidence,CCaahhiieerrssiinntteerrnnaattiioonnaauuxxddeessoocciioollooggiiee, 2003:311-326 et LLaappssyycchhoollooggiissaattiioonnddeell’’iinntteerrvveennttiioonnssoocciiaallee::mmyytthheesseettrrééaalliittééss,
L’Harmattan, Paris, 2006.
(3) Ces tensions ont été abordées autour de la connaissance du phénomène de maltraitance des enfants dans Vabre F., 2005,
« L’action publique contre la maltraitance des enfants », Dossiers d’études, CNAF, n° 65 (en particulier pp. 44-72).

s’interpénétrant le plus souvent ; impact de la
mondialisation, des alliances transfrontalières, de
l’intégration européenne, des organismes interna-
tionaux, etc. Tout ceci conduit à complexifier
l’analyse même si les trois séries de variables dites
des trois « I » (*) – les intérêts, les institutions et les
idées – continuent à guider la plupart des travaux
sur l’action publique.
Les auteurs présentent et interrogent les diverses
« écoles » et théories de l’action publique à partir
de deux questions transversales : qu’est-ce qu’une
politique publique ? Comment les politiques
publiques changent-elles ? Le choix qui a prévalu
est de présenter les modèles analytiques et théo-
riques les plus significatifs et de souligner, le cas
échéant, leurs limites. L’ouvrage est divisé en cinq
chapitres. Le premier, « Une sociologie politique
de l’action publique », retrace l’évolution des
approches et des méthodes d’analyses utilisées
depuis les années 1960. Dans les premiers
travaux, plusieurs paradigmes étaient mobilisés :
celui lié à une idéologie politique avec le modèle
de la lutte des classes ; celui utilisant un cadre
des outils économiques avec la théorie du choix
rationnel ; plus classiquement, la sociologie des
organisations, des mouvements sociaux ou encore
la sociohistoire ont été mobilisés. Historiquement,
les travaux sur les politiques publiques ont
cherché l’articulation entre les régulations sociales
et politiques, et questionné la légitimité des
acteurs qui interviennent. Ils ont utilisé des métho-
dologies variées, des traitements statistiques aux
carnets et outils de gestion divers. Ces travaux se
caractérisent ainsi par « une observation précise
des programmes et des bureaucraties en action ;
une approche sectorielle ; une analyse fine des
acteurs et des systèmes d’action ; une approche
en termes de séquence, chacune étant un espace
d’action spécifique […] ;une tension entre des
travaux empiriques et la conceptualisation de
modèles […]. » (p. 12-13) Depuis, les auteurs
identifient trois ruptures dans les analyses :
•l’impact du volontarisme politique, notamment
celui de l’homme politique, a été relativisé ;
•l’unicité et l’impartialité de l’État ont été remises
en cause ;
•la prise de conscience de l’intérêt à considérer
ce qui se passe en amont et en aval d’une
décision.
Le deuxième chapitre s’intéresse plus spécifique-
ment aux analyses de mises en œuvre des poli-
tiques publiques, longtemps dominantes dans la
discipline. Les auteurs souhaitent montrer comment
on est passé d’analyses qui ont eu tendance à se
focaliser sur les échecs des politiques publiques,
leur ineffectivité et leur inefficacité à des analyses
portant sur la compréhension de leur mise en
œuvre. Cette dernière était avant tout une
question politique qui se posait aux gouverne-
ments et très tôt les sciences sociales ont été mobi-
lisées pour tenter d’expliquer ces échecs. Aux
États-Unis, on a fait prévaloir des explications
basées sur la rationalité économique qui sont
reprises aujourd’hui par l’école du Public choice,
encore dominante aux États-Unis ; elle influence
la Banque mondiale et l’OCDE, qui se propose
«d’orienter l’action publique sur la base d’un
"optimum minimum", c’est-à-dire vers des inter-
ventions publiques maximisant leur efficience en
réduisant leurs compétences aux seules correc-
tions des imperfections du marché » (p. 31). En
France prédomine, depuis les années 1960, un
courant de sociologie administrative porté par
Michel Crozier, réalisant des travaux empiriques
qui ont permis de souligner les espaces d’auto-
nomie des différents acteurs. Analyser la mise en
œuvre des politiques publiques ne consiste pas
à mesurer des résultats mais bien à tenter de
comprendre « la production de systèmes d’ordre
locaux d’action publique […] pour composer une
action publique nationale » (p. 34). Ces analyses
ont permis de montrer comment la puissance
publique est confrontée aux stratégies autonomes
de ses agents (administrations et collectivités
locales) qui développent des pouvoirs discrétion-
naires. La principale difficulté est de bien saisir les
systèmes d’acteurs et leurs interrelations alors même
que les niveaux de compétence se sont complexi-
fiés (national, régional, local, européen) et qu’ils
cumulent plusieurs compétences (décideur, finan-
ceur, évaluateur, etc.). Elles ont également permis
de montrer comment l’action des bénéficiaires des
politiques peut devenir structurante. À cet égard,
l’exemple du revenu minimum d’insertion est
éclairant. Destiné à fournir un minimum vital aux
plus pauvres, le dispositif a connu des difficultés
pour atteindre sa cible ; en effet, les « plus pauvres »
avaient bien du mal à répondre à l’ensemble des
exigences administratives tandis que des publics
« non ciblés au départ » répondaient aux critères
(agriculteurs, étudiants…).
Le troisième chapitre déplace l’analyse aux
sommets de l’État et au rôle joué par les élites et
les hommes politiques. Des travaux anglo-saxons
ont proposé d’analyser le résultat d’une politique
publique comme l’agrégation d’interactions de
décisions individuelles. Ainsi, l’école du choix
rationnel utilise des formes de raisonnement des
économistes appliquées aux sciences politiques.
Le postulat de ces microanalyses est de considérer
les politiques publiques comme le résultat de
choix d’individus égoïstes dont les décisions sont
Recherches et Prévisions n° 93 - septembre 2008
126 Comptes rendus de lectures
(*) Hall P., 1997, The role of interests, institutions and ideas in the comparative political economy of the indutrialized nations,
in CCoommppaarraattiivveePPoolliittiiccss,,RRaattiioonnaalliittyy,,CCuullttuurreeaannssSSttrruuccttuurree(sous la dir. de Lichbak M. I. et Zuckerman A. S,), Cambridge,
Cambridge University Press.

influencées par les sanctions et les incitations de
l’environnement. Pour les auteurs, les limites
méthodologiques de ce postulat sont importantes,
la formulation des préférences des individus étant
fortement simplifiée et leur mesure bien délicate.
Cependant, ce courant a eu – et continue à avoir –
une grande influence politique, fournissant des
arguments pour réduire le poids de l’État, priva-
tiser les services publics et créer des agences auto-
nomes. Pourtant, plusieurs critiques ont été
portées à l’idée de rationalité des décisions. Par
exemple, Lucien Sfez a montré dans l’exemple
de la construction du RER et de l’abandon du
projet d’aérotrain qu’il était vain de tenter d’ex-
pliquer la décision. Plusieurs auteurs suggèrent
ainsi qu’agir requiert des processus collectifs. Un
courant d’analyse relativement important en
France est celui dit « cognitif », qui a étudié l’im-
portance des représentations globales et repéré
des « référentiels ». Pierre Muller a, par exemple,
montré comment la politique agricole se transfor-
mait sous l’impulsion d’un référentiel de moderni-
sation. D’autres travaux ont porté sur les échanges
entre l’État et les groupes d’intérêt ou encore sur
les stratégies de groupes de hauts fonctionnaires.
En Grande-Bretagne, la notion de « Core Executive »
souligne le rôle joué par des instances de coordi-
nation qui pilotent, contrôlent l’action publique,
arbitrent les conflits et qui a conduit à expliquer,
par exemple, le rôle de plus en plus important du
ministère des Finances.
Le quatrième chapitre cherche à identifier comment
un problème social va s’inscrire dans l’agenda
politique. Trois approches sont identifiées qui
s’inscrivent dans un continuum. La première
s’intéresse à la manière dont les faits sociaux
deviennent des problèmes publics, la deuxième
comment ces derniers deviennent des problèmes
politiques et enfin la dernière à la mise sur agenda
proprement dite. Ces approches ont insisté sur la
construction historique des problèmes, ont souli-
gné que les motivations des décideurs n’étaient
pas forcément rationnelles et ont critiqué la pseudo-
neutralité des institutions.
Enfin, le dernier chapitre porte sur les institutions,
les normes et les instruments qui structurent
l’action publique. Toute une série de recherches
qualifiées de « néo-institutionnalisme » ont conduit
une analyse sur le rôle des institutions dans les
changements et développements de l’action publi-
que. Identifier les instruments utilisés permet
d’identifier les ressources utilisées et par qui. Les
auteurs proposent une typologie autour de cinq
modèles d’instruments : législatif et réglemen-
taire, économique et fiscal, conventionnel et inci-
tatif, informatif et communicationnel et enfin,
normes et standards.
Au final, les auteurs ont montré comment la
reconfiguration de l’action publique représente
un véritable défi pour les sciences sociales qui
sont mobilisées pour expliquer et permettre d’anti-
ciper. Les problèmes sociaux semblent indéfinis,
les acteurs se multiplient, les techniques d’inter-
vention se sont diversifiées. Les auteurs plaident
pour un constructivisme modéré. Le terme de
« gouvernance » d’importation anglo-saxonne
illustre bien les différents niveaux et formes prises
par ces interactions entre acteurs. P. Lascoumes et
P. Le Galès proposent d’envisager l’action publi-
que principalement comme une analyse de la
pratique de pouvoir. Ceci revient à tenir compte
de l’hétérogénéité des acteurs et des formes de
mobilisation dans un programme ainsi que de
l’importance des rapports politiques. Par exemple,
on constate une adaptation réciproque entre les
différents groupes et individus qui redéfinissent
des intérêts collectifs, se mobilisent et inventent
des moyens d’action, c’est-à-dire entre la société
civile et les hommes politiques. On pourrait
d’ailleurs – seules limites à souligner dans cet
ouvrage – leur reprocher de n’avoir pas abordé la
question méthodologique des comparaisons
internationales et d’avoir insuffisamment abordé
les demandes d’évaluation des politiques publi-
ques qui font appel aux chercheurs en sciences
sociales. Toutefois, dans un contexte où la révi-
sion générale des politiques publiques vise à
diminuer la dépense d’État tout en renforçant
l’efficacité et la qualité de l’action, cet ouvrage
contribue assurément à alimenter la réflexion sur
le sens des actions menées.
Sandrine Dauphin
CNAF – Rédactrice en chef
de RReecchheerrcchheesseettPPrréévviissiioonnss
Recherches et Prévisions n° 93 - septembre 2008
127 Comptes rendus de lectures
1
/
3
100%