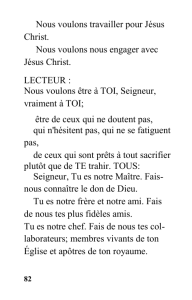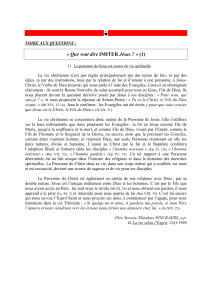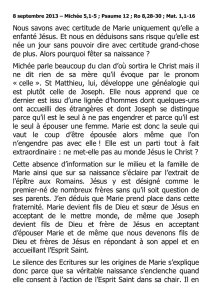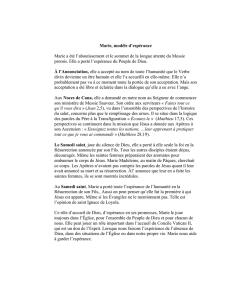Les images de Dieu

1
« Quel Dieu se révèle à nous dans les situations de souffrance »
Près de 95 visiteurs de malades du Brant wallon se sont réunis autour de Sylva Machiels ,
théologienne et animatrice pastorale, lors de deux après-midi autour du thème « Quel Dieu se
révèle à nous dans les situations de souffrance ? » .
Une première rencontre était proposée à Jodoigne rassemblant 45 visiteurs de malades le 04
décembre 2008 et une deuxième rencontre se déroulait à Tubize le 11 décembre 2008 à Tubize
réunissant une cinquantaine de visiteurs .
Nous vous proposons de retrouver ci-dessous le texte de l’exposé de Sylva Machiels.
Introduction:
Trois expériences :
-Groupe caté : « Dieu me punit »
-Carine, 13 ans, inscrite en catéchèse par sa tante et tutrice : « Il a plu à Dieu de reprendre… »,
« C’est la volonté de Dieu »…
-Robert adulte, 65 ans…son fils est décédé, il y a 6 mois dans un accident.
Une grande souffrance. « Toute ma vie, je me suis tenu loin de Dieu..Dieu était pour moi comme un
étranger, il n’entrait pas dans ma vie »
« Aujourd’hui, je voudrais découvrir Dieu » « C’est mon fils qui me fait signe… » « Il est quelque part,
avec lui »
Il est des idées courantes que l'esprit humain se fait de "Dieu", des « représentations » contaminées
par vingt siècles de traversée des cultures humaines.
Ces « images de Dieu » que nous avons dans le cœur sont aussi influencées par notre histoire
personnelle. Nous avons tous en nous une banque de données dans lesquelles nous puisons nos
représentations de Dieu. (des enseignements que nous avons reçus, des personnes que nous avons
rencontrées, des événements que nous avons vécus, des témoignages entendus, des lectures, des
conversations, les média ou diverses informations qui nous ont influencés…)
Au cours de cette formation, nous serons invités à prendre conscience des « images de Dieu » vraies
ou déformées déposées en nous et auxquelles nous recourons le plus souvent pour nous mêmes et
aussi dans nos dialogues avec les autres.
Ces représentations sont importantes car c’est à travers elles que nous entrons en relation avec Dieu
et que nous parlons de Dieu aux autres et à ceux que nous visitons . Dieu nous rejoint à travers nos
facultés humaines : l’intelligence, la volonté, mais aussi l’imagination. Il met en éveil nos sens
intérieurs pour entrer en relation avec nous (l’écoute : une parole nous touche, le regard : une
attitude, une scène de l’évangile…), et se donne ainsi à contempler. Mais Dieu est toujours plus grand
que nos représentations qui, lorsqu’elles sont bonnes, sont seulement comme différentes facettes de
Dieu. Nous ne connaîtrons Dieu vraiment que lorsque nous le verrons face à face. Dieu dépasse tout ce
que nous pouvons dire ou ressentir. Et Dieu souvent nous surprend… C’est pourquoi il nous faut sans
cesse purifier nos représentations de Dieu. Comme des idoles il faut parfois briser les images qui nous
habitent.
Proposition d’un temps de réflexion individuel
-Quel visage de Dieu s’est révélé à moi au cours de mon existence ? A travers quels événements de
ma vie ?
Quelle était cette image de Dieu à 5 ans, à 15 ans, à 35 ans, aujourd’hui ? Quand je pense à Dieu
aujourd’hui, comment est-ce que je me le représente ? Quels sont les mots que j’emploie pour dire

2
Dieu aux autres et particulièrement aux malades que je visite ?
Structuration de l’échange
Quels sont les images ou attributs de Dieu que nous portons en nous ou que nous rencontrons chez les
personnes que nous visitons, que nous entendons autour de nous, qui nous posent question ?
DIEU EST…
Effacer Dieu et remplacer par
L’AMOUR EST…
La toute-puissance de l’amour , c’est autre chose qu’une toute-puissance aimante. Une toute-
puissance aimante maintient la toute-puissance comme fond de tableau, c’est une puissance corrigée
si on peut dire par des sentiments d’amour. Or cela est propre à toutes les religions à l’origine : Dieu
est cherché comme la puissance, le sacré ; quand l’homme prend conscience de sa faiblesse, de sa
fragilité, de la précarité de sa situation, il cherche une toute-puissance qui lui soit favorable, c’est ce
qui engendre de la magie. Tandis que si c’est l’amour qui est tout-puissant, cette puissance ne peut
être qu’une puissance qui va jusqu’au bout, jusqu’à mourir.
Dieu n’est puissant qu’à aimer et à pardonner. Uniquement.
Dire que Dieu est mystère, ce n’est pas dire que Dieu est inconnaissable.
Dieu se révèle déjà dans le premier Testament, et pleinement en Jésus : « qui me voit, voit le Père »
dit Jésus, nous y reviendrons.
Mais on pourrait dire : Dieu est incompréhensible, dans le sens où nous ne pouvons saisir Dieu, mettre
la main sur lui…car ce serait la négation du mystère.
Quand nous disons que Dieu est parfait, nous ne disons pas un Dieu immobile, qui ne change pas, car
ce serait poser une éternité figée, un Dieu mort.
Dieu agit, Dieu désire, Dieu est mouvement…Il y a du nouveau en Dieu, une espérance en Dieu…
Dieu est amour, Dieu est agapê…c’est la vrai nom de Dieu, c’est l’amour tourné vers l’autre, don de
soi à l’autre…émerveillement de l’autre…Le don de Dieu ne peut être que le don de lui-même qu’il nous
fait.
Accueillir le don de Dieu, c’est accueillir le don réel de l’amour même dont s’aiment les trois Personnes
divines.
Le pardon, c’est la gratuité de l’amour, le pardon comme puissance de recréation. Si la création est
une œuvre d’amour, au cœur de la puissance créatrice, il y a une puissance re-créatrice qui re-crée
une liberté.
Le pardon,c’est une re-création, c’est la re-création d’un pouvoir de se créer soi-même.
Plutôt que parler des commandements de Dieu ou de volonté de Dieu, il vaudrait mieux, non pas biffer
ces mots, mais leur donner sens : et parler du désir de Dieu… et le désir de Dieu, c’est que nous
réalisions pleinement notre humanité.
Comment pouvons-nous purifier ces représentations de Dieu qui nous habitent? Ou que
nous rencontrons chez ceux que nous visitons.
Quel Dieu se révèle à nous dans les situations de souffrance ? Comment parler de Dieu en vérité avec
les malades que nous visitons ? Comment répondre aux représentations qui habitent le cœur de ceux
qui sont dans la souffrance et qu’ils nous confient ?
1-Dieu se révèle à nous, Dieu nous parle. Nous osons croire que Dieu nous parle à travers l’histoire,
l’histoire d’un peuple. La Bible fait le récit de cette histoire. Une médiation privilégiée de la Parole de
Dieu est la Bible.

3
Dieu s’est donné à connaître à travers l’histoire du peuple d’Israël…et ce que ce peuple a découvert de
Dieu nous concerne encore aujourd’hui.
Regardons cela de plus près :
Le peuple d’Israël a vécu deux grands moments de souffrance au cours de son histoire : L’exode et
l’exil.
L’exode : (vers 1200 avant JC) le peuple d’Israël est esclave en Egypte et subit toutes sortes de
maltraitances. Que fait Dieu ? Il appelle Moïse (rencontre entre Dieu et Moïse au buisson qui flambe
sans se consumer) « Moïse, Moïse, n’approche point d’ici, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu que
tu foules est une terre sacrée…Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le
Dieu de Jacob… » Moïse se cache le visage.
Que dit-il encore? « J’ai bien vu la détresse de mon peuple qui est en Egypte, j’ai entendu les cris.
Oui, je connais ses souffrances. Je suis venu pour le délivrer… » (connaître-co-naître-participer)
L’exil : (vers 597, jusqu’à 538) Jérusalem est détruite par les Babyloniens, le Temple est détruit, la
population est déportée à Babylone. Le peuple d’Israël est anéanti : il a perdu la terre (la terre
promise), le Temple qui était le lieu de rencontre avec Dieu est détruit et l’arche d’alliance emportée…
Dieu les aurait-il abandonnés ?
Les prophètes vont leur révéler le vrai visage de Dieu :
Que dit Dieu : « Ecoute Israël…
IsaÏe 43,1-5
Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi…Parce que tu es précieux à mes yeux et tu es en honneur et
que moi je t’aime. Ne crains pas parce que je suis avec toi.
Isaïe 49, 15-16
Une femme peut-elle oublier son nourrisson ? N’avoir point de tendresse pour le fruit de ses
entrailles ? Et quand bien même elle l’oublierait, moi je ne t’oublierai jamais. Ton nom est gravé sur la
paume de mes mains.
Jérémie 31, 33-34
Je mettrai en eux ma loi, je la graverai dans leur coeur ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Aucun d’eux n’aura plus à instruire son prochain ou son frère en disant : « Apprends à connaître le
Seigneur », car tous me connaîtront, grands et petits ; car je pardonnerai leurs fautes sans garder
aucun souvenir de leur péché.
Ezechiel 36, 25-26
Je verserai sur vous des eaux pures qui vous purifieront de toutes vos souillures et de toutes vos
abominations. Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de
votre sein votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair..vous serez mon peuple et je serai
votre Dieu
Le peuple exilé qui a d’abord ressenti l’exil comme abandon de Dieu ou punition de Dieu va découvrir
l’amour et le pardon. Puisque le Temple est détruit, leur prière s’intériorise ; ils vont inventer un temps
réservé à la prière, le sabbat…retrouver l’espérance …
Oui, Dieu veut entrer en communion avec son peuple. Il se révèle à lui comme un Dieu créateur, un
Dieu de Vie, un Dieu Sauveur, un Dieu d’alliance, Dieu pour tous les hommes. Il est l’ami, l’époux, le
Père…
La longue mémoire du peuple d’Israël sans cesse racontée, transmise oralement arrive à une oreille
éveillée par l’Esprit Saint qui découvre ces événements et les écrit comme des signes, des révélations
de Dieu.
Ces visages de Dieu nourrissent notre mémoire ; les chrétiens aujourd’hui relisent ces récits au cours
de la veillée pascale.
Les psaumes prêtent à Dieu des attitudes humaines : il se penche vers l’homme, il voit, il scrute, il
connaît, il écoute, il entend, il est proche, il accueille, il a pitié, il pardonne.
Ps 145 : Le Seigneur garde sa fidélité
Il fait justice aux opprimés
Aux affamés , il donne le pain ;

4
Le Seigneur délie les enchaînés
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles
Le Seigneur redresse les accablés
Le Seigneur aime les justes,
Le Seigneur protège l’étranger,
Il soutient la veuve et l’orphelin
Il égare le pas du méchant…
Vous me direz : et que faites-vous des expressions de la colère de Dieu que l’on rencontre dans le
premier testament, et dans les récits d’Apocalypse ?
Le mal, la violence, l’endurcissement des cœurs ( le peuple à la nuque raide), l’injustice vis à vis des
petits, des faibles, (la veuve et l’orphelin) provoquent, enflamment la colère de Dieu…une colère qui se
transforme en miséricorde pour le pécheur qui se convertit et quand le prophète intercède…
Le Dieu potier (Jr 18, 1-6) qui peut briser les vases que sont les humains rebelles peut aussi les
restaurer, non pas les réparer mais les recréer. Et ainsi se révèle une miséricorde toute puissante.
L’esprit raidi, le cœur de pierre doivent être brisés par l’Esprit de Dieu ainsi que nous lisons dans le
beau texte de Paul qui nous parle des vases de colère que Dieu a supportés avec patience devenus des
vases de miséricorde qui manifestent la puissance de son amour pour nous (Rm 9, 20-24)
Note :
« Dieu guerrier » et quelques lignes plus loin : « Dieu briseur de guerres »
La Bible est écrite par des hommes, ils écrivent leur perception de Dieu et au long de l’histoire cette
perception évolue. Les écrits sont des témoignages de foi.
La Bible n’est pas un mot, elle est un monde. Notre foi ne dépend pas d’un seul verset de la Bible.
Celle-ci est une Parole cohérente. Chaque verset est en lien avec un tout qui fait sens.
La Parole de Dieu est faite pour la Vie. Elle n’est pas une succession d’étincelles mais un feu.
2-Dieu se révèle pleinement en Jésus Christ.
On lit parfois des pages très belles sur Dieu, mais si le nom de Jésus Christ est absent, il nous manque
l’essentiel pour bien parler de Dieu. Jésus est celui qui me révèle Dieu, pas seulement par ses paroles
mais par sa vie , une vie où l’humanité est vécue en plénitude et en qui vit la plénitude de la divinité.
« Qui m’a vu a vu le Père » lisons-nous en St Jean (14,9)
En Jésus, Dieu s’est donné à voir, à toucher, à entendre, à contempler…(1Jn 1, 1-4). Jésus est la
visibilité de Dieu.
Jésus n’est jamais seul. Toute son existence témoigne d’un dialogue intérieur avec cet « autre » qu’il
nomme « Père ». Dans ce lien mystérieux et profond qu’il vit avec le Père, il puise le dynamisme qui
l’anime.
Jésus est conscient de tenir, au plus intime de soi, mais venant d’au-delà de lui-même, ce qui fait le
sens de sa vie. Cette source, il l’appelle « Père ». Sa vie, qui est ouverture à l’autre et don, porte la
marque de Dieu Père. « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a
envoyé. » (Jn 5, 30)
Le terme araméen que Jésus emploie est « Abba », un terme réservé au domaine familial. (papa) . Par
là Jésus exprime que ce qu’il est, il le reçoit.
Et Jésus nous dit le Père dans des paraboles :
Nous lisons qu’au retour du fils prodigue, le père fut « ému de compassion » (Lc 15,20). Il ne s’agit
pas d’une émotion à fleur de peau mais d’un bouleversement en profondeur.. « Mon fils était perdu et
il est retrouvé ».
Le bon berger qui va à la recherche de la brebis perdue, le vigneron, plein de sollicitude pour la vigne…
Les choix, les gestes, les mots, le combat, la mort de Jésus nous font pressentir qu’il y a en Dieu lui-
même une tendresse pour la condition humaine qui le porte à se mêler en personne au combat de
l’humanité contre le mal et la souffrance.

5
Ce Père que révèle Jésus nous libère de certaines idées courantes que l’esprit humain se fait de Dieu :
le Dieu, force cosmique, gérant et régentant l’univers (le grand architecte de l’univers) , ou le Dieu des
philosophes et des savants qui ne voient que la raison pour justifier les ordres et les désordres de
l’histoire (Dieu impassible), ou le Dieu, idée morale, juge du Bien et du Mal, surveillant pointilleux des
actes des humains. (Dieu punit). Le Dieu qui s’est donné à voir en Jésus est le « Dieu vivant qui
appelle chacun à se lever et à aller vers la vie en choisissant d’aimer. »
La maladie, le deuil, l’infirmité, l’échec, la solitude, Jésus le parcourt en tous sens. « Il passe sa vie
dans les régions les plus douloureuses de notre humanité » (Jacques Guillet)
Jésus se dit, il se veut médecin (Je ne suis pas venu pour les bien-portants mais pour les malades…).
Le bon médecin compatit et, quand il y a urgence, il se hâte « aussitôt », un mot fréquent dans
l’évangile. Il n’a qu’un but : guérir. Jésus guérit. Sans choisir : « On lui amena tous les malheureux
atteints de maladies et de tourments divers et il les guérissait » (Mt 4). Le sens de ces guérisons est la
foi, une croissance de la foi. Mais il souffre quand l’incrédulité l’empêche de faire à Nazareth des
guérisons (Mc 6,5).
Jésus se dit, se veut avocat. Le bon avocat conseille, aide, assiste, encourage. Jésus sait « ce qu’il y
a dans l’homme » (Jn2,25) et il sait que Dieu sait : « Même si notre cœur nous condamne, Dieu est
plus grand que notre cœur et il connaît tout. (1jn 3,20) » . Connaître, c’est co-naître, participer. C’est
au-dedans de lui qu’il entend combien péniblement cela grince en nous.
Aux portes de Naïn, Jésus a les « entrailles remuées » par la douleur d’une veuve dont on porte en
terre le fils unique. Il dit « Ne pleure pas » et relève aussitôt le jeune homme.
Mais au tombeau de Lazare, il pleure en voyant pleurer Marie et les Juifs qui l’accompagnent. Pourquoi
ces larmes ? Là, il est face à face avec sa propre mort. Il vient réanimer Lazare et la renommée de ce
miracle fut la cause immédiate de son arrestation et de son crucifiement. Les larmes de Jésus sont le
commencement de son agonie, elles expriment sa sensibilité devant la mort humaine.
Selon St Jean, le Père et le Fils sont un (10,30) ; le Père et le Fils agissent ensemble. C’est du Père
dont il est l’Image que le Fils reçoit cet amour qui inclut le don de la vie. Il ne sera pas donné d’image
plus parfaite de Dieu, que l’homme Jésus agonisant, outragé, crucifié.
Toute représentation de Dieu qui s’écarterait de ce déchirement à l’intérieur de la Trinité n’aurait pas
de sens. Comment croire que Dieu est Amour, s’il faut penser que notre souffrance ne l’atteint pas
dans son être éternel ?
Un Père invulnérable serait un Père sans tendresse.
3-Dans le mur qu’engendre l’angoisse de la mort, Jésus ouvre la brèche qu’il est possible d’être
humain, c’est-à-dire d’aimer jusqu’au bout. Par sa façon de vivre et de mourir, il témoigne que la
fatalité peut être brisée. L’amour est plus fort que la mort. L’amour traverse la mort et la vie s’inscrit
dans l’éternité.
(C’est bien cette vie que Robert a pressenti et qui l’a remis debout après le décès de son fils). Croire
que l’amour peut traverser la mort, c’est le désir de chaque être humain. La résurrection est un acte
de Dieu arrachant le Christ à la mort tout entière pour le faire passer à la vraie vie. Jésus en
ressuscitant est en même temps le Ressuscité et le Ressuscitant…Sa résurrection est dans le même
temps sa résurrection et celle des autres. Elle n’est pas un prodige mais une victoire. La résurrection
se reçoit de Dieu. Ce n’est pas l’être humain qui se donne la résurrection par ses propres efforts. La
résurrection est l’avenir qui vient de Dieu seul. « Il n’est pas un Dieu de morts mais de vivants » (Luc
20,38)
« Que l’amour puisse parvenir jusqu’à l’au-delà, que soit possible un mutuel donner et recevoir, dans
lequel les uns et les autres demeurent unis par des liens d’affection au-delà des limites de la mort-
cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles et reste aujourd’hui
une expérience réconfortante. Qui n’éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis
pour l’au-delà un signe de bonté, de gratitude ou encore une demande de pardon ?...Dans la
communion des âmes le simple temps terrestre est dépassé. Il n’est jamais trop tard pour toucher le
cœur de l’autre et ce n ‘est jamais inutile. Ainsi s’éclaire ultérieurement un élément important du
concept chrétien d’espérance. Notre espérance est toujours essentiellement aussi espérance pour les
autres. » (Benoît XVI Sauvés en espérance n°48)
Voir aussi Lytta Basset Ce lien qui ne meurt jamais.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%