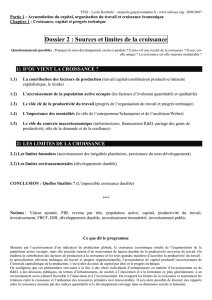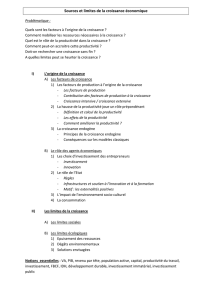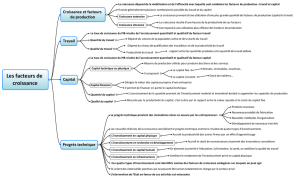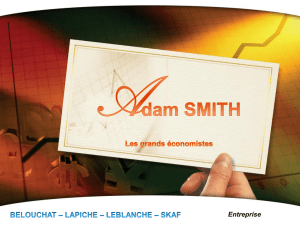Technologie et performance économique dans l`économie

Formation aux TIC en Suisse Annexe 1 : l'étude de R. Gordon
1
Technologie et performance économique
dans l’économie américaine1
Au cours de la période 1995 – 2000, l’économie américaine a « miraculeusement » généré des
résultats sans précédent notamment en terme de croissance économique. Robert J. Gordon
considère deux éléments pour expliquer le succès américain : une constellation de conditions
économiques particulièrement favorables ainsi qu’une avancé jamais vue des Etats-Unis dans le
domaine des nouvelles technologies de l’information (NTI). A partir de ces constatations, Gordon
détermine empiriquement l’impact des TI en matière d’accroissement de la productivité par sec-
teurs.
Des conditions macréconomiques favorables
C’est la conjonction de conditions économi-
ques extrêmement favorables qui a constitué
le terreau d’une importante accélération de
la croissance américaine au cours de la fin
de la dernière décennie.1 Au rang de ces
conditions on trouve des taux de chômage,
d’inflation et d’intérêt exceptionnellement
bas, le rapide comblement du déficit et
même un surplus budgétaire du gouverne-
ment américain (accroissement sensible des
rentrées fiscales au niveau de l’imposition
des revenus2 et des plus-values boursières),
un accroissement de la consommation des
ménages encouragés par le boom des va-
leurs technologiques sur les marchés bour-
siers ainsi qu’une augmentation des salaires
réels, une balance commerciale toujours
déficitaire mais dont le déficit est comblé par
l’importation de capitaux étrangers attirés
par les perspectives de profit de la « nou-
velle économie ».
Si jusqu’aux environs du début des années
’70 les économistes étaient d’accord pour
affirmer qu’inflation et chômage tendaient à
s’opposer (antagonisme expliqué par
Keynes et illustré par la fameuse courbe de
Phillips), ce consensus fut remis en cause et
supplanté par un nouveau qui s’imposa jus-
que dans le courant des années ’90, orien-
tant la politique économique de nombreux
pays. Friedman et les monétaristes confir-
mèrent qu’à court terme, sous l’influence
d’une variation de la demande, chômage et
inflation s’opposent bel et bien.
Mais les changements de la demande glo-
bale ne constituent pas la seule cause d’une
variation de l’inflation. Encore faut-il tenir
compte d’événements au niveau de l’offre
1 Résumé de l’article de R. J. Gordon (2001)
2 Les recettes de l’impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques augmentèrent de 64% entre
1994 et 1999.
L’article en 9 points :
1. Au cours de la période 1995-2000
l’économie américaine a connu une
accélération « miraculeuse » de sa
croissance
2. Celle-ci est la conséquence de la
conjonction de conditions macroéco-
nomiques extrêmement favorables :
une baisse simultanée du chômage et
de l’inflation, un taux d’intérêt inhabi-
tuellement bas, le boom des valeurs
technologiques, une accélération des
investissements des entreprises, une
augmentation généralisée et soutenue
des salaires, l’accroissement de la
consommation, un surplus budgétaire
des finances publiques.
3. L’origine de la simultanéité de ces
conditions repose pour l’essentiel sur
une importante accélération de la
croissance de la productivité améri-
caine entre 1995 et 2000. Celle-ci –
trouve son origine au sein des impor-
tantes avancées accomplies dans les
nouvelles technologies de l’information
(NTI) (notamment dans le matériel in-
formatique).
4. Cette accélération n’a pas été uni-
forme, elle a varié d’un secteur à un
autre
5. Il y a lieu de distinguer entre la pro-
ductivité moyenne du travail et la pro-
ductivité multifactorielle (du travail et
du capital) pour analyser l’impact des
NTI

Croissance et formation Annexe 1 : technologie et croissance
2
des entreprises (« supply shocks ») influen-
çant d’une manière générale et durable les
prix pratiqués par ces dernières. A considé-
rer encore l’inertie provoquée par la lenteur
des ajustements sur les marchés. Au bout
du compte, le consensus porta sur l’idée que
dans le long terme inflation et chômage sont
des variables macroéconomiques indépen-
dantes l’une de l’autre. A la fin des années
’90, ce consensus était remis à nouveau en
cause par la constatation aux Etats-Unis
d’un importante degré de corrélation entre la
diminution du chômage et de l’inflation. Jus-
qu’à présent aucune analyse de ce nouveau
phénomène n’a véritablement convaincu la
majorité des économistes.
Gordon avance une explication de l’évolution
durable et parallèle du chômage et de
l’inflation aux Etats-Unis au cours de la pé-
riode 1995 – 2000. Si le rythme de l’inflation
a pu pareillement décélérer alors même que
le taux de chômage en faisait de même,
c’est grâce à 4 « chocs » ayant influencé
significativement et durablement l’offre et les
prix pratiqués par les entreprises : la baisse
des prix réels à l’importation, la baisse des
prix de l’énergie, des ordinateurs et enfin
des soins médicaux. Mais Gordon souligne
que c’est surtout la « résurrection » de la
croissance de la productivité américaine qui
a permis de plus qu’éponger les conséquen-
ces inflationnistes de la hausse des salaires
américains.
La croissance de la productivité constitue
donc le principal pilier du « miracle » éco-
nomique américain de la fin du siècle passé.
Elle a notamment rendu possible une aug-
mentation des salaires réels sans générer
d’inflation tout en permettant un accroisse-
ment du niveau de vie de l’ensemble des
américains, y compris des catégories les
moins favorisées (en avril 2000, le taux de
chômage chez les Noirs et les Hispaniques
atteint le plus faible niveau jamais enregistré
jusque là). Cette augmentation du bien-être
et de la productivité se traduit également par
un accroissement du revenu réel par capital
(Y / K) : une plus grande productivité de
l’outil de production permet d’augmenter la
quantité de biens et services produits et les
revenus qui en découlent. En comparaison
internationale, au cours de ces dix dernières
années, l’écart entre le revenu réel par capi-
tal des Etats-Unis et celui de l’Europe ou du
Japon n’a cessé de s’accroître, témoignant
de l’augmentation de l’avance technologique
américaine.
Si la période s’étendant de 1915 à 1972 fut
celle de l’ « âge d’or » de l’économie améri-
caine grâce à une rapide croissance de sa
productivité, cette dernière ralentit sensible-
ment à partir de 1972 pour renaître miracu-
leusement entre 1995 et 2000. Quelles sont
les causes de cette longue période de ralen-
tissement, qui plus est aux Etats-Unis alors
que si l’on songe que ceux-ci disposaient
déjà d’importants avantages structurels ?
Beaucoup d’économistes se sont penchés
sur la question, sans véritable succès. Car
pour Gordon c’est une fausse question qu’il
s’agit de reformuler : pourquoi la croissance
de la productivité fut si rapide et durable
avant 1972, telle est la bonne question ?
Il faut remarquer tout d’abord qu’il ne s’agit
pas d’une particularité de l’économie améri-
caine. L’Europe et le Japon ont également
connu l’âge d’or de la productivité puis le
ralentissement conséquent de la croissance
de cette dernière mais à un rythme différent
et avec un décalage dans le temps de par
L’article en 9 points (suite) :
6. Si les NTI ont accéléré la croissance
de la productivité du travail dans
l’ensemble des secteurs à travers un
effet de densification du capital, elles
n’ont pas accéléré la croissance de la
productivité multifactorielle dans le
secteur de la production des biens
non durables représentant le 88% de
l’économie américaine.
7. N’ayant pas accéléré la croissance
de la productivité multifactorielle (glo-
bale) en dehors du secteur des biens
durables, les NTI ne sont pas pour
l’instant à l’origine d’une nouvelle
révolution industrielle.
8. Le « miracle » américain de la fin du
siècle dernier est fragile : que l’une
de ses conditions s’affaiblisse et ce-
lui-ci risque de s’envoler
9. Les origines de l’avancée technologi-
que des Etats-Unis sur l’Europe et le
Japon sont diverses : avantages tra-
ditionnels (ressources, production de
masse, etc), subventionnement de la
recherche, politiques économiques
spécifiques, langue, immigration,
qualité du système de formation.

Croissance et formation Annexe 1 : technologie et croissance
3
les retards et l’effet de rattrapage provoqués
par les deux guerres mondiales. Où donc
trouver l’origine de l’âge d’or économique
qu’a connu la plupart des pays industriali-
sés au cours du XXe siècle ? Dans le réser-
voir des grandes inventions de la seconde
Révolution Industrielle (1860 – 1900) et de
leur intégration dans les économies moder-
nes au cours de la première moitié du siècle
précédent. Alors que le moteur électrique
bouleversa la production manufacturière, les
véhicules à combustion interne révolutionnè-
rent les transports terrestres et aériens, sans
compter les importantes innovations dans
les domaines de la chimie, du pétrole, du
divertissement et de la communication.
L’inévitable épuisement des fruits de ces
grandes inventions entraîna par la suite le
ralentissement de la croissance de la pro-
ductivité.
Technologies de l’information et croissance de la productivité
Si une importante accélération de la crois-
sance de la productivité constitue l’élément
moteur et la condition sine qua non du mira-
cle économique américain de la fin du siècle
passé, il y a lieu de s’interroger quant à sa
cause. Tout comme pour la période de l’âge
d’or, la réponse est à trouver dans le progrès
technologique. Les recherches sur la ques-
tion s’accordent pour reconnaître que
l’accélération de la croissance de la produc-
tivité globale de l’économie américaine
trouve pour l’essentiel son origine dans
l’accélération des progrès technologiques en
matière d’ordinateurs, de périphériques et de
semi-conducteurs.
Le consensus sur cette question n’a pas tou-
jours été de mise chez les économistes. En
1987, le prix Nobel d’économie Robert So-
low avait déjà souligné le lien paradoxal en-
tre les investissements des entreprises en
équipement informatique et leur quasi ab-
sence d’effet sur l’accroissement de la pro-
ductivité de ces dernières : « Nous pouvons
voir des ordinateurs partout sauf dans les
statistiques sur la productivité »3. Durant
une décennie, l’affirmation de Solow fut
considérée comme un truisme : on constata
qu’effectivement l’usage des ordinateurs
dans les entreprises s’amplifia sans pour
autant avoir des incidences significatives sur
les résultats de ces dernières. Seules les
explications du phénomène divergèrent. Le
« miracle » américain sembla mettre un
terme définitif au paradoxe de Solow. Les
recherches académiques démontrèrent clai-
rement l’impact des nouvelles technologies
de l’information sur la renaissance de
l’accroissement de la productivité. De sorte
qu’en 1999-2000 un nouveau consensus
émergea à ce sujet : le paradoxe de Solow
semblait bel et bien enterré.
3 The Economist, juin 1987
Mais il est nécessaire ici de se méfier des
apparences. Si les avancées technologiques
ont certes eu pour conséquence de sensi-
blement accélérer la croissance de la pro-
ductivité globale américaine au cours des
années 1995 – 2000, cette constatation ne
nous apprend rien quant à la répartition de
cet accroissement global dans l’économie
américaine. Gordon se propose dès lors
d’éclaircir ce point à travers une analyse plus
détaillée.
A cet effet, il est nécessaire de distinguer
entre deux types de productivité : la produc-
tivité moyenne du travail (Average Labor
Productivit, ALP) et la productivité multifacto-
rielle (Multi-Factor Productivity, MFP). D’une
manière générale, la productivité se définit
comme étant le rapport entre la quantité
produite (output) et la quantité de ressources
affectée à cette production (input). Ces
quantités sont habituellement mesurées par
leur valeur monétaire réelle (par ex. en US $
ou en euro constant). La productivité
moyenne du travail (ALP) nous indique
quelle quantité de produit génère en
moyenne une heure de travail. La productivi-
té multifactorielle (MFP) indique la producti-
vité de l’ensemble des ressources producti-
ves utilisées, et non simplement celle du
travail. Elle met ainsi en rapport la quantité
produite avec une moyenne pondérée des
facteurs utilisées (travail et capital pour
l’essentiel).
La distinction entre productivité moyenne du
travail et productivité multifactorielle ainsi
que le rapport qu’elles entretiennent au sein
d’une économie moderne sont fondamen-
taux pour analyser d’une manière plus dé-
taillée l’impact des nouvelles technologies
sur la productivité globale. A travers le
temps, la productivité du travail croît toujours
plus rapidement que la productivité des fac-
teurs. Et la différence entre l’ALP et la MFP
représente la contribution de la densification

Croissance et formation Annexe 1 : technologie et croissance
4
du capital (« capital deepening »), c’est-à-
dire le fait qu’une économie en croissance
repose sur un accroissement de son capital
plus rapide que l’accroissement de la quanti-
té de travail. Dit autrement, chaque travail-
leur est équipé en moyenne d’une quantité
croissante de capital (outils de production).
Un simple exemple permettra de mieux sai-
sir ces notions. La productivité du travail
d’un agriculteur récoltant son blé à la main
sera inférieure à la productivité du travail de
ce même agriculteur faisant usage d’une
moissonneuse-batteuse. L’augmentation du
capital utilisé par l’agriculteur (l’achat de la
moissonneuse-batteuse) a ainsi accru la
productivité de son travail. Mais a-t-elle
augmenté sa productivité globale ? Une
chose est sûre : si cette dernière a augmen-
té, ce ne sera pas autant que la productivité
globale. Car contrairement à la productivité
moyenne du travail, celle-ci va mettre en
rapport la quantité produite avec non seule-
ment le coût du travail mais également le
coût du capital nécessaire à cette produc-
tion. C’est la conséquence d’une densifica-
tion du capital : pour son travail, l’agriculteur
fait usage d’un capital plus important, ce
dernier ayant également un coût dont il s’agit
de tenir compte dans les calculs de produc-
tivité.
Quel est donc l’impact des progrès réalisés
dans les nouvelles technologies sur
l’accroissement de ces différentes productivi-
tés non seulement au niveau de l’économie
américaine dans son ensemble mais égale-
ment dans ses différents secteurs de pro-
duction ? L’accélération du progrès techno-
logiques dans le secteur de la production de
matériel informatique induit une accélération
de la baisse du prix des ordinateurs provo-
quant un véritable boom dans
l’investissement d’achats d’ordinateurs par
les entreprises. Ce faisant la productivité
multifactorielle générale de l’économie amé-
ricaine ne peut qu’augmenter, cette vente
accrue d’ordinateurs accroissant la quantité
globale de biens produits (output) sans
augmenter d’autant la quantité de ressour-
ces utilisées (de par les importants progrès
de productivité dans le secteur de matériel
informatique).
Ces achats supplémentaires d’ordinateurs
par les entreprises augmentent également la
densification du capital américain. Le travail-
leur américain moyen disposant de plus de
matériel informatique, il devient plus produc-
tif (sans cela les entreprises n’investiraient
pas dans l’achat de ces ordinateurs).
L’accroissement de la productivité multifacto-
rielle globale s’accompagne dès lors ici d’un
accroissement de la productivité moyenne
du travail au sein de l’économie américaine.
A ce stade de l’analyse, seul le rapport en-
tre, d’une part, le progrès technologique et,
d’autre part, l’augmentation de la productivi-
té globale (travail et multifactorielle) et de la
croissance de l’économie américaine au
cours de la période 1995 – 2000 a été expli-
qué. Les études empiriques confirment cette
constatation. Il y a cependant lieu
d’approfondir l’investigation en séparant le
secteur de production fabriquant le matériel
informatique du secteur qui utilise ce dernier.
Personne ne conteste l’accélération de la
productivité et de la croissance dans le pre-
mier secteur. Qu’en est-il du second repré-
sentant 96% des entreprises américaines ?
Distinguons à cette fin les deux effets que
peuvent avoir les progrès dans le domaine
du matériel informatique sur le secteur des
entreprises en faisant usage : l’effet « di-
rect » et l’effet de « débordement ». Si
l’unique effet de la percée technologique
dans le secteur de la production
d’ordinateurs sur le secteur non informatique
est un boom dans les investissements en
matériel informatique accélérant le taux de
croissance du capital dans ce dernier sec-
teur, alors la densification du capital qui s’y
produit va y accroître la productivité
moyenne du travail (les travailleurs dispo-
sant de plus d’ordinateurs, ils deviennent
plus productifs) mais non pas la productivité
multifactorielle. C’est ce que Gordon appelle
l’effet « direct » du progrès informatique sur
le secteur non informatique : l’accroissement
des investissements de ce dernier en maté-
riel informatique ayant pour effet d’accroître
la productivité du travail sans pour autant
augmenter la productivité multifactorielle.
L’effet de « débordement » est celui mis en
avant par les avocats de l’aspect révolution-
naire des conséquences des avancées
dans le domaine des technologies de
l’information. Les investissements dans
l’infrastructure informatique seraient d’une
rentabilité très importante et sans précédent
pour les entreprises, créant des effets de
débordement sur les pratiques de gestion et
la productivité des firmes du secteur non
informatique. Concrètement, l’effet de « dé-
bordement » se manifeste par une accéléra-
tion de la productivité multifactorielle du sec-
teur non informatique parallèle à
l’accélération technologique dans la produc-
tion d’ordinateurs.

Croissance et formation Annexe 1 : technologie et croissance
5
Que nous apprennent les statistiques offi-
cielles à ce sujet ? Tout d’abord elles confir-
ment que la baisse du prix du matériel infor-
matique s’est accélérée dans les années
’90. De 1987 à 1995 le prix des ordinateurs
a baissé en moyenne de 12% alors que de
1996 à 1998 la baisse moyenne a été de
29%. Gordon base son analyse des consé-
quences de cette chute de prix sur la pro-
ductivité par la combinaison de deux études
empiriques qu’il complète. La première est
celle d’Oliner et Sichel (2000, 2001) à partir
de laquelle on peut dégager la contribution
des ordinateurs à la densification du capital
et à l’accroissement de la productivité multi-
factorielle de l’économie américaine dans
son ensemble. La seconde étude est celle
de Gordon (2000) qui rajoute deux nouveaux
éléments à celle d’Oliner et Sichel. En pre-
mier lieu, elle établit un trend de la crois-
sance de la productivité du travail à partir
des années ’50 et permet ainsi de corriger
les données statistiques en y soustrayant
l’aspect cyclique de leur évolution. Ensuite,
elle isole les accélérations de la croissance
multifactorielle et du travail au sein du sec-
teur de la production de biens non durables.
Entre 1995 et 2000, après correction de
l’aspect cyclique, la croissance annuelle de
la productivité du travail a été de 2.46%
contre 1.42% pour la période 1972-1995,
soit une accélération de 1.04 points. Com-
ment l’expliquer ? Par de légers ajustements
d’indices (prix, qualité du travail) qui nous
ramènent cette accélération à 0.89 points.
Mais surtout par la densification du capital
informatique (0.37 point), l’accroissement de
la productivité multifactorielle dans le secteur
de la production d’ordinateurs (0.30 point) et
dans les autres secteurs (0.22 point). Gor-
don répète le même calcul non pas pour
l’économie dans son ensemble mais pour le
secteur de production des biens non dura-
ble. L’accroissement de la productivité du
travail dans ce secteur (0.44 pt) est pour
0.37 pt imputable à l’effet de densification du
capital et pour seulement 0.07 pt à
l’accroissement de la productivité multifacto-
rielle. Par simple différence, on en déduit
également que l’accroissement de la produc-
tivité multifactorielle dans le secteur des
biens durables, production d’ordinateurs
mise à part, explique 0.15 point de
l’accélération de la productivité globale du
travail aux Etats-Unis.
En résumé, sur les 0.89 pt d’accélération du
taux de croissance annuel de la productivité
du travail dans l’économie américaine pro-
voqué par la baise du prix des ordinateurs,
0.37 point est imputable à l’effet de densifi-
cation du capital informatique (autre forme
de capital exclu) et 0.52 pt à l’accroissement
de la productivité multifactorielle globale,
réparti à raison de 0.30 pour le secteur de la
production d’ordinateurs, 0.15 pour le sec-
teur de la production du reste des biens du-
rables et seulement 0.07 pour le secteur de
la production des biens non durables repré-
sentant le 88% des entreprises américai-
nes…
Le verdict est dès lors mitigé. Les progrès
technologiques en matériel informatique ont
effectivement et d’une manière impression-
nante fait renaître la productivité américaine
(multifacteurs et travail) au cours de la pé-
riode 1995 – 2000. Il y a bel et bien eu un
effet de « débordement » du secteur des
ordinateurs sur le secteur des biens dura-
bles en général s’étant traduit par une accé-
lération sensible de la croissance de la pro-
ductivité multifactorielle dans ce dernier. Le
secteur des biens non durables a également
bénéficié de ces avancées technologiques et
de leur effet « direct » grâce à une densifica-
tion de son capital (provoqué par
l’accroissement des investissements dans
l’achat d’ordinateurs) et donc une accéléra-
tion de la croissance de la productivité du
travail. Mais ce même secteur (88% des en-
treprises) n’a pratiquement pas profité de
l’effet de « débordement ». Ainsi donc, les
importants progrès technologiques en infor-
matique n’ont pas d’un coup de baguette
magique amélioré d’une manière sensible la
productivité de la toute grande majorité des
entreprises américaines. Il n’a pas suffi
d’acheter des ordinateurs pour que le mira-
cle ait lieu. Et la troisième Révolution indus-
trielle, celle de l’information, ne s’est pas
encore produite.
Gordon met enfin en garde les plus optimis-
tes quant aux bons résultats de l’économie
américaine. Partant de cette analyse, on en
déduit que le miracle américain est la con-
jonction rare et fragile de facteurs qui ne
sont pas appelés à nécessairement durer.
Qu’un seul d’entre eux s’affaiblisse et le mi-
racle s’envolera. Et pour cela il suffit que les
investissements en matériel informatique
baisse. Le simple ralentissement de la
baisse des prix du matériel informatique y
contribuerait dangereusement. Et Gordon de
relever que le bug de l’an 2000 (ayant pous-
sé nombre d’entreprises à renouveler leur
équipement) et l’invention d’Internet (ayant
incité à l’achat d’ordinateurs pour s’y con-
necter) ne peuvent avoir lieu qu’une seule
fois dans l’histoire économique.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%