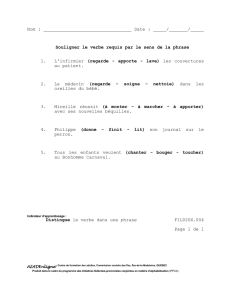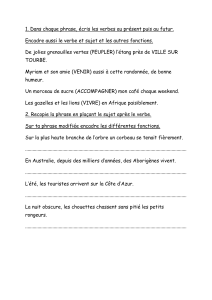Ex. 1 (a) Les phrases où les rôles assignés au sujet et au COD

Licence de Sciences du Langage, semestre 6, corrigés des exercices de syntaxe, deuxième partie, p. 1
Ex. 1 (a) Les phrases où les rôles assignés au sujet et au COD peuvent s'identifier strictement aux rôles
d'agent et de patient sont les phrases 2, 6 et 9.
(b) Les phrases où le rôle assigné au sujet peut s'identifier au rôle prototypique "instrument" sont les
phrases 5 et 7. Dans ces mêmes phrases, le rôle assigné au COD est le rôle de patient.
(c) Dans les phrases 4 et 12, le sujet a un rôle actif et peut être désigné comme "agent", par contre le rôle
du COD s'écarte du patient prototypique au sens où il ne subit concrètement aucune manipulation ("Il
regarde la télé" est une réponse adéquate à "Que fait-il?", par contre "Il l'a regardée" n'est pas une réponse
adéquate à "Qu'est-ce qu'il a fait à la télé?")
(d) Dans les phrases 8 et 10 on a de même un sujet agent et un COD dont le rôle s'écarte notablement du
patient prototypique par l'absence de manipulation.
Ex. 2 Dans ces phrases, le COD ne représente pas une entité concrète dont le rôle serait caractérisable
comme patient, mais plutôt un procès dont le sujet représente un participant (agent ou autre).On désigne
parfois comme "verbes-supports" les verbes rencontrés dans de telles constructions.
Ex. 3 Dans ces phrases, il s'agit sémantiquement de procès à un seul participant, et le COD indique la
sélection parmi plusieurs façons possibles de chanter, de danser ou de courir.
Ex. 4 Dans ces phrases, le COD représente une entité concrète dont le rôle peut être assimilé à celui de
patient, et le sujet représente d'une certaine manière ce qui provoque le processus affectant le référent du
COD, mais il ne s'agit pas d'un agent , c'est-à-dire d'un animé qui contrôle l'action qu'il effectue sur un
patient. De telles constructions seraient impossibles dans le cas (assez répandu) de langues où le sujet des
verbes transitifs ne peut être qu'un animé.
Ex. 5 Les combinaisons possibles sont celles dans lesquelles le clitique objet est de troisième personne non
réfléchie (c'est-à-dire autre que se): Jean me(dat)-le(obj)-présente, Jean le(obj)-lui(dat)-présente, etc.; par
contre *Jean me(obj)-lui(dat)-présente ou *Jean lui(dat)-me(obj)-présente sont impossibles. Par ailleurs,
Jean me(obj)-présente à lui est beaucoup plus acceptable que *Jean lui(dat)-présente moi. On peut donc dire
que lorsqu'à la fois l'objet et le datif remplissent séparément les conditions pour apparaître sous forme
clitique, l'objet a priorité pour apparaître comme clitique, et le datif ne peut apparaître sous forme clitique
qu'en l'absence de clitique objet de première, deuxième personne ou troisième personne réfléchi.
Ex. 6 La construction à quantifieur flottant manifeste de plus en plus de restrictions au fur et à mesure qu'on
descend dans la hiérarchie sujet > objet > datif > oblique:
– avec le sujet, la construction à quantifieur flottant est également acceptable avec un sujet ordinaire ou avec
un sujet clitique, et ce, sans distinction de registre;
– avec l'objet, la construction à quantifieur flottant est acceptable quel que soit le registre si l'objet est
clitique, par contre avec un groupe nominal ordinaire comme objet, elle n'est acceptable que dans un registre
familier;
– avec le datif, la construction à quantifieur flottant est toujours inacceptable dans un registre soutenu, et
dans un registre familier elle est possible, mais seulement avec un datif clitique;
– avec un oblique, la construction à quantifieur flottant n'est acceptable sous aucune condition.
Ex. 7 (a) Incorporation d'indices pronominaux au verbe: le verbe présente à sa finale un indice de sujet
suffixé qui varie en nombre et en personne mais n'incorpore aucun indice d'objet (d'après les données
fournies, il n'y a aucune raison de supposer que les pronoms personnels objets qui figurent dans certaines
phrases aient le statut de clitiques)
Marquage des constituants nominaux sujet et objet: dans le corpus fourni, les noms en fonction de sujet
sont à la forme absolue, ou extra-syntaxique, tandis que les noms en fonction d'objet sont à une forme
syntaxiquement marquée.
(b) La hiérarchie sujet > objet se manifeste ici par le fait que lorsque sujet et objet sont coréférents, une
forme nominale ordinaire figure en position de sujet et impose sa référence au mot se (pronom réfléchi) qui
figure en position d'objet, l'inverse n'étant pas possible.
Ex. 8 Agent et patient sont à deux formes casuelles différentes. Le patient est à la forme du nom en isolation,
tandis que l’agent est à une forme particulière (cas ergatif). L’auxiliaire marque un accord en personne et en

Licence de Sciences du Langage, semestre 6, corrigés des exercices de syntaxe, deuxième partie, p. 2
nombre à la fois avec l’agent et avec le patient. L’agent et le patient peuvent ne pas être représentés par des
groupes nominaux, mais seulement par les marques de personne et de nombre portées par l’auxiliaire.
Ex. 9 En russe, l’unique terme essentiel de la construction de verbes comme travailler ou aboyer ainsi que
l’agent de verbes comme laver ou mordre sont également à la forme que présente le nom en citation isolée, il
y a par contre une forme casuelle spéciale pour le patient de verbes comme laver ou mordre. C'est un
marquage casuel typique de langues à alignement accusatif.
En basque, c’est pour l’agent des verbes signifiant une action exercée par un agent sur un patient qu’il y a
une forme casuelle spéciale, tandis que la forme de citation du nom s’utilise à la fois pour le patient de
verbes comme amener ou attraper et pour l’unique terme essentiel de la construction de verbes comme
arriver et sortir. C'est un marquage casuel typique de langues à alignement ergatif.
En kabyle, il y a comme en russe identité de traitement entre l’agent d’un verbe d’action à deux
participants et l’unique terme essentiel de la construction de verbes comme courir, pleurer ou être ouvert, et
un traitement à part pour le patient d’un verbe d’action ; mais à la différence du russe, c’est le patient d’un
verbe d’action à deux participants qui a la forme du nom en isolation, et on a une autre forme qui vaut
également pour l’agent de verbes d’action à deux participants et l’unique terme essentiel de la construction
de verbes comme courir, pleurer ou être ouvert. On est dans le cadre d'un alignement de type accusatif, mais
atypique dans la mesure où c'est le patient qui est à la forme absolue du nom.
Ex. 10 L'oromo présente la même configuration que le kabyle (exercice précédent):
(a) Entre le marquage du sujet et de l'objet dans la langue oromo et un marquage typiquement ergatif
comme celui du basque, on remarque comme ressemblance le fait que l'objet est à la forme absolue, ainsi que
l'existence d'une marque explicite de la fonction sujet; la différence est que le sujet d'une construction
intransitive est marqué comme celui d'une construction transitive.
(b) Entre le marquage du sujet et de l'objet dans la langue oromo et un marquage typiquement accusatif
comme celui du latin, la ressemblance est un contraste morphologique entre sujet et objet, le traitement du
sujet ne dépendant pas de la nature transitive ou intransitive de la construction; la différence est qu'en oromo,
à l'inverse du latin, c'est l'objet qui est à la forme absolue et le sujet à une forme spéciale.
Ex. 11 En nahuatl, ce sont les mêmes marques de personne-nombre qui font référence à l’unique terme
essentiel d’une construction intransitive et à l’agent d’une construction transitive prototypique, et il y a un
jeu spécial de marques de personne-nombre faisant référence au patient. L’accord du verbe en nahuatl
fonctionne donc selon le même principe que le marquage casuel en russe ou en kabyle.
En k’ichee’, ce sont les mêmes marques de personne-nombre qui font référence à l’unique terme essentiel
d’une construction intransitive et au patient d’une construction transitive prototypique, et il y a un jeu spécial
de marques de personne-nombre faisant référence à l’agent. L’accord du verbe en k’ichee’ fonctionne donc
selon le même principe que le marquage casuel en basque.
Ex. 12 Dans les phrases fournies, on constate que l’objet est au cas morphologique datif lorsqu’il cumule les
deux traits humain et défini, alors qu’il est à la forme absolue lorsqu’il est humain indéfini ou inanimé.
NB : l’arménien illustre ainsi deux tendances très généralement observées dans les langues qui ont un
‘marquage différentiel de l’objet’, c’est-à-dire un marquage casuel de l’objet soumis à certaines conditions.
Ex. 13 (a) L’argument de ces verbes qui est au cas morphologique datif-accusatif a en commun avec l’agent
des verbes d’action typiques le trait humain, mais il s’en distingue par le fait qu’il n’exerce pas une action
sur une autre entité qu’on pourrait caractériser comme patient. On peut considérer que les verbes de cette
classe assignent typiquement à leur premier argument le rôle d’expérient; pour le deuxième argument, les
choses sont moins nettes, mais on peut considérer comme typique le rôle de stimulus.
(b) D’après la réponse à la question (a), on peut prévoir que la construction où Chota est au cas
morphologique ergatif signifie une action délibérée, ou du moins dans laquelle la personne en question a un
certain degré de responsabilité, alors que la construction où Chota est au cas morphologique datif indique
une action involontaire (et c’est effectivement ce qui se passe).
(c) Oui, puisque de manière générale écouter indique une action délibérée, alors que entendre indique une
perception indépendante de la volonté de celui qui entend.

Licence de Sciences du Langage, semestre 6, corrigés des exercices de syntaxe, deuxième partie, p. 3
(d) A priori, voir étant un verbe de perception, on peut trouver étonnant que sa construction diffère de celle
de l’autre verbe de perception qu’est entendre et s’aligne sur celle des verbes d’action. Toutefois, une
explication possible est que la perception visuelle met en jeu un certain degré de contrôle (possibilité de
fermer les yeux, de détourner le regard pour ne pas voir) qu’on ne retrouve pas dans la perception auditive,
beaucoup moins contrôlable.
Ex. 14 (a) Les données fournies permettent de voir que l’argument dont le marquage casuel varie entre
absolutif, ergatif et datif-accusatif a dans tous les cas la propriété d’imposer sa référence au possessif
réfléchi, ce qui est un argument pour considérer que son statut dans la construction de la phrase reste
inchangé, en dépit de la variation des marques casuelles.
(b) Le même argument peut être utilisé en faveur de l’analyse selon laquelle, avec les verbes de ce type, c’est
l’argument au cas morphologique datif-accusatif (qui représente un expérient) qui doit être considéré comme
sujet; en effet, c’est lui qui impose sa référence au possessif réfléchi.
Ex. 15 La forme malav, réduite à la base verbale, permet de faire l’hypothèse que:
– dans le paradigme des marques de sujet, on a une marque zéro qui signifie ‘sujet de deuxième personne du
singulier’ ;
– dans le paradigme des marques d’objet, on a une marque zéro qui signifie ‘objet de troisième personne
(sans distinction de nombre).
A partir de là, en observant des formes qui impliquent, soit un sujet de deuxième personne du singulier,
soit un objet de troisième personne, on peut facilement identifier les marques suivantes:
v — Ø : sujet de première personne du singulier (cf. v-malav) ;
Ø — s : sujet de troisième personne du singulier (cf. malav-s) ;
v — t : sujet de première personne du pluriel (cf. v-malav-t) ;
Ø — t : sujet de deuxième personne du pluriel (cf. malav-t) ;
Ø — en : sujet de troisième personne du pluriel (cf. malav-en) ;
m — Ø : objet de première personne du singulier (cf. m-malav) ;
gv — Ø : objet de première personne du pluriel (cf. gv-malav).
(les marques de sujet de première et deuxième personne pouvant se réduire à un préfixe v- ‘sujet de première
personne’ et à un suffixe -t ‘pluriel de première ou de deuxième personne’)
Les marques d’objet de deuxième personne n’apparaissent pas aussi directement, mais on remarque que
toutes les formes concernées commencent par g-, et que dans la forme g-malav-t au sens de ‘je vous cache’,
le -t signifie le pluriel de l’objet. On peut donc proposer:
g — Ø : objet de deuxième personne du singulier ;
g — t : objet de deuxième personne du pluriel (g- ‘objet de deuxième personne’ + -t ‘pluriel de première ou
de deuxième personne’).
Mais selon cette analyse, certaines formes devraient présenter deux préfixes ou deux suffixes: les formes
qui combinent un sujet de première personne et un objet de deuxième personne devraient présenter à la fois
le préfixe v- et le préfixe g-, et on devrait avoir deux suffixes dans les formes qui signifient, ou bien sujet de
troisième personne et objet de deuxième du pluriel, ou bien sujet de première du pluriel et objet de deuxième
du pluriel.
L’analyse ci-dessus doit donc être complétée par une règle qui précise que les combinaisons de deux
préfixes ou de deux suffixes de personne-nombre sont interdites. Toutefois, aucune généralisation ne semble
permettre de prévoir la façon précise de simplifier les combinaisons de suffixes ou de préfixes.
Ex. 16 Avec les verbes géorgiens du type représenté ici par écrire, sujet , les rôles syntaxiques objet, datif et
oblique se reconnaissent de la façon suivante:
– Le sujet est le terme nominal de la phrase dont le marquage casuel varie selon le tiroir verbal entre
absolutif, ergatif et datif-accusatif.
– L’objet est le terme nominal de la phrase dont le marquage casuel varie selon le tiroir verbal entre datif-
accusatif et absolutif.
– Le datif (en tant que fonction syntaxique) est le terme nominal de la phrase qui est au cas
morphologique datif-accusatif à condition que le sujet lui-même ne soit pas au cas morphologique datif-
accusatif ; si c’est le cas, il prend une terminaison casuelle qui a été glosée ‘pour’ (bénéfactif).
– Les rôles syntaxiques nucléaires peuvent donc se caractériser globalement en géorgien par un marquage
morphologique qui varie selon le tiroir verbal, ce qui est une façon de manifester leur relation étroite au

Licence de Sciences du Langage, semestre 6, corrigés des exercices de syntaxe, deuxième partie, p. 4
verbe ; par contraste, les obliques sont caractérisés globalement par un marquage casuel qui ne varie pas en
fonction des tiroirs verbaux, ce qui traduit leur statut d’éléments ayant un statut relativement périphérique
dans la construction du verbe.
Ex. 17 La phrase (1), dans laquelle le verbe ‘écrire’ présente la forme morphologiquement la plus simple,
illustre la construction de base du verbe ‘écrire’, avec un sujet représentant la personne qui écrit (agent) et un
objet représentant la chose écrite (résultat).
Dans la phrase (2), l’agent n’est pas mentionné, et le nom de la chose écrite occupe le rôle de sujet; on
peut donc identifier -w- comme marque d’une voix passive.
La phrase (3) présente les mêmes termes que (1), et le sujet représente également la personne qui écrit,
mais il y a en (3) un terme supplémentaire qui représente un destinataire. On peut donc penser que -el- est lié
à l’introduction de ce complément dans la construction du verbe ‘écrire’. Il s’agit d’un mécanisme de voix
qui n’a pas d’équivalent en français.
Dans la phrase (4), on a aussi par rapport à (1) un terme supplémentaire, mais son rôle sémantique est
‘causateur’, et il prend le rôle syntaxique de sujet, reléguant le nom de la personne qui écrit au rang de
complément. On peut donc identifier -is- comme marque d’une voix causative analogue à ‘faire + infinitif’
en français.
La phrase (5) présente un changement de construction qui combine l’introduction d’un causateur prenant
le rôle de sujet et l’introduction d’un complément qui représente un destinataire. On retrouve dans la forme
verbale le morphème de causatif -is- identifié dans la phrase (4) et l’allomorphe -ets- du morphème -el-
identifié dans la phrase (3).
Dans la phrase (6), le rôle de sujet est pris par le nom du destinataire, qui apparaissait en (3) comme
complément. On peut donc supposer que -el- marque l’introduction du destinataire dans la construction du
verbe ‘écrire’, et que la disparition du sujet-agent liée à la présence du morphème de passif -w- permet au
destinataire d’échanger son rôle de complément pour celui de sujet.
Dans la phrase (7), on observe la présence du morphème de causatif, mais le rôle du sujet est occupé par
le nom de l’agent (la personne qui écrit), qui apparaissait dans la construction causative (4) comme
complément. On peut donc supposer que -is- signifie la présence d’un causateur, mais que la disparition du
sujet-causateur liée à la présence du morphème de passif -(i)w- permet à l’agent de l’action d’écrire de
retrouver le statut syntaxique de sujet.
Enfin, la phrase (8) est construite autour d’une forme verbale qui cumule trois morphèmes dont la
présence est liée à un changement de construction:
-is- implique la référence à un causateur ;
-ed- est un allomorphe du morphème qui permet l’introduction du nom d’un destinataire dans la
construction du verbe ‘écrire’ ;
-(i)w- (passif) a pour effet de ‘destituer’ le sujet-causateur, permettant ainsi au nom du destinataire
d’occuper le rôle de sujet devenu vacant.
Ex. 18 Sous réserve d’une analyse des phénomènes morphophonologiques à la jonction base-suffixe, dont la
description précise nécessiterait un corpus plus étendu, on peut dire que :
-lo –phrase (5)– est une marque de voix passive, qui marque la destitution du sujet et la promotion de
l’objet au statut de sujet; en (12), on peut faire l’hypothèse qu’on a encore affaire au morphème de voix
passive, car la terminaison du verbe présente une certaine ressemblance, et relativement à la phrase (11) on
peut parler de destitution du sujet-agent et de promotion du destinataire (qui d’après les indications fournies
semble traité syntaxiquement comme objet).
-(l)tia –phrases (7) et (9)– est une marque de voix causative.
-lia –phrase (14)– est une marque de voix applicative.
En (10), on retrouve le morphème de voix passive s’ajoutant à une forme déjà marquée comme
causative : la dérivation causative fait en principe passer au rang d’objet le sujet-agent du verbe ‘manger’
pour introduire un sujet-causateur, mais la dérivation passive, en destituant le sujet-causateur, refait passer le
sujet-agent initial au rang de sujet (mais sémantiquement, il s’agit d’un agent contrôlé par un causateur qui
reste sous-entendu, ou agent-causataire). On peut présenter les choses de la façon suivante, en tenant compte

Licence de Sciences du Langage, semestre 6, corrigés des exercices de syntaxe, deuxième partie, p. 5
du fait que les données (notamment l’indexation de l’objet-agent en (9)) permettent de penser que le sujet-
agent de ‘manger’ devient objet dans la construction causative mais ne permettent pas de savoir quel est
exactement, au causatif, le statut syntaxique de l’objet-patient de la construction de départ:
-cua Asujet-agent Bobjet-patient —> -cualtia Csujet-causateur Aobjet-ag.caus. Bpatient
—> -cualtilo Asujet-ag.caus. Bpatient
En (15), on retrouve le morphème de voix passive s’ajoutant à une forme déjà marquée comme
applicative : la dérivation applicative ne touche pas à la relation entre le verbe et le sujet, mais elle a ici pour
effet de destituer l’objet-patient et de donner le statut d’objet au nom de la personne au détriment de qui se
fait l’action, et la dérivation passive fait passer l’objet-bénéfactif de la forme applicative au statut de sujet:
-cui Asujet-agent Bobjet-patient —> -cuilia Asujet-agent Cobjet-bénéfactif Bpatient
—> -cuililo Csujet-bénéfactif Bpatient
Ex. 19 Le deuxième type d’emploi du suffixe de transitivisation renvoie à la notion de voix causative : le
sujet de la construction intransitive se retrouve dans la construction transitive avec le statut d’objet, et le rôle
du sujet de la construction transitive peut se décrire comme ‘causateur’ (‘l’enfant fait en sorte que le fer soit
tordu’, ‘l’enfant fait en sorte que l’argent soit compté’).
Par contre, dans le premier type d’emploi, le participant représenté par le sujet de la construction
intransitive conserve son statut de sujet dans la construction transitive. Il s’agit donc d’un changement de
construction typique des voix applicatives.
Ex. 20 La difficulté dans cet exercice consiste à identifier le fonctionnement de mécanismes de destitution
ou de promotion de termes de la phrase à travers une morphosyntaxe de type ergatif, dans laquelle le cas
absolutif peut indiquer, soit le sujet d’une construction intransitive, soit l’objet d’une construction transitive.
On remarque que dans les phrase (1) et (3), aucun morphème n’est inséré entre la racine verbale et la
désinence personnelle du verbe, et la terminaison personnelle se réfère d’après la glose aux deux participants
à l’action. Les indications fournies par la glose permettent de voir qu’il s’agit de constructions transitives de
type ergatif, avec le sujet à l’ergatif et l’objet à l’absolutif.
En (2), aucun terme de la phrase n’est au cas ergatif, et la terminaison verbale se réfère à un seul
participant, ce qui permet de penser qu’il s’agit d’une construction intransitive dont le sujet est le terme au
cas absolutif, c’est-à-dire l’agent nanuq ‘ours’, le participant qui avait le statut d’objet au cas absolutif dans
la phrase (1) prenant maintenant le statut d’oblique. On a donc là tous les éléments pour conclure que -si- est
la marque d’une voix antipassive.
En (4) aussi, aucun terme de la phrase n’est au cas ergatif, et la terminaison verbale se réfère à un seul
participant, ce qui permet de penser qu’il s’agit là aussi d’une construction intransitive dont le sujet est le
terme au cas absolutif. Mais dans la phrase (4), le sujet au cas absolutif correspond à l’objet de la phrase (3),
et le sujet de la phrase (3) se retrouve avec le statut d’oblique. On a donc là tous les éléments pour conclure
que -niqar- est la marque d’une voix passive.
Ex. 21 En français, ce couple de phrases illustre un cas où une même forme verbale (ici: tu as changé) peut
sans changer de forme entrer dans deux constructions différentes: dans la phrase (1) la construction est
intransitive, et le référent du sujet est le siège d’un processus sur lequel il n’exerce pas de contrôle, mais qui
n’a pas non plus de cause extérieure clairement identifiée, alors qu’en (2) la construction est transitive, et le
sujet reçoit le rôle d’agent. En arménien par contre, la forme verbale de la phrase (1) se distingue de celle de
la phrase (2) par un morphème -v- qu’on peut supposer être une marque de voix moyenne (pour vérifier cette
hypothèse, il faudrait voir si le même suffixe a de manière régulière un effet analogue sur la construction
d’autres verbes).o’
 6
6
 7
7
1
/
7
100%