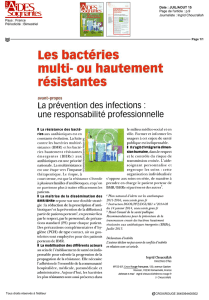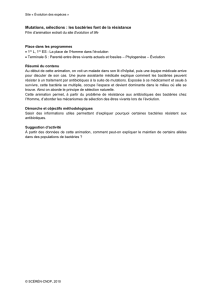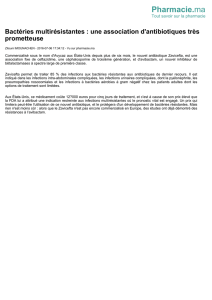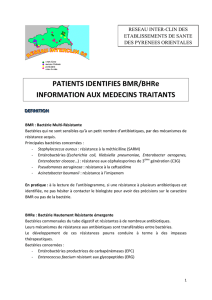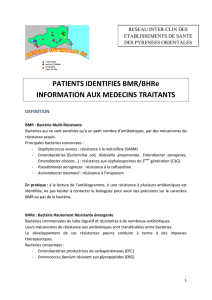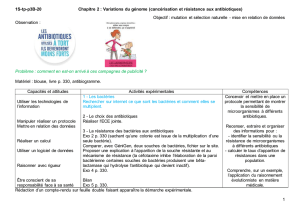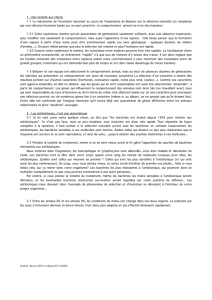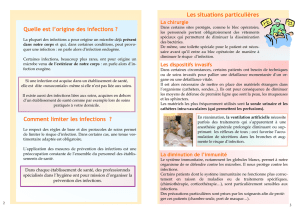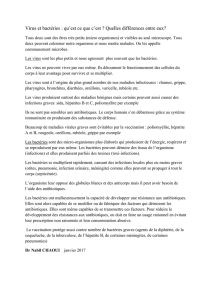Bactéries multirésistantes, bactéries hautement résistantes

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
http://dx.doi.org/10.1016/j.sasoi.2015.06.002 SOiNS AIDES-SOIGNANTES - no 65 - juillet/août 2015
8
Les bactéries multi- ou hautement résistantes
dossier
Bactéries multirésistantes,
bactéries hautement résistantes
émergentes: maîtriser le risque
Le problème des bactéries résistantes aux anti-
biotiques est mondial et en constante progres-
sion. Les déplacements de population, la
promiscuité, l’absence de système de traitement
des eaux usées, ont favorisé l’émergence de ces
résistances et leur diffusion [1].
Le milieu hospitalier, en réunissant une proxi-
mité entre des patients fragilisés, un usage des
antibiotiques, une charge en soin importante et
de nombreux intervenants, constitue l’épicentre
de la diffusion des bactéries résistantes aux anti-
biotiques.
DÉFINITIONS
z
Les bactéries multirésistantes
(BMR) ont
acquis de multiples mécanismes de résistance
comparativement à la même espèce retrouvée à
l’état sauvage. CesBMR restent sensibles à
quelques antibiotiques.
En France, deux espèces sont concernées: le Sta-
phylococcus aureus1 résistant à la méticilline2
(SARM) et les entérobactéries productrices de bêta-
lactamase3 à spectre4 élargi (EBLSE) (tableau 1).
Si les spécialistes français ont limité les pro-
grammes de lutte aux deux espèces précitées, cela
se justifi e par leur caractère commensal, leur fré-
quence, la fréquence des infections et surtout les
conséquences individuelles (mortalité) et collec-
tives (diffusion de la résistance, surconsommation
d’antibiotiques) dont elles sont responsables [2].
z
Les bactéries hautement résistantes émer-
gentes (BHRe) sont des bactéries du tube diges-
tif, encore rares en France, qui sont résistantes à
tous les antibiotiques ou presque. La rareté du
phénomène, la fréquence des infections et leurs
mise au point
z Le problème de la résistance aux antibiotiques est aujourd’hui omniprésent à l’hôpital, mais
également en institution communautaire z La progression de ce phénomène fait peser la menace
d’une impasse thérapeutique dans de nombreuses infections z Pour maîtriser les épidémies à
bactéries multirésistantes (BMR) ou hautement résistantes émergentes (BHRe), il est impératif de
mettre en œuvre les recommandations du Haut Comité de santé publique, mais aussi d’avoir des
comportements d’hygiène simples et systématiques au contact de tous les patients et résidents.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
CLÉMENT LEGEAY
Assistant spécialiste des
hôpitaux
NADIA LE QUILLIEC
Infi rmière
JEAN-RALPH ZAHAR*
Chef de département
Unité de prévention et de
lutte contre les infections
nosocomiales (Uplin),
CHU d’Angers, 4, rue Larrey,
49100 Angers, France
*Auteur correspondant.
Adresse e-mail :
jeanralph.zahar@chu-angers.fr
(J-R. Zahar).
Mots clés – bactérie hautement résistante; bactérie multirésistante; hygiène des mains; risque; transmission
TABLEAU1. Comparaison des différentes BMR et BHRe.
SARM EBLSE BHRe
Réservoir Humain (nez) Humain (tube digestif) Humain (tube digestif)
Identifi cation
des porteurs
Facile, score clinique Impossible Hospitalisation à l’étranger
Épidémies régionales
Mode de transmission Manuportée Manuportée Manuportée
Quantités excrétées Faibles Massives (excreta +++) Massives (excreta +++)
Situation en France Épidémique Endémique Épidémique
BMR: bactérie multirésistante; SARM: staphylocoque doré résistant à la méticilline; EBLSE: entérobactérie productrice de bêtalactamase à spectre élargi; BHRe:
bactérie hautement résistante émergente.
Source: CHU d’Angers
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/09/2015 par IMFSI PERPIGNAN - (329084)

SOiNS AIDES-SOIGNANTES - no 65 - juillet/août 2015 9
Les bactéries multi- ou hautement résistantes
dossier
consé
quences (absence d’antibiotiques effi caces)
expliquent les recommandations nationales mises
en place[3].
Ces bactéries sont déjà très répandues dans divers
pays étrangers, comme dans le Sud-Est asiatique,
le Proche et Moyen-Orient et l’Afrique, et plus
récemment, des pays proches de nous sont endé-
miques comme les pays du Maghreb, la Grèce ou
encore l’Italie [4]. Plusieurs épidémies régionales
ont lieu en France [2]. Face à cette menace,
encore rare dans notre pays, des mesures d’isole-
ment, de suivi des transferts et de dépistages sont
recommandées et justifi ées.
MODE DE TRANSMISSION
ET CONSÉQUENCES
z
Les mains sont les vecteurs essentiels des
bactéries,
et particulièrement des BMR et BHRe.
L’acquisition se fait de façon directe (directement
à partir du patient) ou indirecte (à partir de l’en-
vironnement du patient). Les principales bacté-
ries contre lesquelles nous luttons (EBLSE,
BHRe) ont comme réservoir le tube digestif
(nous excrétons plus d’un milliard de bactéries
par jour dans nos selles).
z
Certains soins sont donc particulièrement à
risque.
En effet, les soins incluant le périnée (toi-
lette, pansements, autres), la gestion de la sonde
urinaire et la gestion des excreta nécessitent de
redoubler de vigilance. D’autres soins exposent
eux aussi à l’acquisition de ce type de bactéries
telles la gestion des plaies et pansements et la ges-
tion des cathéters.
COMMENT MAÎTRISER LE PHÉNOMÈNE?
z
Les moyens de maîtrise des risques infec-
tieux existen
t et sont à notre portée. La France
a réussi à maîtriser la diffusion des SARM [2]. Cela
a nécessité la mise en place de politiques d’iden-
tification et d’isolement des patients porteurs
ou infectés, ainsi qu’une amélioration de l’obser-
vance de l’hygiène des mains grâce à l’introduc-
tion des solutions hydro-alcooliques (annexeA).
z
Toutefois, les efforts effectués restent insuf-
fi sants
pour maîtriser le phénomène lié aux bac-
téries du tube digestif. En effet, pour les EBLSE et
les BHRe, du fait des quantités importantes excré-
tées par les patients porteurs ou infectés, leur maî-
trise nécessite un niveau de respect des précautions
standard, et notamment une observance de l’hy-
giène des mains qui doit dépasser les 80%.
z
Le manuportage joue un rôle crucial dans la
transmission croisée;
c’est pourquoi il est pri-
mordial, au cours des soins, de respecter une
hygiène des mains selon les cinq indications de
l’Organisation mondiale de la santé [5]: avant de
toucher le patient, avant un geste aseptique, après
un risque d’exposition à un liquide biologique,
après avoir touché un patient, après avoir touché
l’environnement du patient (fi gure 1).
z
La diffusion en ville du phénomène
et la diffi -
culté d’identifi er les patients porteurs sont les
deux raisons pour lesquelles il est important de
mieux observer les précautions standard, quel
que soit le type de patient pris en charge et quel
que soit le type de soin. Il est évident que certaines
situations nécessitent de faire plus[3].
QUE FAUT-IL FAIRE EN PRATIQUE?
Risques liés aux soins
z
Face à une charge en soins qui ne cesse de
croître,
l’aide-soignant est amené à réaliser des
soins complexes avec une durée de contact lon-
gue et un risque élevé de contamination des
mains, donc de transmission secondaire. En effet,
réaliser une toilette au lit chez un patient présen-
tant des plaies, des dispo
sitifs médicaux invasifs
(sonde urinaire, voie veineuse ou sous-cutanée,
etc.) auxquels peut s’ajouter une incontinence
urinaire et/ou fécale, sont des situations à haut
risque de contamination. De plus, si des aléas
de type “rupture de procédure” viennent per-
turber les soins, le risque de ne pas réaliser une
hygiène des mains adéquate (bon moment et
de manière effi ciente) est un facteur de risque
de transmission.
Lexique
• Commensal: qui est naturellement présent dans
l’organisme sans provoquer de maladie.
• Endémie: persistance d’une maladie dans une
région géographique donnée.
• Excreta: substances rejetées hors de l’organisme,
constituées de déchets de la nutrition et du
métabolisme (selles, urines, vomissements).
• Manuportage: transmission de germes d’un
individu à un autre par l’intermédiaire des mains.
• Observance de l’hygiène des mains (HDM):
réalisation d’une hygiène des mains, chaque fois
qu’elle est nécessaire.
• Patient porteur: patient colonisé par une bactérie
résistante avec un risque de transmission secondaire.
• Rupture de procédurede soins : interruption
pendant la réalisation d’un soin.
NOTES
1
Staphylocoques dorés.
2
Antibiotique du genre des
β-lactamines.
3
Enzymes sécrétées par
les bactéries qui dégradent
les antibiotiques du genre
β-lactamines.
4
Ensemble d’espèces de
bactéries sensibles à un
antibiotique; plus le spectre est
large, plus le nombre d’espèces
contre lesquelles l’antibiotique
est réputé effi cace est important.
RÉFÉRENCES
[1] Organisation mondiale
de la santé. Premier rapport
de l’OMS sur la résistance aux
antibiotiques: une menace grave
d’ampleur mondiale. Avril 2014.
www.who.int/mediacentre/news/
releases/2014/amr-report/fr
[2] Arnaud I, Jarlier V, groupe de
travail BMR-Raisin. Surveillance
des bactéries multirésistantes
dans les établissements de santé
en France. Réseau BMR-RAISIN.
Données 2012. Saint-Maurice:
Institut de veille sanitaire; 2014.
www.invs.sante.fr/Publications-
et-outils/Rapports-et-syntheses/
Maladies-infectieuses/2014/
Surveillance-des-bacteries-
multiresistantes-dans-les-
etablissements-de-sante-francais
[3] Haut Conseil de la santé
publique (HCSP). Prévention
de la transmission croisée
des “Bactéries Hautement
Résistantes aux antibiotiques
émergentes” (BHRe). Juillet
2013. www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=372
[4] Nordmann P.
Carbapenemase-producing
Enterobacteriaceae: overview of
a major public health challenge.
Med Mal Infect. 2014; 44(2): 51-6.
[5] Organisation mondiale de
la santé. Les 5 indications de
l’hygiène des mains. Mai 2009.
www.who.int/gpsc/5may/
tools/workplace_reminders/
affi che_5indications_hygiene_
mains.pdf
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/09/2015 par IMFSI PERPIGNAN - (329084)

SOiNS AIDES-SOIGNANTES - no 65 - juillet/août 2015
10
Les bactéries multi- ou hautement résistantes
dossier
ANNEXES A, B.
MATÉRIEL
COMPLÉMENTAIRE
Le matériel complémentaire
(Annexes A et B)
accompagnant la version
en ligne de cet article est
disponible sur http://10.1016/j.
sasoi.2015.06.002.
z
Seul le respect de l’hygiène des mains per-
met de réduire le risque.
Cela consiste en l’utili-
sation des solutions hydroalcooliques en quantité
suffi sante (3 mL), en respectant une durée de
friction
de 30 secondes. Ce doit être le dernier
geste effectué avant de réaliser le soin du malade
et immédiatement après le soin. La friction est
réalisée sur des mains macroscopiquement propres
(pas de salissures, pas de matières), nues (sans
bijoux), avec des ongles courts et sans vernis [6].
z
Le port de gants ne permet pas de protéger
de la contamination,
d’autant qu’il est fréquem-
ment associé à une moindre observance de l’hy-
giène des mains. Son indication réside en le port
systématique en cas de contact avec les liquides
biologiques (muqueuse, peau lésée, urines ou
sonde urinaire, gestion du bassin ou de l’urinal).
Il nécessite une hygiène des mains avant et après
le port.
Il est important de souligner qu’une paire de
gants correspond à un geste de soin, et qu’elle
doit être systématiquement changée entre deux
soins: un geste ou un soin = une paire de gant +
une hygiène des mains par friction avec un pro-
duit hydroalcoolique [7].
z
Peu de situations nécessitent le port d’un
tablier
ou d’une protection de la tenue de soin.
Elles sont limitées aux soins mouillants ou salissants.
Risques liés à l’entretien
z
Il faut également souligner le risque lié à la
gestion de l’urinal ou du bassin
(les excreta).
Cette situation met le soignant au contact du
principal réservoir bactérien. Elle nécessite une
rigueur incluant non seulement une protection
de la tenue, mais aussi l’entretien du matériel.
Dans ce cas précis, l’utilisation des douchettes
pour entretenir les bassins est proscrite car ces der-
nières exposent à une aérosolisation des bactéries.
Seule l’utilisation d’un lave-bassin permet de limiter
la contamination de l’environnement. En l’absence
de lave-bassin, la manipulation des excreta se fera
de façon rigoureuse, en protégeant sa tenue avec un
tablier à usage unique, et en portant des gants de
soins à usage unique (après une friction hydroalcoo-
lique). L’évacuation du contenu du bassin se fera
dans le cabinet de toilette du patient avant de réali-
ser un entretien par “trempage”.
z
Au regard du risque environnemental,
le bio-
nettoyage devient une mission à part entière qui
se doit d’être respectée. En effet, cet acte, en plus
d’assurer une propreté visuelle, permet de maî-
triser le risque de contamination de l’environne-
ment en éliminant les bactéries présentes.
z
Le respect des précautions standard
(PS) est
donc l’étape indispensable et nécessaire pour maî-
triser un risque qui a diffusé et que nous ne pouvons
pas identifi er. Ces précautions s’appliquent partout
et tout le temps, chaque fois que nous sommes au
contact du patient ou de son environnement. Tou-
tefois, en cas de notion de porteur/infecté à BMR
ou BHRe, il est recommandé de mettre en place des
mesures supplémentaires telles que les précautions
complémentaires contacts (dites PCC) pour les
BMR, et des mesures encore plus contraignantes en
cas de BHRe (précautions spécifiques BHRe)
(annexe B). Ces mesures sont justifi ées par les risques
épidémiologiques liés à la diffusion de ces bactéries.
CONCLUSION
La lutte contre les infections nosocomiales et les
bactéries résistantes repose sur l’investissement de
chacun et sur le respect de gestes simples mais pri-
mordiaux au quotidien. Nous somm
es tous acteurs
de la santé des autres, et si nous voulons préserver
notre qualité de soins pour notre avenir et celui de
nos patients, c’est à nous tous de respe
cter et de
faire respecter ces comportements.n
Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent
ne pas avoir de confl its
d’intérêts en relation avec
cet article.
Figure 1. Les 5 indications de l’hygiène des mains de l’OMS.
© OMS
RÉFÉRENCES
[6] Société française
d’hygiène hospitalière (SF2H).
Recommandations pour
l’hygiène des mains. Hygiènes.
2009; XVII(3): 165-77.
www.sf2h.net/publications-
SF2H/SF2H_recommandations_
hygiene-des-mains-2009.pdf
[7] Organisation mondiale de
la santé. Usage des gants : fi che
d’information. Avril 2010.
www.who.int/gpsc/5may/tools/
training_education/slcyh_usage_
des_gants_fr.pdf
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 08/09/2015 par IMFSI PERPIGNAN - (329084)
1
/
3
100%