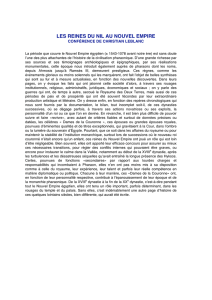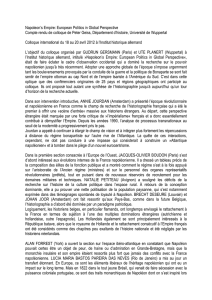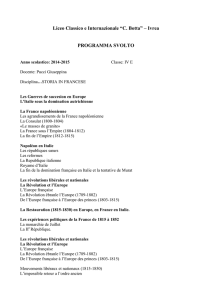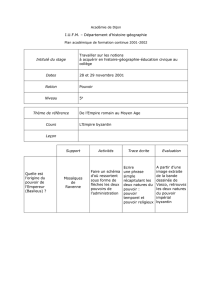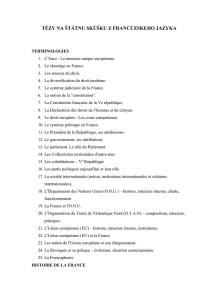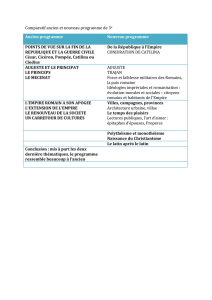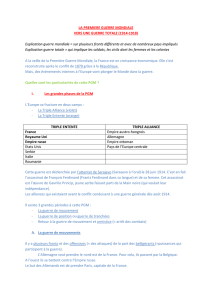Position de thèse sous format Pdf - Université Paris

UNIVERSITE PARIS IV – SORBONNE
ECOLE DOCTORALE 2 – HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE
N°
THESE
Pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITE PARIS IV
Discipline : HISTOIRE
Présentée et soutenue publiquement par
Juliette GLIKMAN
Le 27 septembre 2007
L’IMAGINAIRE IMPERIAL ET LA LOGIQUE DE L’HISTOIRE
ETUDE DES ASSISES DU REGIME DU SECOND EMPIRE
DIRECTEUR DE THESE : M. Jacques-Olivier BOUDON
_____________________
JURY
M. Jacques-Olivier BOUDON
M. Jean-Pierre CHALINE
M. Alain CORBIN
M. Sudhir HAZAREESINGH
M. Lucien JAUME
M. Jean-Claude YON

2
Comment le second Empire s’est-il projeté en tant que régime politique ? Le
bonapartisme a donné lieu à de nombreuses études : René Rémond en a fait la source de la
droite autoritaire, Frédéric Bluche analyse la difficile conciliation entre le vote populaire et
l’espoir de transmission dynastique, Pierre Rosanvallon décèle une des premières expériences
de démocratie illibérale. La réflexion politique s’est focalisée sur l’imprégnation de la
légende impériale, et la réception de l’héritage du premier Empire. La période a été réduite au
rang de parenthèse sous la troisième République, dont la genèse s’édifiait dans la perspective
d’une histoire militante. Ce régime, né d’un coup de force, mené par une poignée
d’aventuriers, aurait été voué d’emblée à l’éphémère. Sa chute a certes pour origine
immédiate le désastre militaire face à la Prusse, mais ce n’est pas l’impréparation militaire qui
est mise sur le banc des accusés par les fondateurs républicains. La défaite ne serait que
l’ultime révélateur des dysfonctionnements d’un régime incapable d’assurer à terme
l’administration de la France.
La République serait née des déficiences profondes du régime impérial,
cumulées à la médiocrité de son personnel dirigeant, l’avènement républicain étant dissocié
des conséquences de la défaite face à la Prusse. La République se revendique du déterminisme
historique, sans dépendre de l’événement accidentel, humiliant pour la fierté nationale. Le
régime impérial, impuissant à se réformer et à survivre à son fondateur, ne pouvait faire
cohabiter durablement le principe monarchique et la ratification électorale. Son acte de décès
aurait été signé avant même l’effondrement militaire. La République échappe à toute
possibilité de parallèle avec la Restauration, encore honnie pour s’être édifiée sur les ruines de
l’épopée impériale.
De prime abord, cette perception a conduit à occulter de la mémoire nationale
le réel attachement populaire qu’avait su susciter l’Empire, générant une pensée politique qui
prétendait insérer la démocratie plébiscitaire au sein d’une monarchie providentielle. La
doctrine politique du second Empire et ses représentations idéologiques n’ont jamais fait
véritablement l’objet d’une recherche approfondie, si ce n’est pour y voir une forme abâtardie
de l’exercice charismatique du pouvoir conduit par Napoléon Ier : il y aurait un bonapartisme
inaugural, dans sa version première, et une variante dégradée, les deux avatars ayant en
commun d’être des résolutions passagères à des déchirements internes, impuissants à survivre
au rétablissement d’un cadre légal. C’est du moins le point de vue d’André Siegfried. Or, le
second Empire s’est ingénié à revendiquer une identité originale, qui a été théorisée
précocement, les débuts du règne étant privilégiés au cours de cette étude.

3
Il convient de relativiser la vision d’un pouvoir qui se serait appuyé sur l’appel
au peuple. L’étude des assises du régime napoléonien permettra d’établir une appréhension
originale du temps historique, principe de légitimation. Se donnant pour finalité de réconcilier
les traditions anciennes et les valeurs issues de la rupture révolutionnaire, le napoléonisme a
pour projet d’« unir des siècles ennemis ». Les apôtres de l’Ancien Régime sont renvoyés à
leur nostalgie stérile pour le passé. Les idéalistes républicains, quant à eux, sont accusés de
nourrir un futur fantasmagorique, propre à attiser des passions destructrices de l’ordre social.
Entre un passé révolu et un avenir utopique, les deux courants antagonistes, renvoyés aux
extrêmes de l’éventail politique, sont condamnés en raison de leur incompréhension des
besoins présents. Mais leurs idéaux respectifs (primauté du prince héréditaire et représentation
populaire) n’en sont pas moins intégrés dans le giron napoléonien.
Le napoléonisme assurerait la réconciliation des deux France, en fusionnant
des vérités qui auraient été l’apanage d’époques autrefois rivales. L’histoire, promue au rang
d’expérience objective, renseigne sur le dispositif théorique. La renaissance même de l’idée
napoléonienne, intacte après une éclipse de près d’un demi-siècle, exprimerait sa nécessité
(renaissance qui est lue à travers le prisme chrétien de la résurrection). Ainsi, l’ère
napoléonienne, conforme à la loi historique et respectueuse de traditions nationales largement
réinventées, prétend accomplir en matière institutionnelle les prédictions du positivisme. Son
triomphe s’apparente à l’âge scientifique, le recours à l’histoire illustrant la logique naturelle
qui mènerait irrévocablement à la résurgence de la dynastie. L’aigle napoléonienne renaît,
nouveau phénix, pour redonner vie et souffle à la France en souffrance, comparée à la figure
biblique de Lazare, réveillé par la main du Christ.
L’Empire ne s’est jamais qualifié de second, puisqu’il se concevait comme une
restauration impériale, même si le terme était soigneusement banni des textes administratifs
de l’automne 1852. Les contemporains ne se seraient certainement pas reconnus dans les
périodisations classiques, qui distinguent Empire autoritaire et Empire libéral. L’évolution
perçue va d’un système qualifié de personnel, où l’empereur absorbe le suffrage universel, à
un gouvernement appelé libéral, où la responsabilité ne pèse plus uniquement sur le
souverain. L’abandon des contraintes autoritaires se fait l’indice d’une dynastie affermie,
assurée d’un consensus au sein de l’opinion. Le cadre autoritaire s’est pensé comme
temporaire, sorte de dictature transitoire imposée par le trouble des consciences, en proie à
l’anarchie des valeurs : le premier devoir du gouvernement impérial est d’assurer
l’amélioration morale et sociale des éléments populaires. Cet état de contrainte prépare
l’émergence du nouvel Empire, lié à la liberté sans répudier ses principes fondateurs, reposant

4
sur l’ordre, la paix civile, l’autorité morale, désormais fermement établis. C’est alors que le
terme de Second Empire se diffuse, pour désigner sa propre refondation par le système
impérial. Toute évolution progressive étant regardée avec suspicion, signe de compromissions
partisanes, les concessions libérales n’étaient envisageables qu’en refondant l’alliance conclue
entre la dynastie et la nation.
La doctrine politique est perceptible dès que nous n’envisageons plus cette
période par son terme, en cherchant par une analyse rétroactive à déceler les raisons de sa
chute. Il s’agit de retrouver le regard que le second Empire a porté sur sa propre longévité et
la façon dont il a raconté sa propre histoire. L’étude des mises en scène de la puissance
impériale est un moyen de pénétrer l’esprit de fonctionnement d’un système qui est devenu, à
nos esprits formés à l’école républicaine, aussi étranger que la monarchie absolue de droit
divin. A cet égard, la relecture des déclarations et des discours impériaux, décryptés à travers
le prisme napoléonien, s’avère un exercice indispensable, afin d’appréhender le contenu
idéologique de ces textes. Les écrits d’adhésion seront également sollicités : la poésie d’éloge,
aux instructifs schèmes récurrents ; les libelles laudateurs, concentrés pour l’essentiel sur les
premières années du règne ; les discours de rentrée des cours impériales, riches
d’enseignement en cherchant à flatter le prince ; les voeux des conseils municipaux en faveur
du rétablissement impérial, à l’automne 1852. Le croisement de ces sources permet de
dégager une rhétorique politique codifiée, sur le mode de la répétition.
L’analyse est conduite en trois moments. En premier lieu, considérer les titres
de légitimité avancés par le pouvoir napoléonien, dans une construction argumentative qui
refuse toute part au hasard et à l’événement exceptionnel. Récusant tout relativisme, l’Empire
aspire à s’élever à la hauteur d’une exigence providentielle. La deuxième partie portera sur la
formulation du salut social. Le vote napoléonien garantit l’intention morale des masses, les
transfigurant en un peuple vertueux. En admettant le principe d’hérédité, le peuple valide plus
qu’un cadre politique ou une nouvelle dynastie. L’acceptation plébiscitaire du pouvoir
héréditaire s’intègre à une entreprise de conservation sociale et d’ordre moral. La famille et la
propriété s’en trouvent garanties. Le troisième moment permettra d’envisager l’inscription de
l’Empire dans le temps, terme entendu aussi bien comme suite chronologique que comme
occurrence météorologique.
La présence de l’empereur s’assortit, en effet, de phénomènes astronomiques,
surgissant particulièrement sur fond de fulgurance solaire. L’arrivée du souverain
métamorphose le temps qu’il fait : l’orage cesse, les rayons lumineux déchirent les nuées,
indice de la prescience du regard souverain. Si le soleil louis-quatorzien est réprouvé, pour

5
son ardeur brutale réservée à quelques privilégiés, le soleil napoléonien prodigue à tous
consolation et réconfort après les tourments. Il se plie, en outre, à l’idéal d’égalité, par la
disposition de ses rayons équidistants, bonifiant ceux qu’il touche. D’ailleurs, voir, toucher le
corps impérial s’accompagne d’intenses réactions physiques, consignées comme de véritables
commotions, comparées par les contemporains à un « choc électrique ».
Ce travail sur le ressenti politique soutient l’existence d’une foi napoléonienne,
entretenue par le mythe de la quatrième race, inauguré par Napoléon Ier. En dernier lieu, la
figure de César, dont la présence sur la scène iconographique progresse à mesure du déclin
physique de Napoléon III, montre l’émergence d’un pouvoir d’Etat qui s’identifie à une
silhouette abstraite, progressivement dissociée de son incarnation mortelle. Le recours à
César, reflet de la dignité impériale intemporelle, soustraite à la corrosion du temps, témoigne
d’une certaine résistance du système napoléonien à sa mue libérale, par cet essai de
représentation abstraite de la tête du pouvoir, qui demeure l’incarnation intemporelle de la
volonté du peuple entier.
La doctrine napoléonienne ne saurait se limiter à un usage instrumentalisé du
plébiscite. Les votes, même unanimes, ne suffisent nullement à sanctionner une légitimité
dynastique. Or, c’est bien le cœur de la doctrine : non un pouvoir précaire, justifié par la
capacité d’un homme exceptionnel à mettre fin à une situation hasardeuse, mais une dynastie
prédestinée à l’exercice perpétuel de l’autorité. Louis-Napoléon Bonaparte n’est pas un
Cavaignac ou un Changarnier qui aurait réussi. Il ne peut être envisagé comme annonciateur
des Boulanger à venir. Héritier et fondateur d’une nouvelle lignée, l’homme refuse toute
confusion avec les sauveurs occasionnels.
Le napoléonisme, loin d’entretenir le mythe du sauveur, s’en méfie pour poser
au préalable l’ascension de la quatrième race. Les Napoléon assument la nature monarchique
de la France, tout en respectant les conditions nouvelles de l’exercice du pouvoir, l’exigence
démocratique. D’où les qualificatifs hybrides de « démocratie impériale » ou d’« Empire
démocratique » par lesquels le pouvoir se désigne. Les napoléoniens se destinent à adapter
l’idéal monarchique aux normes de la société nouvelle. En réconciliant la nation avec son
passé monarchique, la dynastie peut ainsi s’ouvrir sur l’avenir. L’inscription dans le flux
historique est une donnée fondamentale. Le temps mortifère, qui use l’exercice de toute
autorité, est également le temps qui féconde les relations de l’avenir. Le lien entre l’idée
napoléonienne et la logique de l’histoire dépasse la simple référence érudite, qui servirait de
palliatif aux lacunes théoriques d’un régime qui n’aurait fonctionné qu’au gré des
circonstances.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%