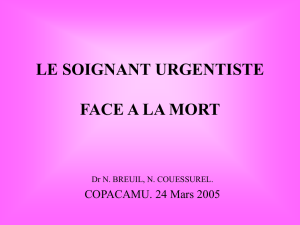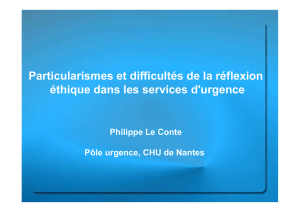16-oct-14 Fin de vie et misère sociale

1
Atelier d’éthique
Organisé par la CARSAT, les réseaux AMPA et RESPECT
16 Octobre 2014 à 14h30 au CH de Pont-Audemer
Thème : Fin de vie et misère sociale
Institutions et personnes présentes :
- AMPA – Association Multidisciplinaire Pour l’Antalgie
Eugénie Poret, Marjorie Jolibois
- Réseau de soins palliatifs à domicile de l’Estuaire (RESPECT)
Catherine Hermelin, coordinatrice territoriale
Nathalie Chaton, infirmière coordinatrice
- Réseau RESPECT – Antenne de Pont-Audemer
Karine Maheut – Secrétaire
Philippe Mabilais – Médecin coordinateur
Sylvie Duparc – Infirmière coordinatrice
- Centre Hospitalier de Pont-Audemer
Clémence Joly – Médecin service de soins palliatifs
Anastasia Delamare – Psychologue
Agnès Granger – Assistante sociale
Nathalie Royer
Marie-Anne Le Ru
Ludivine Durel
Caorline Bour
Personnes excusées
Marie Mayeux-Pottiez, Directrice des soins au GHH, Béatrice Giraud, Coordinatrice AG3C
Dominique Nelson, Assistante sociale CARSAT Normandie
Texte proposé par Eugénie PORET :
« Grâce à l’effort d’amélioration que nous ferons tout de suite, dès demain, tous les vieux
relèveront le front, et tous les jeunes, tous les hommes mûrs se diront du moins que la fin de
la vie ne sera pas pour eux le fossé où se couche la bête aux abois »
Jean Jaurès défendant la première loi des retraites 1910

2
Après une présentation des ateliers d'éthique par Eugénie PORET, Clémence JOLY et
Agnès GRANGER ont présenté lors travail sur les similitudes entre la prise en charge des
patients en soins palliatifs et la prise en charge des patients grands précaires à partir de deux
cas cliniques (diaporama ci joint).
Discussion :
Peut-on dire que la prise en charge des grands précaires doit être faite comme une prise en
charge de fin de vie. Les grands précaires n'ont ni espérance, ni projection. Ils ont un
syndrome d'auto exclusion pour survivre. Par exemple, grande précarité chez les patients
atteints de cancer ORL qui ont un parcours de vie difficile. Ils nous regardent sans nous voir,
absents à eux même car le présent est trop violent.
Sentiments de honte après les accidents de la vie. S'excluent eux même du monde et notre
regard et nos normes les excluent. Ils ont intégré la honte au regard de l'autre.
Précarité de ne pas pouvoir assumer ses obligations.
La prise en charge des patients en grande précarité comme des patients en fin de vie peut
changer le regard que l'on pose sur eux dans une perspective humaniste. A titre d'exemple, les
patients « chroniques » venant aux urgences de façon répétée, ont été l'occasion par les
urgences de travailler plus avec la PASS et une assistante sociale arrivée en 2011. Ces
patients viennent moins régulièrement aux urgences, ils sont réorientés vers la PASS.
Accompagner les patients là où ils en sont, avoir un regard sur l'humain, parler plutôt de soins
d'accompagnement que de soins palliatifs, les personnes ne vont pas vers les structures
adaptées si on ne les accompagne pas physiquement vers ces structures. Un appartement peut
être vécu comme un enfermement par un marginal. L'alcool, les substances illicites leur
permettent de tenir face à un effondrement comme une béquille.
Regarder en donnant de la valeur à l'autre. Ce n'est pas une question de temps, mais
d'intention. Le regard de bienveillance peut restaurer l'autre. Respecter le monde de l'autre qui
peut le protéger. On peut se donner bonne conscience en voulant normaliser l'autre.
Supprimer toute douleur physique peut entraîner une détresse psychique extrême. Il faut
trouver le juste milieu.
Quand un patient souffre, se demander de quoi il vient se plaindre, car la douleur physique
peut avoir un rôle. On peut voir décompenser des psychoses après un traitement trop brutal
d'une douleur physique. Il s'agit donc de prendre en charge la douleur totale. C’est la cas
également pour la précarité, d'où le rôle de l'interdisciplinarité. Les patients peuvent ne pas se
plaindre pour protéger le conjoint.
Qu'est-ce que la normalité ? Il faut laisser la liberté à celui qui est en face de nous et cela nous
conduit à nous interroger sur notre propre vie.
Parallèle entre acharnement thérapeutique et acharnement social ?
Les urgences sont comme la cours des miracles. La présence d'une psychologue aux urgences
pourrait être utile.
Docteur Clémence JOLY
1
/
2
100%