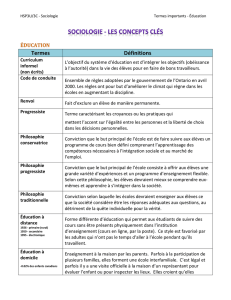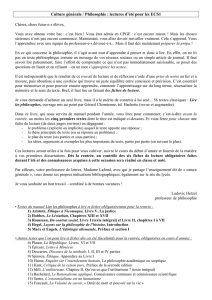L`enseignement philosophique et les sciences : nouvelles

!"
"
"
Fondation Simone et Cino del Duca
10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris
Colloque sur
L’enseignement philosophique et les sciences :
nouvelles perspectives
Paris, 13 novembre 2013

#"
"
Comité d’organisation
Christian Amatore, Membre de l’Académie des sciences
(Délégation à l’éducation et à la formation)
Claude Debru, Membre de l’Académie des sciences
(Comité d’histoire des sciences et d’épistémologie)
Etienne Ghys, Membre de l’Académie des sciences
(Comité sur l’enseignement des sciences)
Paul Mathias, Inspecteur général de l'Education nationale
(Doyen de philosophie)
Alain-Jacques Valleron, Membre de l’Académie des sciences
(Délégation à l’information scientifique et à la communication)
INTRODUCTION
Le Colloque a pour buts de faire le point sur les expériences de coopération entre
philosophes et scientifiques au lycée, recommandées par un précédent colloque le 9 mai
2012, et de soutenir l’élargissement de cette coopération aux domaines de l’informatique et
des sciences économiques et sociales.
Il envisage aussi bien les aspects cognitifs fondamentaux de l’interface entre sciences et
philosophie au lycée que les aspects sociétaux mis en jeu dans ces nouveaux domaines
d’enseignement.

$"
"
PROGRAMME
9 h : Accueil
9 h 45 : Ouverture du Colloque par Jean-François Bach, Secrétaire Perpétuel de
l’Académie des sciences
10 h : Claude Debru, Paul Mathias : Introduction
10 h 15 : Philippe Aigrain (informaticien, directeur de Sopinspace) : Les diverses figures
d’un enseignement possible de l’informatique.
10 h 45 Discussion
11 h : Marc Montoussé (Doyen de l’Inspection générale des sciences économiques et
sociales), Marc Pelletier (Inspecteur général des sciences économiques et sociales) et Joël
Jung (Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional de philosophie) : Sciences
économiques et sociales et philosophie : un croisement des regards
11 h 35 : Discussion
11 h 45 : Dominique Tyvaert (Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional de
philosophie) : Les ressources de terrain
12 h 15 : Discussion
12 h 30 Pause, déjeuner-buffet
Après-midi
Conférences scientifiques
Présidence Jean-Pierre Kahane (Académie des sciences)
14 h : Gérard Huet (Académie des sciences) : Fondements de l’informatique, à la croisée
des mathématiques, de la logique et de la linguistique

%"
"
14 h 40 Discussion
14 h 55 Stéphane Grumbach (INRIA) : La révolution numérique
15 h 35 Discussion
16 h Pause-café
16 h 20 Catherine Audard (London School of Economics) : L’économie donne-t-elle à
penser ? Remarques sur le débat entre John Rawls et les économistes du bien-être.
17 h Discussion
17 h 15 Conclusion du colloque, par Claude Debru et Paul Mathias
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

&"
"
TABLE!
!
Jean-François Bach, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des sciences : Allocution
d’ouverture p. 6
Claude Debru : Introduction 1 p. 8
Paul Mathias : Introduction 2 p. 10
Philippe Aigrain (informaticien, ancien conseiller à la Commission Européenne) :
Les diverses figures d’un enseignement possible de l’informatique p. 13
Marc Montoussé (Doyen de l’Inspection générale des sciences économiques et sociales) :
Sciences économiques et sociales et philosophie : un croisement des regards 1 p. 17
Marc Pelletier (Inspecteur général des sciences économiques et sociales) : Sciences
économiques et sociales et philosophie : un croisement des regards 2 p. 21
Joël Jung (Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional de philosophie) :
Sciences économiques et sociales et philosophie : un croisement des regards 3 p. 26
Dominique Tyvaert (Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional de
philosophie) : Les ressources de terrain p. 29
Gérard Huet (Académie des sciences) : Fondements de l’informatique, à la croisée des
mathématiques, de la logique et de la linguistique p. 37
Stéphane Grumbach (INRIA) : La révolution numérique p. 47
Catherine Audard (London School of Economics) : L’économie donne-t-elle à penser ?
Remarques sur le débat entre John Rawls et les économistes du bien-être p. 56
Claude Debru : Conclusion 1 p. 66
Paul Mathias : Conclusion 2 p. 67
!
!
!
!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
1
/
67
100%