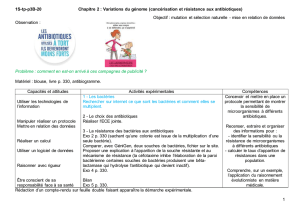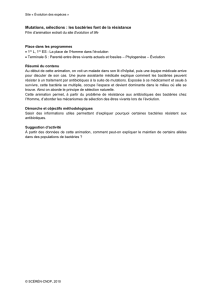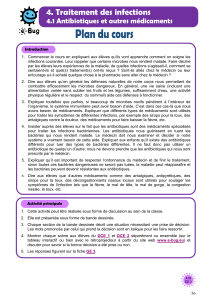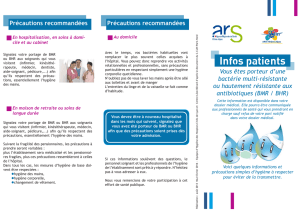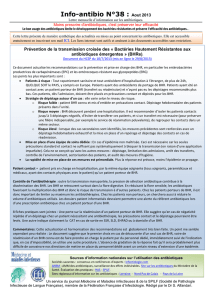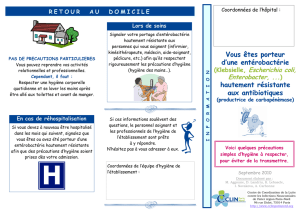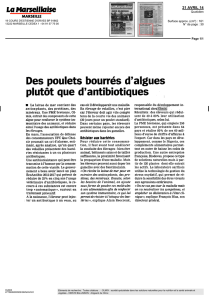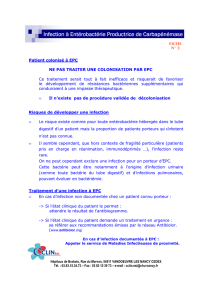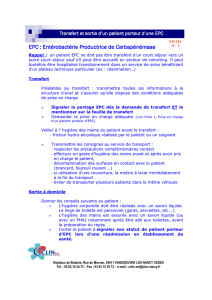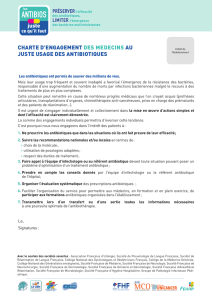Lire l`article complet

P. Berthelot
136 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013
DOSSIER THÉMATIQUE
Carbapénémases
Signalement et mesures
d’hygiène en cas de mise
en évidence d’entérobactéries
productrices
de carbapénémases
Report and hygienic measures in case of carbapenemase-
producing Enterobacteriaceae
J. Gagnaire*, C. Lasserre**, B. Grandbastien***, D. Lepelletier**, P. Berthelot*
* Unité d’hygiène interhospitalière,
service des maladies infectieuses,
CHU de Saint-Étienne.
** Unité de gestion du risque infec-
tieux (UGRI), service de bactériologie
et d’hygiène, CHU de Nantes.
*** Service de gestion du risque infec-
tieux des vigilances (SGRIVi), hôpital
Calmette, CHRU de Lille.
L
a mise en évidence d’entérobactéries produc-
trices de carbapénémases (EPC) est un phéno-
mène émergent dans les établissements de
santé français (1). Il fait suite à l’augmentation de
la pression de colonisation, avec, pour l’instant, un
facteur de risque majeur qui est l’hospitalisation
à l’étranger, que ce soit dans le cadre d’un rapa-
triement sanitaire, d’une hospitalisation de plus de
24 heures ou d’une prise en charge dans des filières
de soins spécifiques (2). On a récemment noté une
augmentation des cas autochtones, qui peuvent
correspondre, pour un certain nombre d’entre eux,
à l’absence de mise en évidence d’un lien épidé-
miologique avec l’étranger (1). De façon parallèle, il
existe une augmentation de la pression de sélection
antibiotique, avec une augmentation des entéro-
bactéries productrices de bêtalactamases à spectre
étendu (EBLSE), ce qui induit une augmentation de
la prescription des carbapénèmes (3, 4). Des recom-
mandations pour limiter la dissémination des EBLSE
en France ont été émises par le Haut Conseil de
la santé publique (HCSP) en 2010 (5). La France
reste un pays fort consommateur d’antibiotiques, et,
malgré une baisse documentée de 16 % en 10 ans,
une tendance récente à une nouvelle augmenta-
tion dans les établissements de santé a été enre-
gistrée (6). Faisant suite à cette mise en évidence
d’EPC, des épidémies ont été décrites en France et
à l’étranger, notamment de Klebsiella pneumoniae,
soit par transmission croisée avec ou sans mise en
place de précautions complémentaires contact, soit
par l’intermédiaire de matériel ou d’environnements
contaminés (7). Ces bactéries sont commensales du
tube digestif avec un risque majeur de contamination
par les excreta et une longue durée de colonisation
des patients. La littérature décrit par ailleurs une
transmissibilité accrue de K. pneumoniae, par rapport
à Escherichia coli, qui est la bactérie prédominante
dans la flore digestive (8).
La situation en France
En France, grâce à une stratégie agressive de type
“search and isolate”, il n’y a pas pour l’instant
d’endémie des EPC (1). Des recommandations très
strictes ont été émises par le HCSP en novembre
2010 (9), demandant le repérage des patients
rapatriés sanitaires ou hospitalisés dans l’année
à l’étranger, avec la mise en place de précautions
contact dès l’admission, la réalisation d’un écouvil-
lonnage rectal à la recherche d’une colonisation de
bactéries hautement résistantes (BHR) aux antibio-
tiques et, si le patient se révèle porteur, une stratégie
agressive de précautions complémentaires d’hy-
giène associée à un dépistage digestif des patients
contacts. Les principales mesures recommandées
par le HCSP sont listées dans le tableau.

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013 | 137
Résumé
»
La prévention et la maîtrise de la transmission croisée des entérobactéries productrices de carbapé-
némases (EPC) reposent sur l’application rigoureuse des précautions standard d’hygiène. Ces dernières
concernent notamment la gestion des excreta, réservoir habituel de ces bactéries. Pour les patients à haut
risque de portage de ces bactéries hautement résistantes aux antibiotiques (patients rapatriés sanitaires,
patients hospitalisés dans l’année à l’étranger), des mesures spécifiques doivent être mises en place. Elles
reposent sur le repérage, le dépistage des patients à risque et la mise en place immédiate de précautions
complémentaires contact. Selon le délai de prise en charge du patient porteur et la survenue ou non de
cas secondaires, les mesures d’hygiène peuvent inclure des précautions spécifiques d’hygiène, stratégie
de dépistage des patients porteurs et contacts, sectorisation des patients et du personnel, limitation des
transferts et des mutations, voire arrêt des admissions.
Mots-clés
Bactéries hautement
résistantes
aux antibiotiques
Entérobactéries
productrices
de carbapénémases
Précautions standard
d’hygiène
Précautions
complémentaires
d’hygiène
Épidémie
Summary
»
To control the emergence
and spread of carbapenemase
producing Enterobacteria-
ceae (CPE), standard hygienic
precautions must be applied.
These precautions include
notably rigorous hygienic
measures when handling stools
and urines, usual reservoir of
these bacteria. For patients
at high risk of carriage (repa-
triated patients or travelers
hospitalized in foreign coun-
tries), specific measures must
be set up: identification of
at risk-patient, immediate
screening and implementation
of additional contact precau-
tions. According to the time
for CPE detection and occur-
rence or not of secondary cases,
hygienic measures can include
specific precautions, screening
of contact patients, cohorting
separately cases and contact
patients, stopping patients’
transfer, and limitation of
admissions.
Keywords
Extensively drug resistant
bacteria
Carbapenemase-producing
Enterobacteriaceae
Contact precautions
Standard precautions
Outbreak
Voies de transmission
et prévention
La transmission des bactéries dans les établissements
de santé se fait majoritairement par transmission
croisée via les mains du personnel. Les mutations
et les réadmissions de patients non connus comme
porteurs de bactéries multirésistantes (BMR) aux
antibiotiques peuvent être des causes de contami-
nation d’unités de soins non concernées par ce type
de bactéries. La pression de sélection antibiotique
va favoriser l’émergence et la sélection de souches
multirésistantes aux antibiotiques. Dans une revue
de la littérature publiée en 2007, J.D. Siegel et al. ont
listé les principales mesures de contrôle pour limiter
la dissémination des BMR dans les établissements de
soins (10). Pour limiter la dissémination des bacilles
à Gram négatif multirésistants aux antibiotiques, les
mesures suivantes ont été proposées : éducation et
formation du personnel, des patients et des visiteurs ;
renforcement de l’hygiène des mains ; utilisation de
produits antiseptiques pour le lavage des mains ;
précautions complémentaires contact ; chambres
individuelles ; regroupement géographique des
patients ; sectorisation du personnel de santé ; modi-
fication de l’utilisation des antibiotiques ; dépistage
Tableau. Principales recommandations du Haut Conseil de la santé publique pour la prise en charge des patients rapatriés
sanitaires ou hospitalisés dans l’année à l’étranger (2).
Recommandations
Admission
du patient
1. Lors de l’admission à l’hôpital, l’équipe opérationnelle d’hygiène doit être informée de la
présence de ce patient, idéalement par une alerte automatisée.
2. L’équipe de soins prenant en charge le patient doit informer le patient des mesures
d’hygiène mises en place.
3. Le médecin en charge du patient doit signaler la colonisation du patient par une bactérie
hautement résistante aux antibiotiques, dans le dossier médical du patient.
4. Des précautions complémentaires d’hygiène contact, selon les recommandations de la
Société française d’hygiène hospitalière éditées en 2009, doivent être mises en place dès
l’admission du patient. Ces mesures seront réévaluées après les résultats de l’écouvillonnage
rectal.
5. Un prélèvement doit être effectué immédiatement et systématiquement pour rechercher
des entérobactéries productrices de carbapénémases ou des entérocoques résistants aux
glycopeptides par écouvillonnage rectal ou par prélèvement de selles.
6. Si les mesures de contrôle ont été mises en place dès l’admission, il n’est pas nécessaire de
réaliser un dépistage digestif des patients contacts (définis comme les patients pris en charge
par la même équipe de soin).
Si le patient est détecté
positif pour une bactérie
hautement résistante
aux antibiotiques
7. Le laboratoire de microbiologie doit immédiatement alerter l’équipe opérationnelle
d’hygiène et le médecin en charge du patient en cas de mise en évidence d’une bactérie
hautement résistante aux antibiotiques.
8. L’équipe opérationnelle d’hygiène doit signaler à l’agence régionale de santé (ARS) et au
centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN), en utilisant
le système e-SIN*, la colonisation ou l’infection du patient par une bactérie hautement
résistante aux antibiotiques.
9. Le mécanisme de résistance doit être identifié par le laboratoire de microbiologie ou la
souche transférée au Centre national de la résistance aux antibiotiques pour caractérisation
du mécanisme de résistance.
10. Des mesures d’hygiène et une surveillance épidémiologique doivent être maintenues
jusqu’à ce que 3 prélèvements digestifs se soient révélés négatifs (réalisés chaque semaine).
En cas d’épidémie, les recommandations du programme national pour minimiser le risque de
transmission d’entérocoques résistants aux glycopeptides doivent être appliquées.
* Signalement externe des infections nosocomiales.

138 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013
Signalement et mesures d’hygiène en cas de mise en évidence
d’entérobactéries productrices de carbapénémases
DOSSIER THÉMATIQUE
Carbapénémases
des patients ; dépistage des professionnels de santé ;
prélèvements microbiologiques environnementaux ;
augmentation du bionettoyage et de la désinfection
de l’environnement ; utilisation de petit matériel
dédié à la prise en charge des patients ; décolonisa-
tion et fermeture de l’unité de soin à toute nouvelle
admission en cas de situation non maîtrisée.
Le jugement de l’efficacité des stratégies de préven-
tion de la transmission croisée des bacilles à Gram
négatif multirésistants aux antibiotiques se heurte à
plusieurs problèmes méthodologiques (11). Premiè-
rement, il s’agit souvent de programmes de préven-
tion à plusieurs facettes, et il est dès lors difficile
d’isoler l’efficacité d’une seule mesure d’hygiène.
De la même façon, il est difficile de quantifier l’effi-
cacité des précautions standard et des précautions
complémentaires d’hygiène, car ces évaluations soit
ne sont pas réalisées, soit sont réalisées unique-
ment en période épidémique. Les audits des mesures
d’hygiène sont rares, et il n’est pas sûr que des
mesures pertinentes pour un établissement soient
transposables à d’autres. De plus, l’unité d’ana-
lyse de ces différentes études est l’unité de soins
et non le patient en lui-même. Il s’agit également
d’études de type avant/après, le plus souvent sans
groupe témoin. De la même façon, les stratégies
sont variables selon l’extension de l’épidémie et le
retard à la mise en évidence des cas et à la mise en
place de mesures de contrôle. Il existe malgré tout
des preuves limitées sur l’apport d’une stratégie
de dépistage des BMR afin de quantifier l’exten-
sion de l’épidémie et d’aider à suivre l’efficacité des
mesures de contrôle mises en place, et sur le fait
que la mauvaise observance des mesures d’hygiène
est une cause d’échec de la maîtrise de la transmis-
sion croisée (12). Des éléments favorisants, comme
la surcharge de travail, une importante charge de
soins et le manque de personnel sont également
retrouvés fréquemment lors des épidémies. L’effi-
cacité des mesures d’hygiène nécessite la mise en
place d’une stratégie d’équipe pour limiter la trans-
mission croisée des micro-organismes. Une étude
de L. Temime et al. (13) évaluant par modélisation
le risque de transmission lié à un professionnel de
santé, ayant une activité transversale dans les unités
de soins, non observant des mesures d’hygiène, a
montré que ce type de professionnel de santé peut
être un superdisséminateur, avec, selon le niveau
de transmissibilité de l’agent infectieux, un risque
de transmission équivalent à 20 % de personnels de
santé non observants.
Depuis 2009, on note une augmentation très impor-
tante du nombre d’articles relatant des épidémies
liées à des EPC. Il est difficile d’interpréter, comme
nous l’avons dit précédemment, l’efficacité d’une
mesure d’hygiène spécifique, mais la littérature
montre que des contrôles d’épidémies à EPC ont
pu être obtenus par la mise en place de précau-
tions complémentaires contact et le dépistage
des patients sans “cohorting” (regroupement des
patients, avec ou sans sectorisation du personnel
de santé) ; à l’opposé, pour d’autres épidémies, ce
cohorting s’est révélé indispensable pour éradiquer
la transmission croisée (7, 14). Au niveau interna-
tional, une douzaine de pays ont émis différentes
recommandations pour contrôler la dissémination
des EPC. Les principales mesures listées en dehors
d’un contexte épidémique sont les suivantes :
➤
renforcer les campagnes de formation du
personnel de santé ;
➤
réaliser des études scientifiques qualitatives et
quantitatives, notamment par l’intermédiaire des
centres nationaux de référence de ces bactéries ;
➤
mettre en place un système centralisé de surveil-
lance des BHR ainsi qu’un système de déclarations ;
➤
diffuser des recommandations visant à prévenir
la dissémination dans les hôpitaux à tous les établis-
sements de soins aigus ;
➤
surveiller la prescription antibiotique, notam-
ment en restreignant l’utilisation des carbapénèmes ;
➤
dépister des patients à risque de portage de BHR :
selon les recommandations, cela peut concerner
tous les contacts étroits du cas index jusqu’à néga-
tivation (patients qui ont séjourné pendant plus de
24 heures avec le cas index alors que les précautions
complémentaires contact n’étaient pas mises en
place), ou, au moins 1 fois par semaine, tous les
patients séjournant au même moment et dans le
même service qu’un patient porteur d’EPC en situa-
tion épidémique, voire tous les patients dans les
services à haut risque ainsi que les patients ayant été
préalablement hospitalisés dans un pays étranger.
Ces mesures sont assez proches de celles recom-
mandées en France par le HCSP (9). Certaines
recommandations proposent des actions complé-
mentaires ; on peut noter la préconisation de limiter
le nombre de soignants prenant en charge le patient,
avec, notamment, l’exclusion des étudiants en
formation et la mise en place de check-lists des
mesures de contrôle. De façon à minimiser le risque
d’infection chez les patients porteurs, il est égale-
ment recommandé de réduire autant que possible
l’utilisation de dispositifs invasifs. La formation des
professionnels est une constante dans toutes ces
recommandations, avec la nécessité d’informer du
statut de porteur d’EPC les services recevant les

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013 | 139
DOSSIER THÉMATIQUE
patients, notamment lors de la réalisation d’exa-
mens complémentaires. Il est également recom-
mandé de limiter les transferts des cas contacts
et des cas, ainsi que les admissions dans le secteur
concerné. En cas de survenue de cas secondaire,
il est souvent recommandé de créer une équipe
pluridisciplinaire de crise, visant à coordonner les
actions de contrôle de la dissémination de ce type
de bactérie. Le cohorting des patients et des équipes
soignantes est souvent recommandé, ainsi que la
limitation, sauf en cas d’urgence, des transferts des
patients vers d’autres services ou institutions. Il est
également recommandé de renforcer les précautions
complémentaires d’hygiène : hygiène des mains,
bionettoyage de l’environnement et désinfection
du matériel. Un audit des mesures d’hygiène est
souvent préconisé, avec également la nécessité de
surveiller la prescription antibiotique de façon à
minimiser le risque de pression de sélection antibio-
tique. Une des études les plus intéressantes sur le
sujet est celle réalisée en Israël dans le cadre d’une
épidémie de K. pneumoniae productrice de carbapé-
némases à l’échelle du pays, qui a nécessité la mise
en place d’une stratégie nationale pour limiter le
risque d’explosion de la transmission de ces bacté-
ries résistantes aux antibiotiques (7). En effet, de
janvier 2005 à mai 2007, une augmentation très
importante de l’isolement d’EPC a été constatée
dans les établissements de santé, liée à l’absence de
réactivité et de mise en place de mesures de contrôle
adéquates. L’incidence mensuelle avait atteint
55,5 cas pour 100 000 journées d’hospitalisation. Le
déploiement d’une stratégie nationale reposant sur
le signalement de tout cas d’EPC, le regroupement
des patients et de personnels de santé dédiés, les
check-lists, l’audit des mesures d’hygiène, la coor-
dination régionale avec mise en responsabilité du
directeur d’établissement et une rétro-information
mensuelle de tout nouveau cas, aidée plus ou moins
d’une task-force pour coordonner l’intervention si
la situation n’était pas sous contrôle, a permis une
diminution très importante des nouveaux cas de
transmission croisée de K. pneumoniae résistantes
aux carbapénèmes. Après la mise en place de ces
mesures au niveau national, l’incidence a diminué
de façon continue pour atteindre, en mai 2008,
11,7 cas pour 100 000 journées d’hospitalisation
(p < 0,001). En analyse multivariée, les facteurs
associés de façon statistiquement significative à la
transmission croisée de ces EPC étaient la préva-
lence des porteurs d’EPC, la période d’intervention
(avant versus après) et, en particulier, la corréla-
tion entre l’observance des recommandations et
des mesures d’hygiène et la prévalence d’EPC. En
2010, des recommandations européennes de prise
en charge et de prévention de la transmission croisée
de ces bacilles à Gram négatif producteurs de carba-
pénémases ont été émises (15). Sans surprise, elles
reprennent les mesures listées ci-dessus, en mettant
l’accent sur l’importance de la coordination des
mesures de contrôle et de la supervision par les
autorités sanitaires. Ces mesures de contrôle sont
importantes pour limiter le risque de dissémination
des BHR, mais il est primordial de rappeler que les
patients porteurs de BHR ne doivent pas subir de
perte de chances dans leur prise en charge du fait
de ces mesures.
Gestion des cas d’EPC
confirmés dans la pratique…
En France, conformément à la circulaire no DGS/RI/
DGOS/PF/2010/413 du 6 décembre 2010 relative
à la mise en œuvre des mesures de contrôle des
cas importés d’EPC, toute mise en évidence de ce
type d’entérobactérie doit faire l’objet d’un signale-
ment aux autorités sanitaires (16). La nécessité de ce
signalement et celle de la mise en place de mesures
spécifiques listées dans le document du HCSP de
2010 ont également été rappelées dans l’instruction
DGS/DUS/RI no 2011/224 du 26 août 2011, relative
aux mesures de contrôle des EPC (17). Une nouvelle
instruction DGS/DUS/CORRUSS n
o
2012/188 du
9 mai 2012 relative à l’organisation des rapatrie-
ments sanitaires vers la France de patients porteurs
de maladies transmissibles nécessitant un isolement
ou de BMR demande que, lors d’un rapatriement
sanitaire, l’agence régionale de santé de la zone
géographique où le patient va être transféré soit
informée de ce rapatriement sanitaire (18), mais
pas l’établissement hospitalier qui l’accueille ! Le
retour d’expérience de ces préconisations n’est pas
encore connu. Une évaluation RAISIN-InVS est en
cours pour analyser la pertinence des mesures mises
en place lorsque l’on retrouve, chez des patients
hospitalisés, des EPC ou des entérocoques résistants
aux glycopeptides. La Société française d’hygiène
hospitalière (SF2H) a, pour sa part, proposé une
enquête par questionnaire à ses adhérents en
juin 2012 (19). Cette enquête déclarative, réalisée
auprès d’un échantillon de 286 établissements de
santé français volontaires, 2 ans après la publi cation
des premières recommandations du HCSP, a souligné
la difficulté qu’ont les établissements de santé à
mettre en œuvre des mesures spécifiques de prise

140 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVIII - no 4 - juillet-août 2013
Signalement et mesures d’hygiène en cas de mise en évidence
d’entérobactéries productrices de carbapénémases
DOSSIER THÉMATIQUE
Carbapénémases
en charge des BHR incluant le dépistage des patients
contacts et la sectorisation des patients concernés
avec personnel dédié. Elle a montré la sous-utili-
sation du système d’information hospitalier pour
la traçabilité des patients. Les résultats de cette
enquête suggèrent que les mesures spécifiques de
prise en charge des patients porteurs de BHR sont
efficaces lorsqu’elles sont appliquées à l’admission.
Mais cette étude, qui montre que 50 % des cas de
BHR sont découverts en cours d’hospitalisation,
souligne la fiabilité variable du repérage et du dépis-
tage des patients plus particulièrement à risque de
portage. Cela nous rappelle une fois de plus que
l’application effective et rigoureuse des précau-
tions standard d’hygiène doit être la règle dans
les établissements de santé et devenir une priorité
nationale pour minimiser le risque de transmission
croisée des BMR, y compris des BHR. De même,
la gestion des excreta, réservoirs habituels de ces
EPC, est également une problématique d’hygiène
importante qui doit faire l’objet d’une analyse à
l’échelle d’un établissement et nécessite l’élabora-
tion d’un protocole des mesures d’hygiène entourant
sa gestion. En cas de mise en évidence de BMR, de
BHR ou de maladies infectieuses transmissibles, des
précautions complémentaires d’hygiène (contact,
gouttelette et air) doivent être prises. De plus, des
précautions complémentaires spécifiques aux BHR
doivent être instaurées lors de la mise en évidence
d’EPC ou d’entérocoques résistants aux glycopep-
tides. Ces mesures sont similaires à la prise en charge
d’une épidémie au sein d’un établissement de santé.
Ainsi, la meilleure prévention de la transmission
croisée de ces BHR repose sur la combinaison de
2 stratégies, l’une à l’échelle individuelle, l’autre à
l’échelle collective.
Une stratégie ciblée individuelle
Il est important de mettre en place des mesures
d’hygiène spécifiques dans les situations à haut
risque de portage de BHR ayant un impact proba-
blement important sur le risque de dissémination.
En effet, la probabilité que les patients à haut risque
(rapatriés sanitaires et patients hospitalisés dans
l’année à l’étranger, ou patients issus de filières de
soins spécifiques à l’étranger) soient porteurs de
BHR est importante, et la mise en place de mesures
de dépistage et de précautions complémentaires
d’hygiène permettra de minimiser le risque de trans-
mission ou, au pire, de détecter rapidement une
dissémination épidémique.
Une stratégie à l’échelle
de la population générale hospitalisée
Cette stratégie consiste en l’amélioration (et aussi
l’augmentation) de l’application des précautions
standard, qui a l’énorme avantage d’avoir un effet sur
l’ensemble de la population admise dans les établis-
sements de santé, mais qui nécessite un changement
profond des comportements en termes d’hygiène
au sein des établissements de santé. Ces mesures
d’hygiène de base, bien appliquées, ont montré leur
efficacité pour endiguer des phénomènes épidé-
miques intra-établissements de santé (20), et il y
a tout lieu de penser que ces mesures, maintenant
très proches des précautions complémentaires
contact dans les dernières recommandations de la
SF2H (21), s’avéreraient efficaces pour la maîtrise
de la transmission croisée des BHR si elles étaient
correctement appliquées.
La lutte contre la dissémination
des BHR : une priorité ?
La réactivité et l’ajustement des mesures de contrôle
à la situation (sporadique, épidémique, endémoé-
pidémique) sont des éléments primordiaux dans la
lutte contre la dissémination des BHR. Le travail
sur le terrain doit être coordonné par les équipes
opérationnelles d’hygiène, qui doivent de plus aider
les services de soins, notamment à la mise en place
des mesures d’hygiène, à la rédaction de check-lists
et à la réalisation d’audits des mesures d’hygiène.
Toutes les recommandations actuelles insistent
sur l’importance d’une stratégie multifacettes,
intégrant la sensibilisation et la mobilisation des
différents acteurs, le repérage des patients à haut
risque et le dépistage des cas et des contacts de
façon à avoir un état des lieux rapide de la situa-
tion et de la dissémination de ces bactéries. La mise
en place de personnel dédié et, selon la situation
épidémique, le regroupement des patients dans
un secteur géographique dédié sont des éléments
essentiels pour minimiser le risque de transmis-
sion des BHR. Le système d’information hospitalier
doit aider les professionnels de santé à repérer les
patients porteurs et les contacts, notamment lors
des transferts, de mutations et de la réadmission de
patients dans les établissements de santé. Un soutien
régional par les antennes régionales de lutte contre
les infections nosocomiales (ARLIN) et les centres de
coordination de la lutte contre les infections noso-
comiales (CCLIN) est également crucial, notamment
 6
6
1
/
6
100%