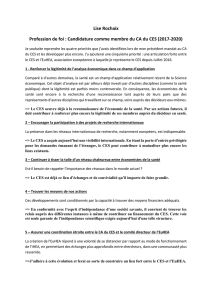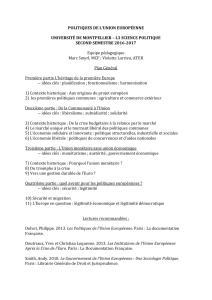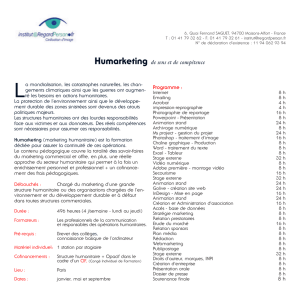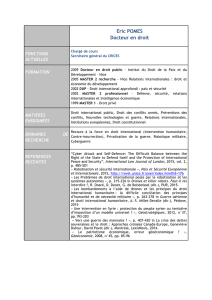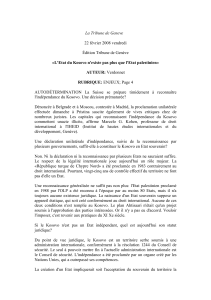article en pdf - Revue trimestrielle des droits de l`homme

UN RENOUVEAU
DU « DROIT D’INTERVENTION HUMANITAIRE »?
VRAIS PROBLÈMES, FAUSSE SOLUTION
Les événements du Kosovo ont réactualisé l’ancien débat sur
l’existence d’un « droit d’intervention humanitaire », qui permettrait
aux Etats d’intervenir militairement pour mettre fin à de graves
violations des droits de l’homme, en dépit de l’absence d’une résolu-
tion du Conseil du sécurité les y autorisant. Les discussions ont
d’abord porté sur la légalité de l’action de l’OTAN, les uns considé-
rant que le droit international avait été bafoué, les autres qu’il
avait évolué à l’occasion de la crise (
1
). Mais, au-delà de cette
controverse particulière, c’est tout le problème éthique de la légiti-
mité de ce type d’action qui est une fois de plus posé, en particulier
dans une société internationale dont chacun s’accorde à relever
qu’elle est en pleine mutation. Les débats ont cependant été obscur-
cis par des réactions passionnelles qui ont parfois mené à un dialo-
gue de sourds. L’épisode de la guerre du Kosovo est emblématique
à cet égard, tant il a donné lieu à des controverses au sein desquelles
étaient régulièrement confondus analyse juridique, tentative d’ex-
plication sociologique ou politique, et réflexion d’ordre philosophi-
que.
Le premier objet de cette étude est, dans un souci de clarification
de la problématique, de donner des outils permettant de mieux dis-
tinguer ces différents plans d’analyse de manière à permettre à cha-
cun d’opérer une réflexion et des choix aussi rationnels que possible.
A cet effet, on distinguera soigneusement les questions suivantes :
(1) La très grande majorité de la doctrine a estimé l’intervention illicite, même
si certains auteurs se sont interrogés par ailleurs sur sa légitimité; voy. p. ex.
N. Ronzitti, « Aerei contro la Repubblica federale di Iugoslavia e Carta delle
Nazioni Unite », Riv. dir. int., 1999, pp. 476 et ss.; B. Simma, « NATO, the UN and
the Use of Force : Legal Aspects », European Journal of Int. Law, 1999, pp. 1-22;
M. Spinedi, « Uso della forza da parte della NATO in Jugoslavia e diritto internazio-
nale », Quaderni Forum, 1998, pp. 23 et s.; M. Kohen, « L’emploi de la force et la
crise du Kosovo : vers un nouveau désordre international », Rev. belge de droit interna-
tional, 1999-I, pp. 122 et s.; N. Valticos, « Les droits de l’homme, le droit interna-
tional et l’intervention militaire en Yougoslavie », Rev. gén. dr. int. pub., 2000, pp. 5
et s.; D. Momtaz, « ‘L’intervention d’humanité’ de l’OTAN au Kosovo et la règle du
non-recours à la force », Rev. int. Croix Rouge, 2000, pp. 89 et s.

— le « droit d’intervention humanitaire » est-il conforme au droit
international existant? (perspective strictement juridique);
— comment peut-on expliquer les difficultés que rencontre le
« droit d’intervention humanitaire » pour s’imposer au sein de la
communauté internationale ? (perspective que l’on pourrait qua-
lifier de sociologique ou de politique) ;
— peut-on sur cette base appréhender sereinement le problème
éthique que soulève ce « droit d’intervention »? (perspective réso-
lument philosophique).
Pour la résumer en quelques mots, notre thèse est que le droit
international répugne à admettre l’hypothèse d’un « droit d’inter-
vention humanitaire » (I). Il ne s’agit pas là de quelque décision
arbitraire et frileuse de quelques Etats, mais d’un choix politique lié
aux particularités de la société internationale actuelle (II). Dans ces
circonstances, il est important de (re)définir la question éthique en
la décomposant en plusieurs choix au sujet desquels chacun sera
amené à se positionner sur le plan éthique (III).
I. — Le maintien d’un régime juridique
non-interventionniste
On sait que le droit international classique permettait aux Etats
d’exercer une souveraineté presque absolue sur leur propre terri-
toire. La création d’un droit des conflits armés, bientôt appelé
« droit humanitaire », ainsi que les progrès considérables de la pro-
tection des droits de la personne après la Deuxième Guerre mon-
diale, ont rendu cette conception obsolète (
2
). En s’engageant à res-
pecter des droits fondamentaux comme le droit à la vie ou au res-
pect de l’intégrité physique, l’interdiction de la torture ou du géno-
cide, ou encore l’abolition de l’esclavage ou du travail forcé, les
Etats ont renoncé à s’opposer à un « droit de regard » porté de l’ex-
térieur concernant le respect de ces droits. En ce sens, le respect des
droits de l’homme est parfaitement compatible avec l’axiome de la
souveraineté, comme d’ailleurs avec le principe de non-intervention.
C’est souverainement que chaque Etat a accepté de s’engager, par
la voie de la ratification d’un traité ou de la participation à l’élabo-
ration d’une coutume. Il ne peut donc ensuite invoquer ses « affaires
696 Rev. trim. dr. h. (2000)
(2) Les quelques lignes qui suivent constituent une synthèse de notre ouvrage,
rédigé en collaboration avec Pierre Klein, Droit d’ingérence ou obligation de réaction ?
Les possibilités d’action visant à assurer le respect des droits de la personne face au prin-
cipe de non-intervention, Bruxelles, Bruylant et éd. U.L.B., 2
e
éd., 1996.

intérieures » pour s’opposer à des tentatives visant à ce qu’il res-
pecte ses engagements en matière de droits de l’homme. Juridique-
ment, une action visant à faire respecter des droits internationale-
ment protégés ne constitue pas une ingérence, et n’est donc pas
contraire au droit international (
3
). Ainsi peut-on, dans certains
conditions et moyennant le respect de certaines procédures, attraire
un Etat devant une juridiction internationale, prendre contre lui
des mesures de rétorsion (en matière diplomatique par exemple),
voire des mesures de représailles — désignées comme des « contre-
mesures légitimes » —, en matière économique notamment (
4
).
Cela ne signifie évidemment pas que chaque Etat puisse réagir à
sa guise à des violations des droits de l’homme commises par un
autre. Il en va tout particulièrement ainsi en matière militaire, où
la seule possibilité de mener une action humanitaire offensive est, si
l’on excepte l’hypothèse exceptionnelle où l’on agirait par ailleurs
pour réagir à une agression (légitime défense), celle de l’autorisation
donnée par le Conseil de sécurité dans le cadre de ses pouvoirs en
matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Dans des cas comme ceux de la Bosnie-Herzégovine, de la Somalie,
ou (quoique fort tardivement) du Rwanda, le Conseil a effective-
ment adopté des résolutions autorisant en substance les Etats à user
de « tous les moyens nécessaires » pour assurer une assistance huma-
nitaire, ce que certains n’ont, de manière plus ou moins prompte et
réussie, pas manqué de faire (
5
). En dehors de cette hypothèse, qui
suppose comme on le sait qu’aucun membre permanent n’exerce son
droit de veto, l’action armée unilatérale reste interdite, et sera
considérée au mieux comme de la justice privée menée en dehors de
toutes les procédures existantes et par conséquent incompatible
avec la notion même d’ordre juridique.
L’intervention au Kosovo a-t-elle suscité une évolution des règles
juridiques sur ce point? C’est parfois ce qui a été prétendu, dans la
mesure où les puissances intervenantes se sont appuyées sur des
motifs humanitaires, et où elles n’ont été condamnées, ni par le
Conseil de sécurité ni, a-t-on entendu, par l’immense majorité des
Rev. trim. dr. h. (2000) 697
(3) Voy. p. ex. la résolution de l’Institut de droit international sur « la protection
des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures
des Etats », Ann. I.D.I., 1990, sp. pp. 338-344.
(4) Voy. nos développements dans Olivier Corten et Pierre Klein, « L’assistance
humanitaire face à la souveraineté des Etats », Rev. trim. dr. h., 1992, pp. 343-364.
(5) Voy. nos développements dans Olivier Corten et Pierre Klein, « L’autorisa-
tion de recourir à la force à des fins humanitaires : droit d’ingérence ou retrour aux
sources? », European Journal of International Law, 1993, pp. 506-533.

Etats (
6
). Cette thèse s’avère à l’analyse extrêmement fragile, et ce
pour trois raisons au moins.
D’abord, les puissances intervenantes elles-mêmes n’ont évoqué
les considérations humanitaires que sur un plan éthique ou politi-
que, en vue de convaincre les opinions publiques, mais elles sont
loin d’avoir développé une argumentation strictement juridique
axée sur le « droit d’intervention humanitaire ». Dans le cas du
Kosovo, le raisonnement juridique a plutôt consisté à interpréter
très largement les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en
1998, en y voyant une forme d’« autorisation implicite » apte à léga-
liser l’intervention (
7
). Au-delà des difficultés suscitées par ce type
d’argument, on relèvera que le principe même de la nécessité d’une
autorisation du Conseil de sécurité n’a nullement été remis en cause
ce qui, paradoxalement, peut être considéré comme une forme de
renforcement du droit existant (
8
). Plusieurs Etats membres de
l’OTAN ont du reste tenu à préciser, une fois la guerre terminée,
que le Kosovo ne pouvait en aucune manière constituer un précé-
dent susceptible de menacer l’indispensable autorité du Conseil de
sécurité (
9
).
Ensuite, et en tout état de cause, il est évident qu’on a considéra-
blement exagéré en prétendant que l’immense majorité des Etats
avait appuyé l’intervention. Il est en effet incontestable qu’un
grand nombre d’Etats ont explicitement condamné l’intervention
de l’OTAN, sans du reste pour autant cautionner les violations des
droits de l’homme commises par les autorités serbes et yougoslaves.
Tel n’a pas seulement été le cas d’Etats comme Cuba (
10
), la Libye,
698 Rev. trim. dr. h. (2000)
(6) J. Currie, « NATO’s Humanitarian Intervention in Kosovo : Making or Brea-
king International Law? », Canadian Yearbook of International Law, 1998, not.
p. 303.
(7) Voy. p. ex. les discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil de sécurité les
24 mars (ONU, Communiqué de presse CS/1035) et 26 mars 1999 (ONU, Communi-
qué de presse CS/1036). Voy. aussi les propos tenus par Jean-Bernard Raimond, par-
lementaire français, lors des débats qui se sont déroulés au sein de l’Assemblée natio-
nale française le 26 mars 1999, Compte-rendu analytique officiel, Sess. ord. 1998-
1999, 79
e
jour, 203
e
.
(8) Voy. notre étude; « Human Rights and Collective Security : Is There and
Emerging Right of Humanitarian Intervention? », à paraître dans Collected Courses
of the Academy of European Law, 1999 (Oxford University Press).
(9) Voy. F. Dubuisson, « La problématique de la légalité. Enjeux et questionne-
ments » in O. Corten et B. Delcourt (eds.), Droit, légitimation et politique extérieure.
L’Europe et la guerre du Kosovo, Bruxelles, Bruylant et ed. U.L.B., coll. droit inter-
national, sous presse.
(10) CS/1036, 26 mars 1999, p. 10.

l’Iran ou l’Iraq, d’Etats issus de l’éclatement de l’ex-U.R.S.S. (
11
),
ou encore de l’Afrique du Sud (
12
), de la Namibie (
13
)oudu
Gabon (
14
). La majorité des Etats latino-américains (Argentine,
Brésil, Chili, Pérou, Venezuela, Bolivie, Colombie, Paraguay, Equa-
teur, Uruguay, Panama, Costa Rica, Mexique) ont, dès le lendemain
du déclenchement de la guerre, adopté un communiqué au sein du
« Groupe de Rio », dans lequel ils condamnaient l’action de
l’OTAN...
«Los paises miembros del Grupo de Rio manifestan su preoccu-
pacion por el inicio de ataques aéreos en contra de objetivos serbios
por parte de la Organizacion del Tratado del Atlantico del Norte
(OTAN) y, en especial, por el hecho de que no se ahyan encon-
trado vias de solucion pacifica, conforme al derecho internacional,
al diferendo existente entre las distintas partes involucradas en el
conflicto en Kosovo [...]. Ademas, el Grupo de Rio lamenta que
se haya recurrido al uso de la fuerza en esa region balcanica, sin
observar lo dipuesto en los Articulos 53 (fraccion primera) y 54
de la Carta de Naciones Unidas [...] »(
15
).
Quant aux Etats qui n’ont pas pris clairement position sur la
question, il est évidemment difficile d’interpréter leur opinio juris.
Il serait cependant à tout le moins étonnant de considérer qu’ils
remettent en cause des règles existantes auxquelles continuent for-
mellement de se référer les puissances intervenantes elles-mêmes.
Enfin, on relèvera que bon nombre d’Etats ont tenu à adopter
une position de principe en ce même sens. On insistera en particulier
sur l’importante Déclaration émise le 24 septembre 1999 par les
ministres des Affaires étrangères de 132 Etats, adoptée dans le
cadre du « Groupe des 77 », et par laquelle
Rev. trim. dr. h. (2000) 699
(11) Décision de l’Assemblée interparlementaire des Etats membres de la C.E.I.
du 30 avril 1999 (Arménie, Bélarus, Kazakhstan, Kirghizie, Moldova, Russie, Tadji-
kistan, Ukraine) qui condamne l’intervention militaire et demande à la Yougoslavie
de résoudre pacifiquement le conflit au Kosovo; Annexe à la lettre du 21 avril 1999
adressée au Secrétaire général par le représentant de la Russie auprès de l’ONU, A/
53/920; S/1999/461.
(12) Le Monde, 3 avril 1999. La position de certains Etats n’est par ailleurs pas
toujours aisée à établir. Dans certains cas (comme la République tchèque), le chef
d’Etat et le gouvernement on adopté des positions radicalement différentes, le pre-
mier approuvant et le second condamnant l’intervention (Le Monde, 31 mars 1999,
p. 4).
(13) CS/1035, 24 mars 1999, p. 8.
(14) Ibid.
(15) GRIO/SPT-99/10; transmis au Conseil de sécurité par le représentant perma-
nent du Mexique par une lettre du 26 mars 1999, A/53/884-S/1999/347.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%