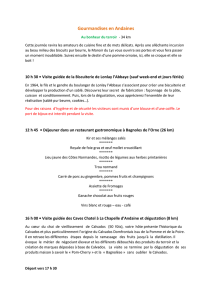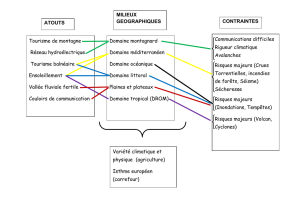Rapport complet de l`étude « Adaptation

Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique
-
Rapport
final
-
25062011
| © 2011
CLIMPACT
Etude sur les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation du
Calvados au changement climatique
Rapport Final
25 juin 2011.
Ce document est le rapport complet de l’étude sur les impacts, les vulnérabilités et les stratégies d’adaptation
du Calvados au changement climatique.

P 2
Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique
-
Rapport final
-
2506
2011
| © 2011 CLIMPACT

P 3
Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique
-
Rapport final
-
2506
2011
| © 2011 CLIMPACT
Résumé
L’objectif de cette étude est d’identifier les impacts, les vulnérabilités et les stratégies d’adaptation du
Calvados face au changement climatique, dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial
(PCET) mené par le Conseil Général du Calvados.
La caractérisation et l’analyse systémique du territoire ont permis de mettre en valeur les enjeux et les
dynamiques actuels du Calvados : une capacité d’adaptation élevée, des activités économiques
essentiellement basées sur l’agriculture, l’élevage, le tourisme et les activités industrielles. Par ailleurs,
l’artificialisation croissante des terres amplifie la spéculation foncière et la pression sur les terres agricoles et
les ressources naturelles. Enfin, le territoire présente une très forte hétérogénéité spatiale de ses enjeux
(gradients terre-littoral et est-ouest).
L’étude des vulnérabilités passées révèle une exposition récurrente aux événements extrêmes et aux risques
naturels, et des impacts forts sur les ressources naturelles, le secteur primaire, les infrastructures, l’accès aux
réseaux et services, et le tourisme. Ces impacts sont accentués par une occupation du sol tendue, des
terrains fragiles et une densité de population élevée. Les capacités d’adaptation du territoire sont importantes.
Par exemple, il bénéficie de la présence d’écosystèmes offrant de nombreux services de régulation et de
protection. Enfin, la forte hétérogénéité spatiale des enjeux implique des sensibilités très spécifiques à chaque
site.
Les scénarios prospectifs existants suggèrent une démographie, une urbanisation et une pression sur les
ressources naturelles croissantes, des ressources en eau en équilibre fragile et une sécurité alimentaire
assurée. En ce qui concerne le climat du Calvados, les projections indiquent un phénomène de
méditerranéisation : une augmentation de la température tout le long de l’année, une période de déficit
hydrique en été, des précipitations plus intenses, des vents et un rayonnement solaire plus élevés.
L’étude des impacts futurs indique que le littoral est sujet à un accroissement des risques de type inondations,
mouvements de terrain, submersions marines et tempêtes. Les infrastructures et les écosystèmes littoraux et
marins sont très vulnérables au climat futur. Enfin, de nouvelles opportunités semblent se présenter pour le
tourisme et l’agriculture. En milieu urbain, le changement climatique projeté semble accroître les vulnérabilités
liées aux risques, à la qualité du cadre de vie (air, îlot de chaleur), et à l’état des infrastructures. Le milieu
rural sera plus influencé par les activités humaines. En outre, les nouvelles donnes climatiques pourraient
impacter l’agriculture (bénéfice lié au profil climat mais sujet à des irrégularités), l’état des infrastructures et
l’intensité des risques naturels.
Le coût de certains des impacts projetés a été estimé. Il représente le coût de l’inaction à économie
constante. Il ressort que l’impact du profil climat projeté pour 2050 impliquerait des bénéfices globaux
cumulés pour l’agriculture compris entre 198 et 475 millions d’euros constants (céréales, oléagineux et
pâtures), mais sans prendre en compte les dommages dus à l’occurrence des événements extrêmes. La
montée du niveau de la mer de +50 cm en 2050 impliquerait un coût compris entre 5 et 5,6 milliards d’euros

P 4
Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique
-
Rapport final
-
2506
2011
| © 2011 CLIMPACT
(terres perdues, infrastructures et bâtiments). Enfin, l’augmentation des températures induirait un bénéfice
global cumulé en 2050 pour le tourisme de 1 à 1,5 milliards d’euros constants.
Face aux politiques de gestion et de développement actuelles dans le Calvados, le changement climatique
demande un renforcement des réflexions socio-économiques prospectives transversales (urbanisation,
agriculture, ressources, eau). Il ressort également que les risques du littoral, l’état des infrastructures et
l’évolution des écosystèmes ont besoin d’être mieux appréhendés. La dernière partie dresse donc un
panorama des stratégies d’adaptation possibles et prioritaires. A l’aide de critères de sélection définis avec la
participation des acteurs du territoire (poids économique, sans regret, flexibilité, anticipation, cohérence avec
les objectifs d’atténuation et acceptabilité), 20 stratégies principales puis 5 stratégies prioritaires ont été
sélectionnées. Elles concernent la biodiversité, les infrastructures, l’agriculture et les milieux urbain et littoral.

P 5
Etude Adaptation du Calvados au Changement Climatique
-
Rapport final
-
2506
2011
| © 2011 CLIMPACT
Sommaire
Résumé
RésuméRésumé
Résumé........................................................................................................................ 3
Sommaire
SommaireSommaire
Sommaire .................................................................................................................... 5
Table des illustrations
Table des illustrationsTable des illustrations
Table des illustrations ................................................................................................. 8
1.0
1.01.0
1.0 Introduction et contexte de l’étude
Introduction et contexte de l’étudeIntroduction et contexte de l’étude
Introduction et contexte de l’étude .................................................................... 12
2.0
2.02.0
2.0 Caractérisation du territoire et vulnérabilités actuelles
Caractérisation du territoire et vulnérabilités actuellesCaractérisation du territoire et vulnérabilités actuelles
Caractérisation du territoire et vulnérabilités actuelles ...................................... 14
1.
1.1.
1.
Les
Les Les
Les éléments naturels
éléments naturelséléments naturels
éléments naturels ............................................................................................................ 14
1.1.
Les éléments statiques de l’environnement .......................................................................14
1.2.
Les enjeux dynamiques de l’environnement ......................................................................16
1.3.
L’air .....................................................................................................................................19
1.4.
Le climat..............................................................................................................................19
1.5.
L’eau....................................................................................................................................25
1.6.
Biodiversité et milieux naturels ..........................................................................................30
2.
2.2.
2.
Le développement des activités humaines
Le développement des activités humainesLe développement des activités humaines
Le développement des activités humaines ............................................................................. 33
2.1.
Population, occupation du sol et paysages ........................................................................33
2.2.
Mobilité, réseau et cadre de vie..........................................................................................39
2.3.
Activités économiques ........................................................................................................43
2.4.
Les politiques de développement et de gestion de l’environnement ................................50
2.5.
Dépendance en énergie et en ressources premières énergétiques ...................................58
2.6.
Les enjeux et dynamiques face au climat...........................................................................60
3.
3.3.
3.
Vulnérabilités actuelles au climat
Vulnérabilités actuelles au climatVulnérabilités actuelles au climat
Vulnérabilités actuelles au climat........................................................................................... 61
3.1.
Expositions passées et perspectives ..................................................................................61
3.2.
Synthèse des vulnérabilités actuelles du Calvados aux changements climatiques ...........71
3.0
3.03.0
3.0 Scénarios de vulnérabilités futures au changement climatique
Scénarios de vulnérabilités futures au changement climatiqueScénarios de vulnérabilités futures au changement climatique
Scénarios de vulnérabilités futures au changement climatique .......................... 72
1.
1.1.
1.
Scénarios de prospectives socio
Scénarios de prospectives socioScénarios de prospectives socio
Scénarios de prospectives socio-
--
-économiques
économiqueséconomiques
économiques...................................................................... 72
1.1.
Démographie ......................................................................................................................72
1.2.
Urbanisation et pressions sur les ressources.....................................................................73
1.3.
Raréfaction du pétrole ........................................................................................................77
1.4.
Prospective économique .....................................................................................................81
2.
2.2.
2.
Scénarios climatiques
Scénarios climatiquesScénarios climatiques
Scénarios climatiques ............................................................................................................ 82
2.1.
Méthodologie pour la projection des données climatiques futures ..................................82
2.2.
Résultats..............................................................................................................................85
2.3.
Analyse des projections et notion d’analogue ...................................................................88
2.4.
Autres résultats...................................................................................................................90
3.
3.3.
3.
Analyse des vulnérabilités futures
Analyse des vulnérabilités futuresAnalyse des vulnérabilités futures
Analyse des vulnérabilités futures ......................................................................................... 92
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
1
/
195
100%