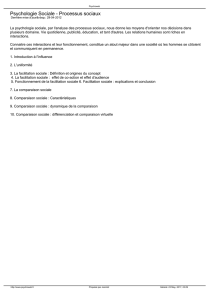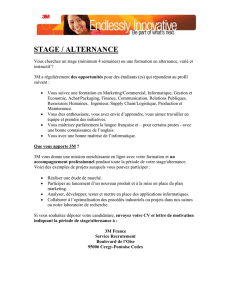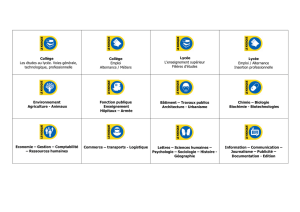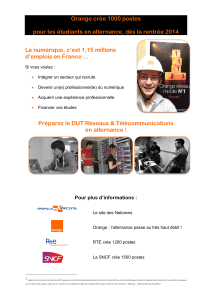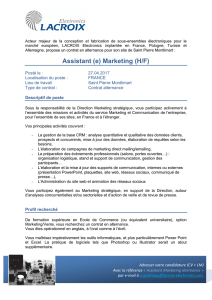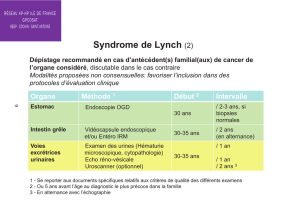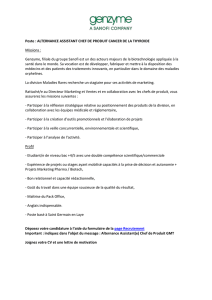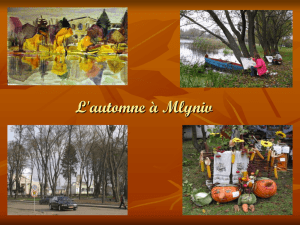Analyse des stratégies de communication et de coopération

__________________________________________________________________________________
Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions
Analyse des stratégies de communication et de
coopération utilisées par le médecin dans douze
consultations médicales de routine21
Michèle-Isis Brouillet et Marie-Yolande Bujold
Université du Québec à Montréal
RÉSUMÉ
À partir d’une analyse de la communication patient/médecin dans douze consultations
médicales de routine, le présent article vise à identifier les stratégies de communication
utilisées par des médecins et la présence de la coopération dans leurs dialogues. Les
résultats de l’étude montrent que les stratégies de communication les plus utilisées sont
l’information (52%) et la facilitation (49%), que la stratégie la moins utilisée est l’entretien
(0.6%) et qu’il y a peu de coopération dans les douze cas étudiés car un seul dialogue
franchit le seuil requis de 35 %. Le manque de mobilité dans l’utilisation des stratégies
peut expliquer l’état de la coopération présente dans l’étude et jouer un rôle important
dans l’intégration de changements d’habitude de vie ou autres consignes présentées au
patient par le médecin.
CONTEXTE
Dans le domaine de la santé, on constate des changements majeurs affectant la
communication médicale aussi bien pour les patients que pour les médecins. Par
exemple, on constate une attitude plus active des patients dans l’affirmation de
leurs besoins lors des interactions avec les médecins (Wiles et Higgins, 1996;
Stewart et Weston : voir Stewart, Brown, Weston, Mc Whinney, McWillam
Freeman,1995). On remarque également la présence d’un problème de
communication joint à la présence d’une erreur technique, c’est-à-dire une
21 Nous remercions l’Équipe de recherche en médecine familiale de la Cité de la Santé de Laval pour
avoir contribué au financement de la recherche et, plus particulièrement, le Dr Marie-Thérèse Lussier
qui a accepté qu’une étude secondaire puisse être menée à partir de la recherche qu’elle avait réalisée
sur la détresse psychologique en médecine générale.

80 Analyse des stratégies de communication et de coopération
__________________________________________________________________________________
Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions
négligence ou une erreur médicale reliée à l’expertise du médecin, dans
plusieurs des poursuites contre les médecins soit à peu près 70 % (Beckman,
Markakis, Suchman et Frankel, 1994; Levinson, Roter, Mulloly, Dull et
Frankel,1997). Les problèmes de communication demeurent une source
importante d’insatisfaction des patients selon des enquêtes menées aux États-Unis
(Finocchio et al., 1995) et au Québec (Robert, 1999). La récurrence de cette
insatisfaction suscite l’intérêt d’explorer les recherches menées sur ce sujet.
Dans le cadre d’une recherche plus large portant sur la fréquence, le contenu, les
stratégies utilisées par des médecins généralistes (Beaudoin, Lussier, Gagnon,
Brouillet et Lalande, 1999), notre étude a analysé les stratégies de communication
naturellement utilisées par les médecins, dans le but de connaître si celles-ci
pouvaient favoriser la présence de la coopération telle que proposée par St-
Arnaud. Notre recherche participe ainsi à l’amélioration des communications
professionnelles des médecins généralistes en proposant une méthode pour
l’analyse des stratégies de communication lors de leurs consultations de routine.
La recherche s’inscrit également dans une démarche de connaissance des
conditions de communication permettant de faciliter l’adhésion des patients à des
prescriptions médicales vitales pour leur bien être. Que l’on pense aux problèmes
cardiovasculaires, aux problèmes d’obésité ou de consommation de cigarettes.
RECENSION DES ÉCRITS
Depuis 1990 il y a eu un effort important de recherches au sujet de la
communication patient/médecin (Simpson, Buckman, Stewart, Maguire, Lipkin,
Novack et Till, 1991; Northouse et Northouse, 1992; Chugh et Lockyer, 1995;
Boon et Stewart,1998). L’une des directions de recherche propose une série de
modèles de communication clinique (Health Beliefs Model, le Reinforcement
Expectancy Theory, le Tri-Function Model of the medical interview) pour encadrer
la communication dans les relations de soins (Suchman, Markakis, Beckman et
Frankel, 1997; Morgan et Winter, 1996). Ainsi, l’introduction de la méthode du
“ patient centered medicine ” amène une transformation de la vision traditionnelle
de la consultation médicale. En effet, l’approche traditionnelle vise à interpréter
les signes et les symptômes du patient en terme de pathologie physique alors que,
dans la méthode centrée sur le patient, le médecin vise à comprendre les idées, les
sentiments et les valeurs du patient par le biais de l’utilisation de techniques de
communication (McWhinney, 1989). La définition suivante de la relation
patient/médecin illustre ce changement : “ Une relation négociée dans laquelle

Analyse des stratégies de communication et de coopération
__________________________________________________________________________________
Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions
81
chacun des acteurs a l’opportunité d’influencer la relation ” (Wiles et Higgins,
1996; p.351). Cette relation a pour objet de définir un problème, d’établir les
objectifs d’un traitement et d’identifier les rôles qui seront tenus par le médecin et
le patient à l’intérieur de cette relation (Stewart, 1995).
Dans le champ des communications interpersonnelles plusieurs approches
permettent de se centrer sur la complexité du dialogue médical en tenant compte à
la fois du contexte du dialogue étudié, des interactions mêmes et du milieu naturel
des échanges (Bateson, 1972; Goffman, 1974; Cosnier, Grosjean et Lacoste,
1993). Winkin (1981) propose même une métaphore pour illustrer la spécificité de
la rétroaction22, concept essentiel à toute théorie de la communication, il s’agit de
la métaphore de l’orchestre; la communication y est conçue comme un système à
multiples canaux auquel l’acteur social participe à tout instant. En sa qualité de
membre d’une certaine culture, il fait partie de la communication, comme le
musicien fait partie de l’orchestre. La consultation médicale est un lieu qui peut
répondre à cette métaphore dans la mesure ou l’accent est mis sur la circularité des
échanges a contrario du modèle de la théorie classique de la communication qui
est un modèle linéaire.
En effet, il y a bien deux acteurs sociaux qui participent, tant au plan du contenu
qu’à celui de la relation, à l’atteinte d’une cible commune par les échanges qu’ils
entretiennent et ce, en tenant compte des différents contextes qui encadrent la
relation médicale. On ne parle pas ici de situations d’urgence mais de situations où
il y a une consultation pour un bilan de santé ou pour un suivi régulier, que ce soit
en cabinet privé ou dans une clinique. De plus, la spécificité de la consultation
médicale doit être prise en compte. La consultation vise le partage d’information
et la facilitation des effets thérapeutiques, elle se déroule au moins en trois temps :
l’anamnèse qui ouvre l’entrevue en cueillant les faits concernant l’histoire
médicale du patient et la définition du problème; l’examen physique qui permet de
tester la définition du problème, et la conclusion qui inclut l’annonce du
diagnostic, la négociation du plan de traitement (prescription), la planification du
suivi et la fermeture. C’est dans ce contexte précis de la pratique professionnelle
22 La notion de feed-back (ou rétroaction) provient de la cybernétique; d’abord appliqué à la
machine, le concept s’est étendu aux interactions humaines. Littéralement, il s’agit d’un retour
d’information à la source émettrice, ce qui permet de corriger l’acte suivant selon le sens désiré
ou le besoin. Dans un échange entre un émetteur et un récepteur, l’envoi d’un message initial est
suivi d’une réponse du récepteur qui constitue un second message dont une partie sera une
rétroaction au message initial. Ainsi chaque interlocuteur exerce un contrôle sur l’autre par la
rétroaction.

82 Analyse des stratégies de communication et de coopération
__________________________________________________________________________________
Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions
en médecine familiale que se situe notre étude. Souvent, à l’étape du diagnostic et
de la prescription, le médecin se trouve dans la situation où la réussite des soins
exige la participation active du patient. Ainsi, le médecin a besoin en quelque sorte
de la coopération de celui-ci pour atteindre son objectif clinique.
Dans cette optique, des chercheurs dans le domaine de la santé ont tenté
récemment de développer la notion de “ compétence ” dans la communication
patient/médecin en s’appuyant sur les méthodes centrées sur le patient (Stewart,
1995), sur la communication relationnelle (O’Hair, 1989; Cecil Wigginton, 1998)
et sur la “ compétence d’action ” (Hellstrom, 1998).
C’est la voie que nous allons suivre, car la compétence d’action permet de
recadrer les recherches. Dans le champ des communications interpersonnelles les
travaux d’Argyris (1962) et ceux d’Argyris et Schön (1974) vont permettre de
poursuivre le développement de cette piste de recherche qui vise l’efficacité de
l’action par une meilleure maîtrise des stratégies communicationnelles présentes
lors des consultations médicales considérées ici comme des dialogues (Roter et
Frankel, 1992; Abramovitch et Schartz, 1996).
Peu d'auteurs ont utilisé la science action (Argyris, Putman et McLain Smith,
1985; St-Arnaud, 1995) pour mener des recherches sur les stratégies de
communication des médecins dans leurs échanges avec leurs patients. Dans le
cadre de cette approche, la compétence communicationnelle ne consiste pas à ne
pas faire d’erreurs mais plutôt à les corriger rapidement, dans le feu de l’action. En
effet, il est possible de corriger “ in vivo ” l'effet de la communication sur le
patient et d'orienter ainsi le dialogue vers l'efficacité et la satisfaction, aussi bien
au sujet des prescriptions qu'au plan de la communication avec ce patient. Cette
manière de procéder s'appelle la praxéologie (St-Arnaud) et repose sur une vision
de la coopération avec le patient où les habiletés interpersonnelles du médecin
jouent un rôle crucial. La praxéologie est “ une démarche structurée visant à
rendre l'action consciente, autonome et efficace ” (St- Arnaud, p. 19). Son but est
de fournir à tout professionnel des moyens d'améliorer sa pratique quotidienne en
faisant l’analyse de ses dialogues. L’originalité de notre étude consiste à utiliser
cette grille d’analyse comme méthode de recherche.
À notre connaissance, c’est la première fois que la grille d’analyse d’un dialogue
élaboré par St-Arnaud (1995) est utilisée comme méthode d’analyse des
consultations médicales.

Analyse des stratégies de communication et de coopération
__________________________________________________________________________________
Vol. 4, no 2, automne 2000 Interactions
83
LE MODÈLE DE LA COMMUNICATION COMME CADRE
DE RÉFÉRENCE
Ce modèle descriptif de la communication repose sur quatre fonctions auxquelles
sont associées quatre stratégies : la réception, la facilitation, l’entretien et
l’information. Ainsi “ tous les comportements d’un acteur, dans un dialogue, sont
considérés comme des façons d’exercer ces différentes fonctions ” (St- Arnaud,
1995, p. 89). Par exemple, le médecin exerce la fonction de réception par son
comportement non verbal lorsqu’il écoute le patient. Si le médecin amène le
patient à lui fournir des renseignements, il exerce alors la fonction de facilitation.
Lorsque le médecin donne des indications sur ce qui se passe entre lui et le patient,
il utilise la fonction d’entretien et il utilise la fonction d’information quand il
fournit des avis concernant l’objet de la rencontre. L’ensemble des moyens mis en
œuvre pour exercer une fonction donnée forme la stratégie liée à cette fonction.
La stratégie de facilitation joue un rôle majeur car elle suscite la participation. Elle
temporise les moments de désaccords qui peuvent survenir entre le médecin et le
patient au cours des échanges. Elle se fait par une écoute active et recherche cinq
classes d'information: la verbalisation générale (F); la verbalisation de faits (f); la
verbalisation des ressentis (a); la verbalisation des idées (r) et la verbalisations des
intentions (i).
Tableau 1 Stratégies de communication
Reception (R)
• L'écoute contribue à créer un climat de confiance, où
l'interlocuteur est encouragé à fournir l'information
nécessaire à l'atteinte des buts poursuivis.
Facilitation (F) • Le praticien intervient verbalement pour encourager
l'interlocuteur à introduire de nouvelles informations dans
le système même si l'objectif est toujours de recevoir de
l'information.
Entretien (Er) • Le praticien se préoccupe de la façon de procéder ou de
communiquer. Il est alors centré sur le processus de
communication plutôt que sur le contenu informationnel.
Information (Ic) • Le praticien insère lui-même du contenu dans la
conversation. Ce contenu peut aussi bien être une opinion
(personnelle ou pratique) qu'un argument ou des
connaissances personnelles.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%