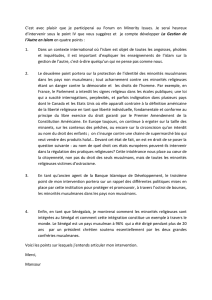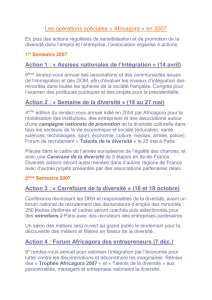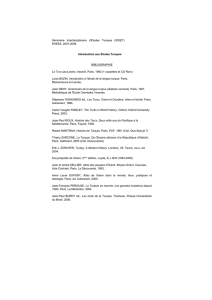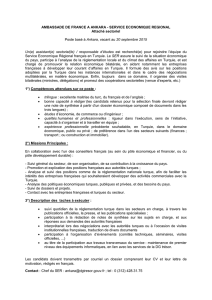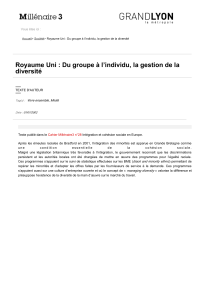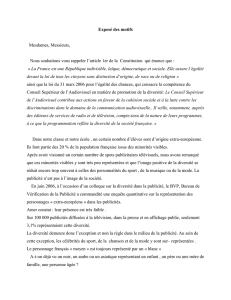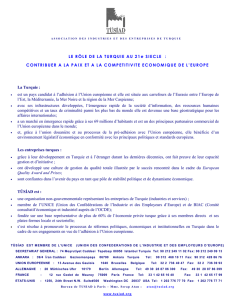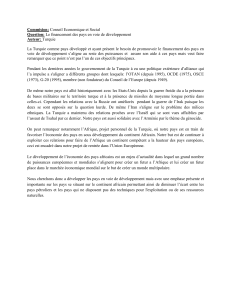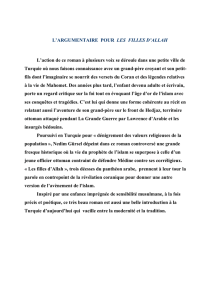Pérouse texte définitif

1
Paul Dumont
Le statut des minorités non musulmanes
et la notion de citoyenneté dans la Turquie républicaine
Communication faite au colloque de Pérouse, 15-17 décembre 2005
Longtemps occultée, ou considérée comme marginale, la question des minorités, qui a fait
couler tant d’encre dans les dernières décennies de l’Empire ottoman et à l’orée du 20
ème
siècle, est de nouveau à l’ordre du jour en Turquie. Il suffit d’ouvrir un de ces journaux dont
le pays abonde, pour la voir évoquée, tantôt en première page, tantôt dans une des multiples
chroniques que tout quotidien turc digne de ce nom se doit de proposer à ses lecteurs. De
toute évidence, ce sont, pour l’essentiel, les négociations complexes de la diplomatie turque
avec l’Union européenne qui ont remis le dossier au goût du jour. L’Europe d’aujourd’hui a
fait comme celle d’hier, celle qui discutait pied à pied les conditions auxquelles elle pourrait
accorder son soutien à l’Empire ottoman et garantir, sur le papier tout au moins, son intégrité
territoriale. Une des exigences avancées pour admettre la Turquie dans le club des pays
candidats à l’Union européenne a été qu’elle promette, comme jadis, de respecter les droits
des minorités. Cette exigence, sans cesse martelée, notamment par le biais des rapports
annuels de la commission des communautés européennes sur les progrès réalisés par la
Turquie sur la voie de l’adhésion
1
, n’a pas seulement conduit le gouvernement d’Ankara à
mettre en chantier de substantiels réaménagements législatifs ; elle a également ouvert la voie
à de vifs débats au sein de l’opinion éclairée, débats qui, aujourd’hui encore, battent leur
plein.
Une des questions qui revient constamment sur le tapis, dans ces prises de position, est
de savoir quels sont au juste les éléments de la population qui ont droit à l’étiquette de
« minoritaires ». L’autre thème qui prête à discussion est de savoir comment ces minoritaires
se positionnent par rapport à la nation turque. En font-ils partie ? Ou bien doivent-ils, au
contraire, être considérés et traités comme des éléments exogènes ? Cette interrogation en
inclut une autre. En effet, dans la mesure où les minoritaires sont des citoyens de la
République de Turquie qui bénéficient d’avantages spécifiques et qui sont assujettis à des
contraintes également spécifiques, certains commentateurs ne manquent pas de s’interroger
1
Voir par exemple le Rapport régulier 2001 sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l’adhésion,
Bruxelles, Commission des communautés européennes, 133 pages, consultable sur le site internet de la
Commission. Les rapports des années 2002, 2003 et 2004 accordent une importance comparable à la question
des minorités en Turquie.

2
sur les limites leur appartenance à la grande famille des ressortissants turcs. Citoyens, ils le
sont certes, entend-on dire, mais, de facto, citoyens d’un genre particulier. Les communautés
concernées s’emploient elles aussi à faire connaître leur façon de voir, n’hésitant pas à se
présenter comme les mal-aimées d’une République peu respectueuse du droit à la différence.
C’est ainsi, en particulier, que depuis quelques années le périodique Agos mène, au sein de
l’élément arménien, le combat pour une citoyenneté à part entière. Chez les Grecs, c’est le
patriarche Bartholoméos I
er
lui-même qui, bien souvent, se trouve la tête des escarmouches
avec les autorités du pays, prenant appui, chaque fois que nécessaire, sur le soutien américain
ou européen. Bien qu’ils aient derrière eux une longue tradition de non contestation du
pouvoir politique, les Juifs de Turquie n’ont pas échappé à la tentation de faire entendre leur
voix dans ce concert de reproches. Certains de leurs intellectuels, il est vrai mal vus des
instances communautaires, ont multiplié les publications dénonçant les atteintes au principe
d’égalité entre les citoyens dont la communauté juive a pâti au cours des premières décennies
républicaines
2
.
Tous ces débats ne vont pas sans une certaine confusion. D’où la nécessité, ici, de
rappeler d’abord dans quelles circonstances a pris forme, dans la Turquie kémaliste, le statut
des minorités. Ce bref retour sur un passé proche devrait permettre de mieux appréhender,
dans la suite de l’étude, les particularités que présente ce statut dans un Etat auquel on fait
volontiers reproche d’être peu économe en matière de discriminations alors qu’il n’a manqué
aucune occasion, au cours de son histoire récente, d’insister sur le prix qu’il attachait au
respect d’une parfaite égalité entre les citoyens. L’objectif visé n’est assurément pas de
dresser l’inventaire des manquements, réels ou imaginaires, à mettre au passif de la Turquie
dans son traitement du dossier des minorités. Un tel inventaire est du ressort de ceux qui s’y
emploient quotidiennement à le dresser : les fonctionnaires de la communauté européenne, les
journalistes, les observateurs des ONG spécialisées et, au sein même de l’appareil d’Etat turc,
l’armée de fonctionnaires chargée de travailler à la « convergence » entre la Turquie et
l’Europe. Dans cette contribution, il s’agira plutôt de mettre le doigt sur la versatilité et
l’ambivalence avec laquelle les pays d’Atatürk appréhende le fait minoritaire, tantôt mettant
en exergue un attachement indéfectible au modèle d’une citoyenneté égalitaire, d’autres fois
veillant à bien séparer le bon grain de l’ivraie et allant jusqu’à assimiler les membres des
minorités à des étrangers. Parmi les nombreux dossiers qui alimentent, aujourd’hui, le
2
On pense ici, surtout, aux nombreux articles et ouvrages de Rifat Bali. Voir en particulier Cumhuriyet
Yıllarında Türkiye Yahudileri. Bir Türkleştirme Serüveni. 1923-1945 (Les juifs de Turquie sous la République.
Un processus de turquisation. 1923-1945), Istanbul, Đletişim, 1999.

3
contentieux entre les minorités et les autorités turques, il y en a un qui mérite de retenir tout
particulièrement l’attention : celui des fondations pieuses (azınlık vakıfları). Cette question a
fait couler beaucoup d’encre au cours de ces dernières années. Lorsqu’on l’examine, ce qui
frappe le plus, à côté de l’ampleur des pressions auxquelles les communautés concernées ont à
faire face, c’est le remarquable flou dans lequel baignent les relations entre les instances
politiques, administratives et judiciaires du pays et ceux qui, à toute occasion, se voient
rappeler leur condition de citoyens d’un type particulier.
1. Le fait minoritaire : un héritage
Impossible de comprendre le fait minoritaire, tel qu’il se présente dans la Turquie
d’aujourd’hui, sans prendre en considération le passé. Qu’il soit grec, arménien ou juif, le
minoritaire est avant tout un héritier. Le statut dont il bénéficie -ou qu’il subit- procède dans
une assez large mesure du « système des millet » instauré par les sultans réformateurs du
19
ème
siècle. Le minoritaire porte aussi sur ses épaules le poids d’une faute imprescriptible :
celle commise par ses parents ou grands-parents lorsqu’ils choisirent, durant la Première
Guerre mondiale et dans l’immédiate après-guerre, de faire de leur mieux pour contribuer au
démantèlement de l’Empire ottoman. Enfin, il assume l’héritage qui lui a été légué par ceux
qui, en 1923, ont signé le traité de paix de Lausanne. Les dispositions relatives aux minorités
qu’on y trouve font encore office de vulgate, même si d’aucuns font reproche au
gouvernement d’Ankara d’avoir fréquemment violé l’esprit et la lettre de ce texte fondateur
de la Turquie moderne.
Il n’est pas nécessaire, ici, de décrire en détail le « système des millet », tant la
littérature sur cette question est abondante
3
. On se contentera de remarquer que ce
« système », qui doit son existence autant à l’élan modernisateur des hommes d’Etat des
tanzimat qu’aux pressions européennes exercées sur l’Empire ottoman, a permis aux sujets
non musulmans du sultan de bénéficier d’une substantielle marge d’autonomie, notamment en
matière d’organisation interne des communautés, de gestion des biens communautaires et de
politique scolaire. La liberté de manœuvre accordée aux communautés était telle que les
membres de celles-ci n’avaient que des contacts limités avec l’administration ottomane. Pour
3
C’est principalement à B Braude que l’on doit la notion de « système » appliquée aux règles mises en place, au
19
ème
siècle, pour organiser la vie interne des communautés non musulmanes de l’Empire ottoman. Cf.
« Foundation Myths of the Millet System », dans D. Braude et B. Lewis (eds.), Christian and Jews in he Ottoman
Empire, vol. 1, New York et Londres, Holmes & Meier, 1982, pp. 69-88. Cet article, ainsi que l’ensemble de
l’ouvrage dans lequel il est inséré, ont constitué le point de départ d’une abondante production sur le même
thème, production dont on peut retenir, par exemple, l’article « millet » de M. Ursinus dans l’Encyclopédie de
l’Islam.

4
bon nombre de question touchant au droit des personnes, l’instance compétente était l’autorité
religieuse ou civile de chaque millet. Bien souvent, c’est à ces instances qu’il revenait de
procéder à des dénombrements démographiques, de fournir des documents d’identité à leurs
administrés, d’enregistrer les transactions immobilières, ou même d’établir des passeports
4
.
Mais, à une époque où les élites des différentes composantes de la population
ottomane s’évertuaient à jeter les bases d’une cohabitation fraternelle entre les « nations » de
l’Empire et où les autorités impériales s’employaient à bâtir -difficilement- une appartenance
ottomane frappée au sceau de l’unité et de l’égalité, cette autonomie avait, paradoxalement,
un goût de mise en quarantaine. Dotés de leurs propres écoles, de leurs propres services de
santé, d’organes administratifs qu’ils n’avaient à partager avec aucune autre communauté, les
sujets chrétiens et juifs du sultan étaient désormais en mesure de vivre en vase clos et
n’avaient que rarement l’occasion de témoigner de leur adhésion à une même mystique
nationale. De surcroît, à supposer même qu’ils eussent voulu jouer la carte de l’intégration à
une virtuelle nation ottomane, il leur fallait compter avec les sentiments de méfiance dont, ici
ou là, ils ne manquaient pas de faire l’objet. C’est ainsi, en particulier, que les portes de
l’armée, lieu de brassage par excellence, leur étaient pratiquement closes, sauf pour quelques
spécialités techniques telles que la médecine militaire ou les travaux publics
5
. C’est ainsi, de
même, qu’il leur fallait s’accommoder d’une législation qui encadrait de manière assez stricte
leurs possibilités d’accès à la propriété foncière et immobilière.
A partir des années 1890, et même avant, ce n’est plus de simple méfiance qu’il s’agit,
mais de véritable divorce entre les minoritaires -que l’on ne désigne pas encore couramment
ainsi- et l’élément musulman de l’Empire. Les notables des communautés ont beau multiplier
les déclarations d’allégeance à l’endroit du sultan et de son gouvernement, ils ont beau
proclamer leur fidélité indéfectible à la patrie ottomane, les faits ne cessent de les démentir :
les organisations révolutionnaires arméniennes multiplient les actes de provocation,
fournissant aux autorités l’occasion d’ouvrir la bonde à de sanglantes répressions ; la guerre
gréco-turque de 1897 donne à voir, en Anatolie, des sujets chrétiens du sultan qui, gagnés à la
grécité, n’hésitent pas, l’espace d’une campagne militaire, à rejoindre les rangs de l’adversaire
pour combattre l’armée ottomane. En 1914, au moment où la Sublime Porte décide d’apporter
son soutien aux puissances centrales dans le conflit qui les oppose à l’Entente, le contentieux
4
Cf. M. Anastassiadou, « Déléguer pour gouverner. L’Etat civil au sein des communautés non musulmanes dans
l’Empire ottoman. Les Grecs orthodoxes d’Istanbul (1840-1923 », communication non publiée.
5
Voir à ce propos, par exemple, Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşların Hukukî Durumu. 1839-
1914 (La situation juridique des ressortissants ottomans non musulmans. 1839-1914), Ankara, TTK, 1989,
pp.120-169.

5
entre les populations non musulmanes de l’Empire et les patriotes turcs, de plus en plus
nombreux à s’identifier comme tels, est considérable. Les revendications grecques relatives à
la Crète, la reprise des affrontements entre Arméniens et musulmans (notamment à Adana, en
1909), la guerre avec l’Italie suivie de près d’échecs militaires cinglants face aux puissances
balkaniques : autant de raisons d’en vouloir à ceux qui, à l’intérieur de l’Empire, ne disent que
du bout des lèvres leur attachement à la nation ottomane ou qui vont même jusqu’à la trahir
6
.
Mais le pire est encore à venir. En 1922, lorsque les délégués des puissances
belligérantes prennent place autour de la table des négociations à Lausanne, la Turquie vient
de sortir d’un véritable cataclysme, avec le sentiment d’avoir eu à faire front, durant huit
années tragiques, autant à des adversaires extérieurs qu’à une multitude d’ennemis de
l’intérieur. Ce ne sont pas seulement avec les Arméniens, victimes d’une politique
d’extermination dès les premiers mois de la Grande Guerre, que la rupture semble
irrémédiable. Les Grecs qui, au lendemain de l’armistice de Moudros (octobre 1918), ont
accueilli les forces de l’Entente avec de bruyantes manifestations d’enthousiasme et qui ont
facilité l’occupation des provinces égéennes par les troupes du roi Constantin, sont eux aussi
perçus comme des traîtres. D’autres nations chrétiennes, et notamment celle des Assyro-
Chaldéens, n’échappent pas davantage à l’opprobre. Même les juifs, pourtant si prodigues en
gestes d’allégeance à l’égard du pouvoir, sont désormais suspects puisque certains d’entre
eux, gagnés aux idéaux sionistes, n’ont pas hésité à collaborer avec les nationalistes grecs et
arméniens
7
. A Lausanne, on verra le chef de la délégation turque, Ismet Pacha, affirmer, après
avoir fait l’historique de ces trahisons, que les Turcs étaient disposés à « oublier volontiers
tous les événements du passé »
8
. Vaines paroles. Le traumatisme était si profond qu’il devait
durablement la mémoire collective.
Nonobstant les rancœurs accumulées, les représentants du gouvernement d’Ankara
allaient demander avec insistance, pendant les négociations de paix, que les populations non
musulmanes de Turquie soient pleinement assimilés, du point de vue de leurs droits et devoirs
en tant que ressortissants turcs, à leurs « compatriotes » de religion musulmane, soulignant
dans le même temps qu’il n’était guère souhaitable de prévoir, pour les minoritaires, un
6
Sur l’émergence concomitante de la citoyenneté et du patriotisme ottoman, voir Füsun Üstel, Makbul
Vatandaş’ın Peşinde. Ikinci Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi (A la recherche du citoyen convenable.
L’instruction civique [en Turquie] depuis la révolution jeune-turque jusqu’à nos jours), Istanbul, Đletişim Yay.,
2004.
7
A ce propos, voir P. Dumont, « French Free Masonry and the Turkish Struggle for Independence (1919-
1923) », International Journal of Turkish Studies, vol. 3, n° 3, hiver 1985-1986, pp. 1-16.
8
Conférence de Lausanne sur les affaires du Proche-Orient (1922-1923). Recueil des actes de la conférence,
Paris, 1923, tome premier, p. 173.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%