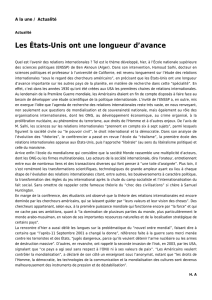la culture

SOMMAIRE
Introduction - Qu’est-ce que la culture ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. – Les comportements sont culturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. – Une réalité concrète et durable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. – Les fondements de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. – Une pluralité de définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
a. – Un tout complexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
b. – Une conscience collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chapitre 1- Quelle est la place de l’individu dans la culture? . . . . . 15
1. – De l’individu à la personne sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
a. – Les fondements normatifs de l’action sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
b. – Les fondements idéaux de l’action sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. – La culture est une réalité structurante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
a. – La culture adapte l’individu à son monde:
l’exemple des stratégies alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
b. – La question du sens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
c. – Rites et rituels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3. – L’incorporation de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
a. – Corps à corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
b. – La culture est une immersion et un partage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4. – Penser la cohésion sociale à travers la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
a. – Une force anonyme et impersonnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
b. – La canalisation des forces sociales à travers l’individu . . . . . . . . . . . . 26
c. – Le social est au-dessus de l’utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Chapitre 2– Peut-on parler d’une science de la culture ? . . . . . . . . . 29
1. – Une définition composite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. – Le cheminement vers une démarche scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . 31
a. – L’affirmation d’un champ de préoccupation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
b. – Les fondateurs de l’anthropologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. – La culture au cœur de l’analyse des sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
a. – La culture est un système d’adaptation de l’homme
à son milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
b. – La culture comme transmission et conditionnement
de l’action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
c. – La méthode culturaliste appliquée aux sociétés industrielles . . . . . . . 38
4. – De l’anthropologie à la sociologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
a. – La critique du culturalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
b. – L’affirmation de la notion de culture dans le champ
sociologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Chapitre 3– La société a-t-elle besoin de la culture? . . . . . . . . . . . . . 45
1. – Les apports du structuralisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
a. – Une pensée de la relation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
b. – La culture comme principe organisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
c. – La règle des règles: la prohibition de l’inceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2. – Des choix sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
a. – L’importance de la pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
b. – Des relations différentes à la nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Chapitre 4– Quels sont les lieux de l’identité ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1. – Cultures et sociétés globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
a. – Une culture nationale fortement ancrée dans la tradition:
l’exemple du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
b. – La nation comme association politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
c. – L’influence de la culture nationale
sur les réalités socio-économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
d. – Cultures et milieux: les sous-cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2. – Culture et stratification sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
a. – Des ethos différents selon les milieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
b. – Culture et classes sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
c. – La fin de la culture ouvrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3. –
Travail et identité
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
a. – L’identité au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
b. – Peut-on parler de culture d’entreprise? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Chapitre 5– Existe-t-il une culture jeune ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1. – Peut-on caractériser l’adolescence par une culture ? . . . . . . . . . . . . . 68
a. – L’adolescence comme culture de l’irresponsabilité . . . . . . . . . . . . . . . 68
b. – L’âge ou la classe sociale ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
c. – Les influences nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
d. – L’adolescence est un « passage » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2. – L’exemple du malaise des banlieues: la culture comme enjeu . . . . . . 73
a. – Déviance et sous-culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
b. – Remise en cause de la permanence des phénomènes . . . . . . . . . . . . . 74
c. – La culture comme ressource et comme enjeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Chapitre 6– La culture est-elle un outil de domination ? . . . . . . . . . 77
1. – La pauvreté est-elle une culture? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2. – La culture au cœur de la reproduction sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
a. – Des pratiques culturelles différenciées selon les milieux sociaux . . . . 80
b. – La culture comme principe de classement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
c. – Violence symbolique et reproduction sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3. – Peut-on parler de culture populaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
a. – Une domination contournée? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

b. – Que penser du populaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
c. – La culture de masse comme nouvelle culture populaire? . . . . . . . . . . 85
4. – L’État et la démocratisation culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
a. – La culture populaire au centre des préoccupations . . . . . . . . . . . . . . . 87
b. – Ouvrir les catégories populaires à la culture légitime . . . . . . . . . . . . . 87
c. – Y a-t-il démocratisation culturelle ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
d. – De la distinction à la dissonance ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Chapitre 7– Culture et modernité : peut-on parler de crise ? . . . . . 91
1. – Les transformations culturelles aux sources du changement social . . 92
a. – Comment changent les systèmes de valeurs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
b. – La ville comme nouvel espace culturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2. – Conflits et cultures comme vecteurs de changement . . . . . . . . . . . . . 95
a. – Les nouveaux mouvements sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
b. – Cultures et contre-cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3. – La montée en puissance de l’individualisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
a. – Le libéralisme culturel et le « souci de soi » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
b. – L’individualisme au cœur des interrogations sociales . . . . . . . . . . . . . 99
4. – La culture de masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
a. – Les contradictions culturelles du capitalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
b. – La crise de la culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
c. – L’ère du vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
d. – Des changements mal sychronisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5. – Réenchanter le monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
a. – Les mythes et les rites profanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
b. – De la masse au sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Chapitre 8– Peut-on parler de mondialisation culturelle ? . . . . . . . 109
1. – La mondialisation, un nouvel horizon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2. – La mouvance des cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Les cadres sociaux de l’acculturation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3. – Entre local et globalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
a. – Le procès de la mondialisation occidentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
b. – La mondialisation provoque le choc des cultures . . . . . . . . . . . . . . . 115
c. – La créativité du bas: puissance des liens sociaux de proximité
et réinterprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
d. – L’affirmation internationale de la diversité culturelle . . . . . . . . . . . . 117
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1. – Le mouvement unificateur de la modernité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
2. – Le retour de l’affirmation de la différence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3. – La réinterprétation des modèles d’intégration . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Ouvrons un album d’images et plongeons-nous dans les
mondes lointains, aux odeurs, aux formes, aux lumières diffé-
rentes… Le Japon nous donne à voir le rien, ou le peu avec
une telle intensité, comme l’indiquent les sept trésors de l’art
du zen: asymétrie, simplicité, essence, naturel, subtilité,
liberté, sérénité. En Afrique, surabondance de lumières, de
décorations, de coquillages et de plumes, peaux scarifiées,
tatouées, transpercées… Les corps en fête exaltent l’énergie et
l’être-ensemble. En Dordogne, repas familial, sacrifice rituel
de l’oie gavée, dans la grande cuisine à l’âtre de la ferme où se
réunissent les convives… Autant de formes et d’expressions
multiples de la culture.
Le mot de culture a pris une importance très grande. On
parle, en vrac, de l’« exception culturelle française », de la cul-
ture politique, de la culture d’entreprise, de la culture du
dialogue social, de « multiculturalisme », de « culture com-
mune », etc. Comment comprendre cette inflation? Sans doute
par la nécessité de se représenter le problème pénétrant de nos
sociétés à tendance individualiste: celui de la cohésion sociale.
Plus on emploie un mot, plus il perd de signification. Est-
ce le cas pour la culture? On verra que la notion de culture est
un bon guide pour penser un ensemble de questions posées
aux sociétés contemporaines. On en étudiera l’usage, l’intérêt
et les limites.
1. – Les comportements sont culturels
Approcher la culture, c’est d’abord prendre la mesure de la
forme qu’elle donne à toute existence humaine.
L’écrivain indien V.S. Naipaul1, dans un livre où il nous fait
partager la diversité du sous-continent indien, donne un
aperçu des rituels dans la vie quotidienne des humains:
« Manger était une activité sacrée. Il y avait des préceptes
rigides quant à l’heure de la journée autorisée pour manger, la
8LA CULTURE
1. V. S. Naipaul, L’Inde, Plon, 10/18, 1990.

direction vers laquelle il fallait se tourner pour manger, la per-
sonne qui vous servait et la quantité consommée. […] Le
phénomène entier était ritualisé sous tous ses aspects. […] Si
l’ombre d’une personne de caste inférieure couvrait votre
nourriture, c’était fini. Vous cessiez de manger, parce que les
aliments étaient devenus impurs. »
À travers la culture, le monde social exprime son ordre et y
mêle les individus. On pourrait penser que l’expression cultu-
relle est concentrée dans les pays où la religion est encore
suffisamment forte pour déterminer les comportements. Il
n’en est rien. Sous d’autres formes, on peut repérer des
constantes qui montrent la prégnance des cultures sur les indi-
vidus. Ainsi, l’anthropologue américain Laurence Wylie2
remarque que les règles de conversation sont très différentes
entre les Français et les Américains. Alors que l’Américain
laisse son interlocuteur finir sa phrase avant de prendre la
parole, le Français la prend avant la fin. Cela induit un certain
trouble dans la relation: les Français trouvent les Américains
trop lents, alors que les Américains trouvent les Français
impolis. Des couples bi-nationaux ont pu ainsi pâtir de ces dif-
férences culturelles!
Ces différences de comportement ont été étudiées par des
courants scientifiques proches de l’éthologie, qui est la science du
comportement des espèces animales dans leur milieu naturel. On
peut citer les recherches d’Edward T. Hall, exposées dans son
ouvrage La Dimension cachée3, où il montre l’importance des sti-
mulations physico-chimiques dans les comportements et les
relations. L’odeur, la chaleur ou le regard interfèrent d’une
façon importante entre les humains, constituant des marqueurs
inconscients et redoutables. Ils sont le résultat des habitudes
acquises et délimitent les univers de communication:
l’Américain utilisera force déodorant et éloignera son haleine
QU’EST-CE QUE LA CULTURE ?9
2. Laurence Wylie, « Joindre le geste à la parole » in Français qui êtes-
vous?, La Documentation française, 1981.
3. Edward T. Hall, La Dimension cachée, 1966, Points, Seuil, 1978.
1
/
5
100%